Les conflits de droits fondamentaux dans la recherche biomédicale
La recherche biomédicale est une pratique qui cristallise les conflits entre les droits fondamentaux du sujet qui participe à la recherche et ceux du chercheur qui souhaite mener son activité de recherche. Ces conflits de droits fondamentaux sont d’autant plus délicats à résoudre que l’intérêt général vient les exacerber en pesant dans la balance entre les bénéfices et les risques de la recherche. La dignité permet alors de servir de guide dans la résolution de ces conflits, en dépit de son caractère malléable qui peut donner lieu à interprétation.
Elise Roumeau, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France.
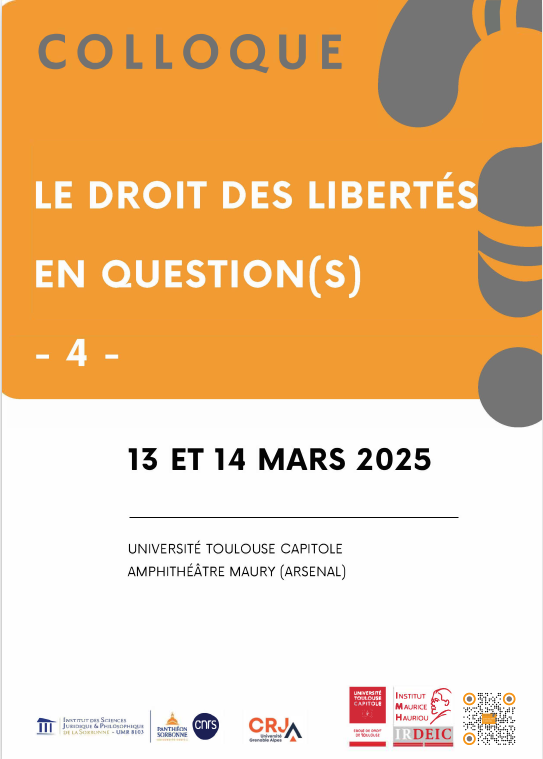 Dire que la recherche biomédicale est un terrain fertile en matière de conflits de droits fondamentaux relève presque de l’euphémisme1. En effet, l’appréhension juridique de cette pratique scientifique oblige à se saisir de l’ambivalence qui la caractérise2. Ambivalente et incertaine par nature, cette activité est pourtant essentielle à la vie humaine et à notre société tant elle est source de progrès et participe au bien-être de tout un chacun en poursuivant un objectif des plus fondamentaux.
Dire que la recherche biomédicale est un terrain fertile en matière de conflits de droits fondamentaux relève presque de l’euphémisme1. En effet, l’appréhension juridique de cette pratique scientifique oblige à se saisir de l’ambivalence qui la caractérise2. Ambivalente et incertaine par nature, cette activité est pourtant essentielle à la vie humaine et à notre société tant elle est source de progrès et participe au bien-être de tout un chacun en poursuivant un objectif des plus fondamentaux.
Cela est d’ailleurs affirmé dans les textes relatifs à cette activité, tels que dans la déclaration d’Helsinki qui précise que « l’objectif premier de la recherche médicale impliquant des participants humains est de générer des connaissances pour comprendre les causes, le développement et les effets des maladies, d’améliorer les interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques, et, en fin de compte, de faire progresser la santé individuelle et publique »3.
Par ailleurs, soulignons que sur le plan scientifique, la notion de recherche biomédicale peut, en fait, renvoyer à des réalités diverses4 : il peut s’agir de recherches menées sur la personne humaine née et vivante, de recherches réalisées sur des embryons qui seront, en principe, voués in fine à être détruits, ou encore de recherches réalisées sur des cadavres. Ce faisant, les bénéfices qui peuvent être tirés de ce type de pratique sont très vastes. Toutefois, si toutes ces pratiques soulèvent des difficultés certaines, il convient de se concentrer sur les recherches menées sur la personne née et vivante, seule titulaire de droits fondamentaux.
Dans le cadre de la pratique expérimentale, les droits fondamentaux occupent une place essentielle. D’une part, l’appréhension juridique de celle-ci a été bâtie par le prisme des droits fondamentaux à la suite de la Seconde Guerre mondiale et du procès des médecins à l’occasion duquel les juges ont identifié les principes de licéité de l’expérimentation5, avant que la Communauté internationale ne se saisisse de cette question. Ainsi peut-on trouver la marque explicite de ce lien dans le Pacte international des droits civils et politiques qui fait de l’expérience médicale ou scientifique non consentie un traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire un acte de torture6. Non explicité par la Convention européenne des droits de l’Homme, ce lien a été affirmé par les juges de Strasbourg à l’occasion de la condamnation de la Russie en 2015 dans l’affaire Bataliny où il était question d’une recherche médicale non consentie réalisée sur un patient d’un hôpital psychiatrique7.
D’autre part, les droits fondamentaux constituent un outil de choix pour la protection de la personne humaine en général et de la personne participant à la recherche biomédicale en particulier. Leur vocation universelle paraît essentielle pour assurer une protection de la personne humaine qui soit la plus effective possible. Cette protection s’inscrit ainsi dans un système de valeur directement lié à la nécessité de respecter l’être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l’espèce humaine et d’assurer sa dignité, notamment face aux dangers qui pourraient résulter d’un usage impropre de la biologie et de la médecine, comme le souligne la Convention d’Oviedo8.
Pour autant, en matière de recherche biomédicale, les droits fondamentaux identifiables ne sont pas seulement ceux du sujet d’expérimentation ; il faut également tenir compte des droits fondamentaux des scientifiques qui mènent ces recherches. Or, si les uns visent à protéger le sujet face aux risques de la pratique expérimentale, les autres permettent au chercheur d’exercer son activité. Ce faisant, il est possible de constater que ces droits fondamentaux peuvent entrer en conflit9, les premiers restreignant la jouissance des seconds.
Face à ce conflit inhérent à la recherche biomédicale, nous pouvons observer dans un premier temps que la prééminence conférée à la dignité humaine permet en principe d’assurer la protection du sujet d’expérimentation face à l’exercice par le chercheur de ses droits fondamentaux (I.), avant de constater dans un second temps que l’effectivité des droits fondamentaux du sujet est parfois mise à mal face aux enjeux sous-tendant l’activité expérimentale (II.).
I – La liberté du chercheur limitée par la préservation de la dignité humaine
Guidé par la volonté de développer les connaissances scientifiques, le chercheur peut exercer sa liberté de telle manière qu’elle devienne une véritable antagoniste de la protection des droits du sujet impliqué dans la recherche. À ce sujet, on peut rejoindre le constat dressé par Edgar Morin qui observe « un conflit entre l’impératif de la connaissance pour la connaissance, qui est celui de la science, et l’impératif de sauvegarder l’humanité et la dignité de l’homme »10. Toutefois, si ce conflit existe et persiste, c’est parce que l’expérimentation médicale et l’acquisition de nouvelles connaissances sont nécessaires et bénéfiques à l’Homme (A). L’affirmation de la prééminence de la dignité humaine tend à faire de cette notion un élément clé pour la protection de la personne humaine dans le cadre de la pratique expérimentale (B).
A- La reconnaissance des bienfaits de la pratique expérimentale
Les bienfaits apportés par cette pratique peuvent être identifiés en filigrane des droits fondamentaux mobilisables par le chercheur. Ainsi trouve-t-on dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, la garantie de la liberté de la recherche scientifique11, et dans le Pacte international des droits civils et politiques, le droit à la liberté d’expression intégrant notamment la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce12. Dans la même veine, le droit européen des droits de l’Homme protège la liberté des chercheurs dans le cadre du droit à la liberté d’expression, comme l’a précisé la Cour européenne dans un arrêt du 27 mai 201413.
On trouve également, dans les préambules de textes internationaux portant spécifiquement sur le domaine de la biomédecine, comme la Convention d’Oviedo ou la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme, le rappel des bienfaits pouvant résulter des découvertes scientifiques et la nécessité de permettre la réalisation de telles découvertes en favorisant notamment « les conditions intellectuelles et matérielles propices au libre exercice des activités de recherche ».14 Le caractère éminemment positif du progrès scientifique est ainsi rappelé, soulignant par ailleurs qu’une restriction trop importante de l’activité de recherche serait préjudiciable. Aussi, on lit que la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme a pour objectif d’assurer que « tous les êtres humains puissent bénéficier des progrès des sciences et des technologies, dans le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».
Pour autant, la liberté des scientifiques est relativisée afin de ne pas nuire aux personnes impliquées dans les recherches médicales. Considérée comme étant la « face cachée des droits de l’Homme »15, la responsabilité des scientifiques apparaît comme une contrepartie de la liberté de la recherche.
Cette responsabilité s’inscrit alors non seulement dans un cadre juridique, en cas d’atteinte aux droits du sujet de recherche, mais également et même d’abord dans un cadre éthique pour assurer une préservation des droits du sujet en amont de la réalisation de la recherche en invitant le chercheur à inscrire sa pratique dans un cadre de valeurs qui permettront de garantir la protection de la dignité de chacun.
Décrite comme « moralement nécessaire et nécessairement immorale »16, la recherche biomédicale est une activité à l’égard de laquelle une importante méfiance persiste et concernant laquelle se pose fréquemment la question de ses limites morales17. En témoigne d’ailleurs le fait que la liberté accordée aux chercheurs soit conditionnée. En effet, l’exercice de la liberté d’expression, qui sous-tend donc la liberté des chercheurs, est contrebalancé par des devoirs et des responsabilités18 visant à préserver les droits du sujet d’expérimentation, sa dignité, sa santé. Comme pour les autres droits ou libertés qui connaissent des restrictions, il est essentiel que les ingérences dans l’exercice de la liberté de la recherche répondent à des conditions prévues par les textes. En droit européen des droits de l’Homme en particulier, le triptyque, classique en la matière, peut être identifié : il faut que les limites à cette liberté soient prévues par la loi, qu’elles visent un but légitime, et qu’elles soient nécessaires à une société démocratique. C’est notamment le cas, à l’échelle nationale, avec la loi Jardé de 2012 qui encadre la pratique de la recherche biomédicale en organisant la protection du sujet qui y participe.
Mais, lorsqu’il s’agit de préserver les droits fondamentaux du sujet d’expérimentation, c’est aussi et surtout pour préserver sa dignité, notion prééminente par-dessus tout.
B- La prééminence de la dignité humaine
La dignité humaine constitue un élément clé dans la consécration des droits fondamentaux à la suite de la Seconde Guerre mondiale, en visant notamment une protection universelle de la personne humaine. Ainsi, le caractère indérogeable de la dignité humaine en fait une notion de choix pour résoudre les conflits de droits pouvant être identifiés en matière de recherche biomédicale. Dans un contexte de biologisation de la protection apportée par le biais des droits fondamentaux, la dignité sert de guide pour résoudre ces conflits. Comme valeur absolue19, constituant le socle de la consécration des droits fondamentaux dès 1948, il semble que la dignité humaine, et son expression par le principe de primauté de la personne humaine, prévalent sur les autres droits garantis.
« Symbole de la condition humaine »20 qu’il convient de protéger des dérives potentielles, la dignité vient placer des limites à l’exercice, par le scientifique de sa liberté, pour protéger le sujet d’expérimentation. Si l’on examine l’échelle de densité normative21 que constitue le très riche ensemble normatif visant à protéger la personne humaine en matière biomédicale, il en ressort que la dignité vient se placer à son extrémité, en appartenant au droit très dur qui ne devrait souffrir d’aucune dérogation tant elle revêt une force obligatoire importante. Notons à cet égard que l’article 3 de la Convention européenne est l’un des rares articles à être formulé sous la forme d’un unique paragraphe, sans aménagement ou dérogation possible. Il ne s’agit donc pas uniquement de protéger la vie de la personne qui participerait à une expérimentation non consentie, mais également de préserver sa dignité d’être humain.
Certes, la dignité du chercheur doit, elle aussi, être préservée en assurant la protection de sa liberté22, mais il convient de souligner ici que se présenterait alors un conflit entre les dimensions objective et subjective de la dignité. En effet, la dignité subjective peut constituer le fondement de la liberté individuelle qui est celle du chercheur. Pour autant, lorsqu’il s’agit de la dignité de la personne humaine participant à la recherche biomédicale, c’est la dimension objective de la dignité qui est également préservée. Marqueur de l’humanité du sujet d’expérimentation, la dignité est alors considérée comme étant une valeur suprême qu’il faut protéger, même s’il faut pour cela limiter l’exercice de la liberté du chercheur.
Pourtant, en dépit de la place de la dignité humaine dans l’arsenal normatif de protection des droits de l’Homme, une difficulté pratique persiste : malgré sa force intrinsèque indéniable, la dignité est absente des textes législatifs encadrant la pratique expérimentale, ce qui affaiblit nécessairement l’effectivité de la protection du sujet d’expérimentation.
II- L’effacement de la protection du sujet face à la liberté de la recherche
Il convient de relever que la protection du sujet dépend avant tout de l’échelon normatif national, donc des législations existantes. Or, à cette échelle, nous pouvons constater que les textes sont guidés par des considérations extrajuridiques (A), voire extranormatives, qui laissent de côté l’objectif de protection du participant à la recherche biomédicale, au profit de l’intérêt général qui soutient la liberté de la recherche (B).
A- La prise en compte de considérations extrajuridiques
La recherche biomédicale, par nature, dispose d’une légitimité forte puisqu’elle permet le progrès et, par-là, l’amélioration de la santé humaine. Par ailleurs, n’oublions pas également que le scientifique bénéficie de la légitimation de son activité du seul fait de la volonté de savoir qui semble faire partie de la nature humaine. Sociologues23, philosophes ou encore psychologues24 ont souligné que l’ « homme veut voir. Voir est un besoin direct. La curiosité dynamise l’esprit humain »25. Alors, si l’expérimentation médicale, en tant qu’activité, poursuit le but des plus légitimes de faire progresser les connaissances médicales pour soigner, l’expérimentateur, en tant qu’être humain, veut, parfois, avant tout acquérir de nouvelles connaissances et pourra être guidé davantage par cette volonté profondément individuelle, plus que par des considérations collectives.
Aussi, et peut-être même surtout, le législateur ne peut se départir de considérations qui sont minoritaires au sein des normes internationales sur les droits de l’Homme : celles qui revêtent une coloration économique. En effet, tandis que sur le plan international, il s’agit de procéder à des choix de valeurs, à l’échelle nationale, la pression économique qui s’exerce en la matière serait, pour certains auteurs, une « icône corruptrice »26. Empreint d’une philosophie utilitariste, l’encadrement de la pratique expérimentale est construit, notamment, autour de la notion de balance entre les bénéfices et les risques. Or, en l’occurrence, il y a un biais initial dans le recours à un tel rapport puisque les bénéfices pris en compte sont collectifs, tandis que les risques analysés, eux, ne sont supportés que par le sujet.
Surtout, la logique concurrentielle qui existe entre les États pèse sur les choix opérés par le législateur qui ne peut retenir un encadrement trop restrictif de cette pratique, au risque d’assister à la mise en œuvre d’une stratégie de contournement de la législation française avec la réalisation des travaux de recherche ailleurs qu’en France. À cet égard, la prise en compte de ces éléments par le législateur influence l’appréhension de la matière expérimentale : ainsi, l’adoption de la loi Jardé en 2012 a inversé la logique qui existait jusqu’alors en abandonnant l’objectif de protection du sujet d’expérimentation pour encourager la recherche. Parmi les modifications opérées, la distinction de trois catégories de recherches impliquant la personne humaine, renvoyant à diverses modalités de recueil du consentement, conduit à abaisser les exigences en la matière27.
D’autres permissions législatives témoignent également de cet abaissement des exigences en matière de protection du sujet d’expérimentation, et ce, dans l’objectif de développer les connaissances médicales. C’est notamment le cas en matière de recherches oncologiques : en la matière, le CCNE souligne que le rapport entre les bénéfices et les risques est particulièrement défavorable aux participants28. Pourtant, ces recherches sont permises, et ce, en dépit du respect de l’intégrité du sujet. Dans la même veine, les recherches employant des placebos comme témoins sont également permises. Ici, ce sont les risques dus à l’absence de molécule active qui peuvent être soulignés, des risques d’autant plus perceptibles lorsque la participation à la recherche implique en même temps de stopper un traitement déjà en place29.
Dans ces deux cas, la légitimation de ces recherches est liée, notamment, à la logique solidariste qui sous-tend aujourd’hui le cadre législatif en matière biomédicale en général30, et matière de recherche en particulier31, faisant in fine du corps humain une ressource biomédicale32. Ce constat peut d’ailleurs également être tiré lorsque l’on s’intéresse aux contradictions entre l’intérêt du sujet et l’intérêt général.
B- La liberté de la recherche soutenue par l’intérêt général
À l’échelle nationale, la législation française affirme une volonté de protection du sujet d’expérimentation, et ce, depuis l’adoption initiale de la loi Huriet en 1988. Ainsi, l’article L.1121-2 du code de la santé publique prévoit la primauté des intérêts de la personne impliquée dans la recherche biomédicale sur les intérêts de la science. Néanmoins, certains points témoignent du fait que cette affirmation n’est pas si claire. En particulier, le fait que les bénéfices de la recherche biomédicale sont appréhendés à l’échelle de la collectivité remet en cause cette affirmation de la primauté des intérêts du participant à la recherche : en effet, on lit à l’article L.1121-2 du Code de la santé publique qu’une recherche ne peut pas être menée si le risque prévisible encouru par les personnes impliquées est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces mêmes personnes ou pour l’intérêt de cette recherche.
Ce faisant, l’analyse entre les bénéfices et les risques de la recherche réalisée tient compte de l’intérêt de la science, laissant apparaître une nuance importante dans la primauté des intérêts du sujet et témoignant de l’application de l’éthique utilitariste à ce domaine. D’ailleurs, c’est bien ce qui justifie que des volontaires sains puissent se prêter à cette pratique, puisque par nature, ces derniers ne pourront tirer aucun bénéfice individuel de leur participation.
Ce manque de clarté entre la préservation des intérêts du sujet et la protection de l’intérêt général est en fait lié à l’ambivalence de la pratique expérimentale qui implique de concilier « la santé individuelle des participants et le bénéfice collectif escompté de la recherche »33.
Il est alors possible de trouver des éléments propres à la résolution de ces conflits de droit, dans la méthodologie déployée par les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Le recours à la proportionnalité est notamment très intéressant puisqu’il permet la mise en balance entre les différents intérêts pour rechercher le juste équilibre34. Il faut alors identifier les intérêts en présence et déterminer ceux qui pourront prévaloir en fonction des circonstances : parfois l’intérêt individuel du sujet, comme dans l’affaire Bataliny contre Russie35, parfois l’intérêt général comme dans l’affaire Hristozov contre Bulgarie36 où quelques patients en situation d’impasse thérapeutique se sont vu refuser l’accès à la recherche pour faire prévaloir notamment le respect de la loi qui ne devait être contournée et le bon développement de l’économie pharmaceutique. La logique casuistique permet ainsi à la Cour de ménager les différents intérêts en présence, afin de préserver non seulement la bonne application des droits fondamentaux, mais également le progrès scientifique.
Guidés par le standard de la nécessité dans une société démocratique, les juges européens peuvent ainsi résoudre les conflits de droits qui se présentent en apportant une réponse équilibrée à un problème complexe.
1 Les réflexions présentées ci-après ont été initiées dans le cadre d’un travail de thèse et ont pu y être développées plus en détail, E. Roumeau, Les sujets humains d’expérimentation face aux droits fondamentaux, Mare & Martin, 2023, 690 p.
2 S. Paricard, « La recherche médicale et le droit : une relation ambivalente », RDSS, 2009, p. 98.
3 Déclaration d’Helsinki de l’AMM – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des participants humains, [https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/], consulté le 1er mars 2025.
4 E. Roumeau, op. cit., p. 39 et s.
5 Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law n° 10, op. cit., p. 182.
6 PIDCP, 1966, article 7.
7 CEDH, Bataliny contre Russie, 23 juillet 2015, n°10060/07.
8 Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, 1997, préambule.
9 P. Ducoulombier, Les conflits de droits fondamentaux devant la Cour européenne des droits de l’Homme, Bruylant, Publications de l’Institut René Cassin de Strasbourg, 2011, p. 3 : Selon le Professeur Ducoulombier, pour que les droits fondamentaux soient en conflit, « il faut que leur exercice poursuive des finalités contradictoires, antagonistes, voire irréconciliables. Il y a conflit lorsque l’exercice d’un droit fondamental restreint la jouissance d’un autre droit fondamental ».
10 E. Morin, Science avec conscience, Seuil, « Points », 1990, p. 122.
11 PIDESC, 1966, article 15.
12 PIDCP, 1966, article 19.
13 CEDH, Mustapha Erdogan et autres contre Turquie, 27 mai 2014, n°346/04 et 39779/04, §§40-41.
14 Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme, 1997, préambule.
15 F. Ost, S. Van Drooghenbroeck, « La responsabilité, face cachée des droits de l’Homme », in. E. Bribosia et L. Hennebel(Dir.), op. cit.
16 J. Bernard, De la biologie à l’éthique, Buchet Chastel, 1990, p. 45.
17 K. Bayertz, « Trois arguments pour la liberté de la science », in. P. Proellochs, D. Schulthess (Dir.), op. cit., p. 11.
18 CEDH, 1950, article 10 §2 : « L’exercice de ces libertés comportant des droits et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi (…) » ; PIDCP, 1966, article 19 §3: « L’exercice des libertés prévues au par.2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi (…) ».
19 V. not. : M. Fabre-Magnan, « La dignité en droit : un axiome », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2007/1, Vol.58, p. 18.
20 C. Byk, « Chapitre 5. Le concept de dignité et le droit des sciences de la vie : une valeur symbolique et dynamique au cœur de la construction sociale de l’Homme », JIB, 2010/4, Vol.21, p. 70.
21 V. sur le concept : C. Thibierge et al., La densification normative, Mare & Martin, 2014, 1204 p.
22 V. Rea, La liberté de la recherche en matière de bioéthique, Thèse, Lyon III, 2009, p. 289, [https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2009_out_rea_v.pdf], (Consulté le 15 juin 2019).
23 V. not. les réflexions d’Edgar Morin sur La Connaissance de La Connaissance, E. Morin, La Méthode, Éditions du Seuil 2008.
24 V. ég. les travaux de D. Garnault qui évoque les pulsions scopiques des scientifiques qui veulent accroitre leurs connaissances à tout prix, D. Garnault, « Histoires de ventre : une politique du corps des femmes », Champs psy, 2013/2, n°64, p. 58.
25 G. Bachelard, L’Eau et les rêves., Le livre de Poche, 18ème édition, 2019, p. 38.
26 A. Kahn, C. Godin, L’homme, le bien, le mal. Une morale sans transcendance, Pluriel, 2013, p. 285.
27 V. not. : J. Mattiussi, « Entre simplification des procédures et protection des individus : le nouvel équilibre de la loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine », RDSS, 2018, p. 286.
28 CCNE, Avis n°73, « Les essais de phase I en cancérologie », 2001.
29 E. Roumeau, op. cit., p. 231 et s.
30 V. not. : X. Bioy, Biodroit, De la biopolitique au droit de la bioéthique, LGDJ, 2016, p. 157.
31 V. not. : A. Laude, « La réforme de la loi sur les recherches biomédicales », D., 2008, p. 1150.
32 X. Aurey, La transformation du corps humain en ressource biomédicale, Étude de droit international et européen, Thèse, Panthéon-Assas, 2015, 707 p.
33 S. Gromb, Le droit de l’expérimentation sur l’homme. Droit français et règles supranationales, Litec, 1992, p. 11
34 P. Muzny, La technique de proportionnalité et le juge de la Convention européenne des droits de l’Homme, Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, t. 2, p. 344.
35 CEDH, Bataliny contre Russie, 23 juillet 2015, n°10060/07.
36 CEDH, Hristozov et autres contre Bulgarie, 13 novembre 2012, n°47039/11 et 358/12.



