Les apports de la géographie juridique à la théorie des libertés
Cet article explore les apports de la géographie juridique à la théorie des libertés en mettant en lumière la dimension spatiale des droits fondamentaux. Si le droit public français a longtemps accordé une attention limitée à l’espace, des recherches récentes, notamment inspirées du courant anglo-saxon de la Law and Geography, ont montré combien les normes juridiques sont façonnées par et productrices d’espaces. L’analyse proposée s’appuie sur l’idée de « spatialisation des libertés » qui postule que l’endroit où se situe le titulaire de droits fondamentaux détermine pour partie l’effectivité des libertés qui lui sont attribuées. D’une part, l’intégration de l’espace dans l’interprétation normative et factuelle des libertés permet d’affiner l’analyse de leur effectivité, en prenant au sérieux les contextes sociaux et matériels de leur application. D’autre part, l’étude des dispositifs spatiaux – tels que les check-points – met en évidence la manière dont les normes juridiques s’incorporent dans l’espace bâti, orientent les comportements et configurent l’accès aux libertés.
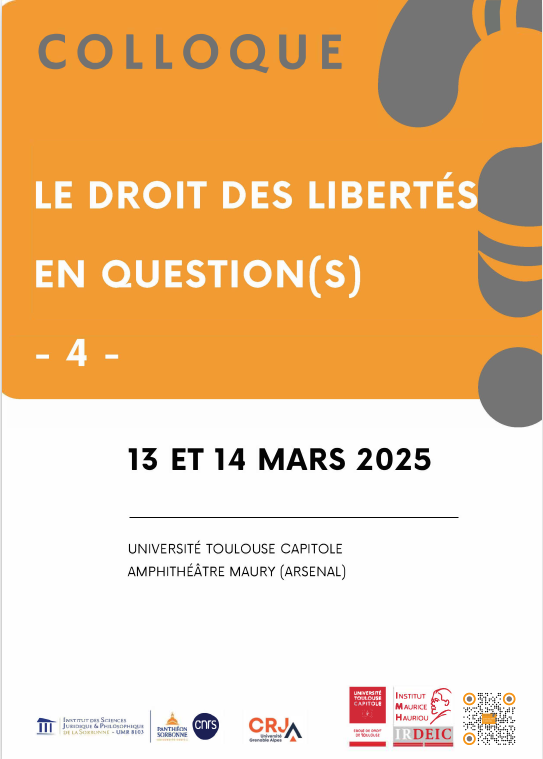 H. Avvenire, Maître de conférences en droit public, Université de Poitiers
H. Avvenire, Maître de conférences en droit public, Université de Poitiers
Avant d’être un sujet de droit, chaque personne est un corps qui occupe une place quelque part dans le monde. La place que nous occupons contribue à définir notre expérience, nos valeurs et notre identité. Réaliser nos aspirations, être traité avec considération ou, tout simplement, agir dépendent pour partie de cette place. Autrement dit, « pour être, il faut être quelque part » 1. L’espace appelle un souci d’incarnation en ce que « les êtres humains eux-mêmes en tant qu’ils ont et sont des corps eux aussi matériels, localisés quelque part et pas ailleurs »2.
L’espace3 joue un rôle central dans l’expérience humaine. Il est structurant de notre pensée et de notre langage4. C’est d’abord la philosophie de la nature, puis de la physique5, qui ont tenté de proposer les premiers éléments de compréhension de l’espace. Mais à la version absolutiste ou abstraite de l’espace — tel qu’il était pensé par Leibniz, Descartes, Kant ou Newton6 — les sciences sociales, et particulièrement la géographie, en ont proposé une nouvelle approche. Les origines modernes de la discipline géographique au XIXème siècle postulent en effet que les modalités d’occupation des espaces par les sociétés humaines découlent de lois naturelles, le milieu physique déterminant le genre de vie des populations7. La géographie s’est progressivement émancipée d’une démarche principalement descriptive pour s’attacher à expliquer les faits sociaux, en considérant qu’ils sont le résultat d’une construction de la société, possédant une dimension culturelle et politique8.
L’intérêt croissant du droit pour la littérature géographique et pour le rôle structurant de l’espace dans la fabrique des normes est relativement récent9. C’est le cas du programme de recherche dit de « territorialisation du droit »10, qui étudie la prise en compte par la norme des variations spatiales, à partir de la notion de territoire. Les études produites dans le cadre de ce programme étudient soit l’influence du territoire sur le contenu de la norme, soit la manière dont l’administration adapte le droit aux spécificités locales11. Ces recherches ont renouvelé les outils12 et les objets d’analyses du droit, notamment en faisant émerger une réflexion juridique sur la justice spatiale13. Elles ont inspiré des initiatives institutionnelles, telle que l’appel à projets 2024 de l’IERDJ intitulé Droit, justice et espace(s). Ces démarches se tiennent sur une ligne de crête entre une conception du droit qui l’enferme dans une autonomie relative et une conception sociale qui lui dénie toute autonomie par rapport aux phénomènes sociaux14. Pour cette raison, il est difficile de voir dans ces recherches un spatial turn dans le champ du droit public français15.
Le droit des libertés a longtemps épousé ces lignes de démarcation disciplinaires et a, par conséquent, prêté peu attention au rôle de l’espace pour les libertés. Une exception notable à cet égard est l’article pionnier de Danièle Lochak, intitulé « Espace et contrôle social »16, dans lequel l’autrice appelait déjà à déplacer l’espace sur le terrain du droit des libertés. L’espace étudié par l’autrice n’est pas réifié, il n’est pas « le réceptacle indifférencié et le décor neutre des événements constitutifs de la vie sociale ». Il est « producteur de social » tout comme il est socialement – et donc juridiquement – construit. Toutefois, l’étude en droit des libertés des effets des interactions espace-droit a connu un regain d’intérêt récent. Un premier axe de recherche s’est intéressé à la différenciation territoriale des droits, notamment à travers l’attribution de libertés spécifiques en fonction de l’appartenance à un groupe17. Des approches transversales, qui croisent droit de l’urbanisme et droit de la non-discrimination, contribuent à renouveler l’approche juridique droit des libertés18.
C’est toutefois autour de la notion d’« espace public » que les contributions doctrinales se sont révélées les plus structurées. Celle-ci a permis, entre autre, de revisiter le régime juridique de la liberté religieuse19, de questionner l’influence normative croissante des acteurs privés – via les règlements intérieurs et le rôle croissant de la sécurité privée – sur ces espaces20, ou encore d’analyser le déploiement de dispositifs de surveillance (technopolice) 21. Dans The Mall, Stéphanie Hennette-Vauchez plaide pour une réflexion sur les droits fondés sur l’expérience vécue des individus, intégrant une double dimension spatiale et pragmatique22. Mais ces travaux, bien qu’éclairants, n’ont pas encore structuré un champ de recherche sur les interactions entre le droit et l’espace, à l’image de ce qu’a accomplie la Law and Geography anglo-saxonne.
Depuis les années 1980, des travaux interdisciplinaires ont émergé dans les départements de droit et de géographie, explorant les interactions entre droit et espace23. Du côté des recherches socio-juridiques, des chercheurs ont commencé à analyser les dimensions spatiales du droit à travers des études portant sur le territoire, le racisme, ou encore les dynamiques urbaines et suburbaines. Parallèlement, des géographes ont enquêté sur des objets juridiques en interrogeant la gouvernance urbaine, les politiques publiques ou la géographie politique24. Ce champ d’études, souvent désigné sous le nom de Law and Geography, vise à comprendre comment le droit — entendu comme un ensemble de textes, de pratiques et de processus — est façonné par les dimensions géographiques de la vie sociale et politique, et réciproquement, comment la spatialité des relations sociales est structurée par les normes juridiques25. Il ne s’agit ni d’un sous-domaine du droit, ni simplement d’une branche de la géographie humaine, mais d’un espace interdisciplinaire qui accueille des recherches menées par des juristes, géographes, sociologues, politistes et anthropologues. Ce champ est largement influencé par les Critical Legal Studies, qui ont encouragé une lecture critique des rapports de pouvoir en étudiant ensemble les normes juridiques et les espaces26. Ces travaux ont connu un développement important depuis 30 ans, y compris en dehors du monde anglophone, et on renouvelé l’analyse du droit à partir des conditions matérielles, territoriales et relationnelles des pratiques juridiques27.
La réception française de ce courant est avant tout le fait de géographes28. Elle a notamment fait preuve de fertilité pour l’étude des dispositifs restrictifs de libertés : le maintien de l’ordre29, les restrictions d’usages des espaces publics30 ou encore les restrictions d’accès aux espaces naturels durant la pandémie de Covid-1931. Les recherches anglosaxonnes et les études françaises se rejoignent aujourd’hui pour considérer que l’espace peut être une condition ou un instrument de définition du régime des libertés. On retrouve ici des propositions portées outre-Atlantique par des auteurs comme Nicolas Blomley32 ou David Delaney33. L’émergence d’un intérêt récent pour ce thème n’est pas contestable, comme en témoigne la traduction de certains articles de Law and Geography34. Il souffre toutefois encore de ne pas avoir révélé tout son potentiel pour la théorie du droit des libertés.
Notre proposition entend donc explorer les implications d’une prise en compte de l’usage des espaces dans les normes juridiques relatives aux libertés fondamentales. Nous appelons « spatialisation des libertés » l’approche qui traite certains « types de questions »35 ou porte une attention36 particulière au phénomène de spatialité des droits et libertés. Ce phénomène suppose que l’endroit où se situe le titulaire de droits fondamentaux détermine pour partie l’effectivité des libertés qui lui sont attribuées. Comment une telle prise en compte est possible ? Répondre à cette question nécessite d’intégrer plusieurs postulats à l’analyse juridique.
Tout d’abord, il s’agit d’adopter une conception des espaces bien informée par la littérature géographique : les espaces ne sont pas donnés, ce sont des constructions sociales qui possèdent une factualité mais sont modelées par les comportements sociaux37. Ensuite, le droit doit être conçu comme une pratique normative qui recourt au langage pour motiver les comportements. Pour diriger les comportements les normes juridiques emplois des mots (expressions spatiales) qui mobilisent des unités conceptuelles (concepts spatiaux) qui se réfèrent aux espaces. Enfin, c’est la signification des normes juridiques qui motivent les comportements sociaux38 et modèlent par conséquent les espaces (fabrique des espaces).
L’étude que nous proposons entend démontrer l’intérêt pour la théorie des libertés d’analyser la composante spatiale des droits fondamentaux. L’apport d’un tel travail théorique est d’approfondir les outils d’analyses utilisés pour étudier le régime des libertés. Il convient alors de prendre au sérieux le poids de l’espace dans la réalisation des libertés (spatialité des libertés). En France, l’analyse du droit des libertés s’est centrée sur les normes formelles et leur interprétation, autour notamment de la question de l’effectivité. Intégrer l’espace permet d’en affiner l’étude (I). Par ailleurs, l’attention portée aux contextes physiques d’application des normes ouvre la voie à une théorie plus incarnée des libertés, attentive aux mesures d’aménagement qui modèlent l’espace (II).
I – Prendre au sérieux l’espace, affiner l’étude de l’effectivité
La liberté d’expression politique, le droit à la vie privée ou la liberté d’aller et venir ne sont pas pourvus de la même effectivité39 dans une rue, dans une université, dans un centre commercial ou un domicile. La question de l’effectivité des libertés touche à la fois aux garanties juridiques mises en place pour les protéger et à l’interprétation des énoncés qui les consacrent40. Pourtant, son appréciation se heurte à deux difficultés majeures. La première tient à la détermination de ce qu’exige la norme (l’interprétation normative) (A), la seconde à l’établissement des faits permettant d’évaluer la réalisation de celles-ci (l’interprétation factuelle) (B). La spatialisation des libertés semble pouvoir apporter une contribution à ces deux problèmes.
A/ L’espace et l’interprétation normative des droits fondamentaux
Dans le cas des libertés fondamentales, les formulations souvent générales ou abstraites rendent incertaine l’adéquation entre les pratiques des acteurs du droit et le contenu des normes. Il est alors nécessaire de clarifier, voire de stabiliser, les significations de ces normes afin d’en permettre une évaluation critique41. La spatialisation peut permettre de clarifier le processus d’interprétation normatif des libertés en portant attention à l’intrusion contextuelle42 dans la pratique juridique. En effet, si les mots désignent bien quelque chose, ils ne constituent qu’un « cadre »43 destiné à être précisé lors de leur emploi par le juge44. L’analyse de l’effectivité des libertés s’intéresserait à la manière dont, au sein du discours juridique, l’espace est mobilisé ou ignoré pour interpréter le sens attribué à nos libertés. En effet, les libertés fondamentales dépendent « tant des présupposés théoriques de leurs différents interprètes […] que des contextes juridiques, politiques ou institutionnels dans lesquels ces interprètes agissent et décident »45. En tentant de donner sens à la complexité de la vie sociale, la pratique juridique représente et évalue l’espace de diverses façons46 qui sont intégrées lors de la reconstruction du sens des énoncés juridiques pour déterminer la norme. La norme juridique établit « ce qui doit être fait ou pas fait si certaines circonstances se vérifient »47 et donne des raisons pratiques à l’action des rédacteurs, des interprètes, des applicateurs ou des titulaires des libertés.
Dans ce cadre, l’espace peut alors servir d’élément contextuel à l’interprétation normative à au moins deux niveaux. Le premier intéresse le co-texte, le second l’arrière-plan de la norme. Le co-texte désigne les éléments textuels qui inscrivent l’énonciation dans un ensemble discursif avec lequel ils interagissent48. Cette intertextualité, dans laquelle peut être enrôlé l’espace, intéresse autant les modalités d’application de la norme – l’espace a pour fonction de déterminer le champ d’application ratione loci des normes – que ses conditions de légalité. Par exemple, lorsque le juge apprécie la présence ou l’absence de donnée spatiale précise pour juger qu’une mesure est « générale et absolue » il met en regard le texte contrôlé avec une longue tradition jurisprudentielle49. L’arrière-plan désigne pour sa part l’ensemble des présupposés et croyances partagés dans la communauté juridique, orientant l’interprétation50. Il interroge l’« imaginaire spatial »51 des textes juridiques : un réseau conceptuel et axiologique lié à l’espace. Ainsi, le concept de territoire, perçu comme constitutif de la souveraineté étatique, est associé à la citoyenneté52. Il devient une donnée implicite de l’application des normes d’aménagement des libertés, justifiant qu’elles ne puissent pas avoir (en principe) un caractère extraterritorial53 ou que les non nationaux ne soient pas bénéficiaires de certains droits fondamentaux (par exemple, la participation politique).
La spatialisation au niveau de l’interprétation normative possède des implications méthodologiques, puisqu’elle entend approfondir l’analyse du langage juridique. L’ « herméneutique géo-légale »54 est la principale tradition qui s’est engagée dans cette voie. Elle postule le primat du discours sur le langage, l’historicisation des interprétations et le souci d’appréhender le droit dans son ouverture à d’autres textes (intertextualité), en particulier sa sensibilité aux contextes locaux55. La tendance de nombre de ces auteurs est d’avoir développé une intense réflexion sur les questions de langage, de représentation et d’analyse textuelle en suggérant que la communauté juridique a accordé bien peu d’attention à son usage des concepts spatiaux et des images liées aux lieux, alors même que ces interprétations ont des effets tangibles56. Ainsi, selon le contexte, un bureau, une cellule ou un hall d’immeuble peuvent être inclus ou exclus de la protection accordée au domicile. On le voit, penser en termes de spatialisation des libertés pourrait éclairer certains aspects de l’interprétation normative. Une telle approche fournit également des pistes de réflexions nouvelles pour l’étude de l’interprétation factuelle des libertés.
B/ L’espace et l’interprétation factuelle des droits fondamentaux
Mesurer l’effectivité suppose une prise en compte du réel (l’interprétation factuelle), ce qui exige du juriste une ouverture à d’autres disciplines des sciences sociales, dont les méthodes et résultats peuvent éclairer les conditions concrètes d’exercice des libertés57. Une telle démarche, bien que complexe, est essentielle pour que l’affirmation des garanties ne demeure pas purement formelle. La spatialisation fournit une nouvelle perspective sur la confrontation des situations concrètes aux énoncés juridiques. Par exemple, le décret du 16 mars 2020 interdisait « le déplacement de toute personne hors de son domicile » en omettant qu’une partie de la population française ne possède pas de domicile. Ce flou a conduit à la verbalisation de sans-abris durant le confinement de 202058. Cette illustration nous rappelle que les dispositions juridiques fournissent non seulement des normes, mais également des raisons au traitement public des personnes. L’apparente indistinction opérée par les normes d’un arrêté « anti-mendicité », la décision d’installer un banc « anti-sdf » ou de supprimer du mobilier urbain (les « ghost amenities ») accroît le pouvoir discrétionnaire59 des autorités et des agents publics, conduisant à un traitement inégalitaire des populations jugées indésirables60.
L’enrichissement de l’interprétation factuelle par la spatialisation a à son tour d’importantes incidences méthodologiques61. Parallèlement aux méthodes qui s’attachent à interpréter les textes, on trouve dans la littérature géo-légale un grand nombre de contributions qui font usage de méthodes ethnographiques au sens large. Ce peuvent être des observations, des ethnographies au sens propre (c’est-à-dire des descriptions reposant sur des observations répétées sur un temps long) ou des entretiens62. Cette approche accorde une importance primordiale aux « contextes de réception et d’actualisation des normes, à leur matérialisation dans l’espace, à la manière dont le droit est vécu »63. L’enjeu est de comprendre comment les normes sont susceptibles d’orienter des comportements ou les situations spatiales. Elle se rapproche ainsi du pragmatisme dans sa version philosophique64 et des études empiriques du droit.
Ces dernières, qui favorisent l’étude du droit par la collecte de matériaux empiriques qualitatifs ou quantitatifs, pourraient constituer une voie privilégiée de la spatialisation des libertés et de renouvellement des études juridiques. D’abord, en déplaçant l’attention de la recherche juridique vers de nouveaux matériaux : la cartographie, les données statistiques ou le vécu des acteurs du droit, par exemple. Ensuite, l’attention portée à l’interprétation factuelle des libertés et à leurs modalités de spatialisation invite à déplacer le terrain de la recherche juridique : des tribunaux, où le droit est appliqué65, vers les lieux où le droit est vécu66. Il s’agirait de reconstituer l’expérience que les individus font de leur liberté, en étudiant la manière dont les normes juridiques s’incarnent dans leur vie quotidienne en modelant les espaces. Enfin, la spatialisation des libertés invite à prendre au sérieux la technicité juridique (legal technicalities)67. L’étude de l’interprétation factuelle des libertés supposerait alors de s’intéresser aux savoirs juridiques (c’est-à-dire aux concepts, leurs expressions et leurs circulations) et à leur mise en pratique qui façonnent l’espace68, loin d’une vision du droit qui le réduirait à un pur instrument des structures sociales à l’œuvre69.
L’attention portée à la spatialisation des libertés montre que la norme juridique fait advenir ou modifie la signification sociale des espaces à travers les pratiques distinctives de nomination, de classification, de réglementation, de gouvernance ou d’ordonnancement. Dit autrement, le droit « trace des lignes, construit des dedans et des dehors, assigne des significations juridiques aux lignes, et attache des conséquences juridiques au fait de les franchir »70. Les processus de spatialisation du droit sont complexes, mais ils emportent d’importantes conséquences sur la possibilité d’exercer une liberté fondamentale. Il convient donc de s’intéresser aux manières dont le droit est mobilisé pour justifier et maintenir des différences en fonction de l’espace71.
II – L’aménagement des libertés par la modélisation de l’espace
Penser la spatialisation des libertés n’intéresse pas que l’écart entre la norme et les faits qu’elle entend régir, elle invite à repenser les mesures d’aménagements des libertés comme des instruments de direction des corps. Par effet de retour, elle suppose de chercher dans ces instruments les mesures d’aménagements des libertés qui y sont incorporés72. À cette fin, nous proposons de recourir à un concept d’analyse du droit emprunté à la géographie – le dispositif spatial (A) – et d’illustrer sa force heuristique au travers de l’étude d’un type d’aménagement des libertés par l’espace : le check point (B).
A/ Le dispositif spatial, concept d’analyse de l’aménagement juridique des libertés
L’histoire nous enseigne que les architectes, urbanistes, utopistes et réformateurs ont « recherché les formes spatiales, architecturales ou urbanistiques notamment, les mieux à même de produire les effets sociaux désirés »73. Ce présupposé a donné naissance à la prévention situationnelle des espaces urbains74 et à l’architecture carcérale moderne75. On doit à Henri Lefevre d’avoir attiré l’attention sur l’influence de la texture spatiale sur les possibilités offertes aux individus76. Aujourd’hui encore, l’espace est investi de qualités, de fonctions et de hiérarchies qui sont produites par les techniques matérielles qui entendent influer sur la délimitation de l’espace et sur notre rapport à celui-ci77. Comme l’explique Jérémy Waldron, « le concept de liberté s’applique généralement à des actions plutôt qu’à des lieux. Pourtant, « tout ce qui est fait doit être fait quelque part »78. Dans cette mesure, toutes les actions comportent une composante spatiale. Les modalités de contrôle social de l’espace qui détermine la « configuration spécifique du rapport clôture/ouverture »79 reposent largement sur l’usage de la norme juridique80. C’est le droit qui détermine le répertoire d’actions permises aux individus en permettant d’ériger des barrières physiques, psychologiques (savoir que l’espace existe, dissuasion à l’entrée, etc.) ou d’éviction (en rendant les espaces ou les équipements peu confortables pour certains usages ou en contrôlant certaines populations jugées indésirables81) qui se déploient dans l’espace. Comment rendre compte de ce pan de l’expérience normative82 des titulaires de droits fondamentaux ?
Nous proposons d’emprunter un concept géographique comme outil d’analyse du droit positif : le dispositif spatial. Nous devons à Michel Foucault la notion de dispositif qu’il élabore dans ses travaux sur le pouvoir disciplinaire83. Si l’expression n’a pas un sens stable dans ses écrits84, il proposera en 1977 une formulation : « Ce que j’essaie de repérer sous ce nom, c’est, premièrement, un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philantropiques […] »85. Autrement dit, une technologie politique du corps86. Les travaux récents en géographies87 se sont emparés et ont raffiné le concept afin d’étudier comment certaines formes sociales de contrôle s’incarnent par l’espace88. Le dispositif spatial permet au juriste d’intégrer à l’analyse des normes juridiques « masquées » parce qu’incorporées89 dans le bâti, dans des aménagements ou dans des dispositifs techniques ou humains. Par cette incorporation, ces normes deviennent des modèles de conduite sensible90 : elles pèsent sur les comportements adoptés par les sujets de droits fondamentaux.
Les dispositifs spatiaux sont toujours le résultat d’une activité juridique qui les a produites. Les actes juridiques absorbent les faits qui ont conditionné leur production ou qui ont été nécessaires à leur exécution. Le droit est aujourd’hui familier des cas où un acte juridique non formalisé est révélé par un fait matériel. La recherche de l’ « effet notable »91 dans une approche plus conséquentialiste que formaliste92, est une expression de ce phénomène. La clôture et le mur sont les incarnations les plus évidentes, et massives, des dispositifs spatiaux. Les règles juridiques qui gouvernent l’implantation, l’édification ou l’entretien de ces ouvrages modèlent in fine la physionomie des espaces. Néanmoins, l’utilisation des espaces pour peser sur la palette de nos choix peut prendre des formes plus fines, comme en témoigne la diffusion de techniques qui relèvent d’un type de dispositif spatial : le checks point.
B/ Le check point, analyse juridique d’un mode d’aménagement spatial des libertés
Le check-point renvoie à la surface de contact entre deux espaces et à la procédure qui règle les échanges entre les deux93. Elle peut être dite « dense » lorsqu’elle concentre massivement des barrières physiques, et technologiques, comme le check point d’un aéroport par exemple : aux murs, portiques et couloirs qui permettent de canaliser le cheminement des passagers pour en faciliter la surveillance et le contrôle, il faut ajouter les caméras, scanner et agents disséminés dans l’aéroport. En revanche, la surface de contact entre deux espaces peut être dite « légère » toutes les fois où les barrières vont être adoucies ou avoir une apparence plus agréable, en remplaçant un vigile d’accueil dans un centre commercial par un système de vidéosurveillance, par exemple. Comme pour le périmètre de sécurité, il s’agit alors d’instaurer une « surveillance du mouvement » plutôt qu’une « surveillance du territoire »94 : les déplacements des visiteurs filtrés sont balisés à l’intérieur d’un espace déterminé et non plus en lisière de celui-ci.
Les check-points sont constitués d’un ensemble d’instruments hétérogène. Le périmètre de contrôle d’identité de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, le périmètre de protection de l’article L. 226-1 du CSI ou encore le passe sanitaire sont autant de dispositifs mobilisant des technologies (telles que des données à caractères personnels), des techniques (palpation et fouille), des personnes (agents de sécurité privée ou agents des forces de l’ordre) reliées par des normes juridiques. Le dispositif d’aménagement des libertés des Jeux olympique et paralympique est exemplaire de cette logique : l’arrêté instituant les périmètres de sécurité et de protection dressait une longue liste de points d’accès95. Ces check-points supposaient de mobiliser des moyens de surveillance humain et algorithmique, des instruments de contrôles physiques et dématérialisés, comme par exemple, la nécessité d’être doté de laissez-passer. Ces dispositifs ont tracé des frontières discrètes au sein des espaces publics parisiens.
L’analyse des check point révèle trois modalités d’interaction entre normes et espaces au cœur des dispositifs spatiaux : leur étendue, leur texture et leur fonctionnalité. L’étendue désigne les différentes entités spatiales qui sont découpées par les dispositifs au sein d’objets ou des lieux en fonction de leurs morphologies, dispositions ou orientations96. L’étendue désigne donc l’emprise matérielle sur l’espace du dispositif spatial, il peut à ce titre être particulièrement vaste (une frontière) ou interstitiel97. La « texture », ensuite, permet de souligner l’intérêt d’étudier la composition, le tissage, la disposition des trames formant le dispositif spatial et assurant sa manifestation perceptible. La matérialité des dispositifs spatiaux constitue à la fois une voie d’incorporation des normes juridiques dans l’espace, mais aussi leur expression publique et leur instrument pour agir sur le monde. Les dispositifs spatiaux sont destinés à motiver certains comportements (entrer ou renoncer à entrer, ralentir ou accélérer, chuchoter ou parler, choisir son itinéraire, etc.), et, pour ce faire, ils doivent être perçus – au moyen de signaux visuels, sonores ou haptiques – par les destinataires de la norme. Le béton du mur, la présence discrète d’un agent de sécurité ou un dispositif de vidéosurveillance invisible, mais signalé par un panneau sont autant de modalités de matérialisation et de perception d’un même dispositif spatial.
Enfin, la fonctionnalité interroge les effets produits par le dispositif institué par l’autorité publique ou privée qui l’a mis en place : interdire, orienter, surveiller ou contrôler. La fonction d’interdiction vise à rendre impossible un certain comportement contraire au modèle requis dans les lieux (interdiction d’accéder à un lieu sans autorisation, interdiction de certains comportements dans ces lieux, etc.). La fonction de surveillance vise à observer, enregistrer, vérifier, stocker, récupérer et comparer des éléments d’identité ou de comportement des personnes en recourant à des moyens humains (policiers, services de renseignements, agents de sécurité privés) et technologiques de hardware (un portique, caméra, drone) ou de software (usage d’algorithme pour traiter les flux de données)98. La fonction de surveillance participe donc à définir le régime de visibilité différencié dans les espaces (le domicile offre une plus grande protection juridique que la rue). Le contrôle vise à interrompre un déplacement, à le ralentir, à spécialiser l’utilisation de certaines portions de l’espace, ou à filtrer certaines choses ou personnes, ou au contraire, de fluidifier les déplacements99.
La décomposition de l’incorporation des normes juridiques dans l’espace et la mise au jour de ces trois aspects permettent de mettre en évidence leur diversité, leur hybridité et leur rôle clé dans la détermination de l’accessibilité des espaces publics. Une telle analyse, en tenant ensemble l’exigence de ne pas confondre les normes juridiques avec d’autres normes (techniques, morales, etc.) ou avec l’étude des comportements résultant de ces normes, tout en enrichissant l’attention quelle porte aux premières en y intégrant l’étude de la manière concrète dont la norme juridique opère directement ou indirectement sur ceux qui y sont soumis. Or, le caractère discret d’un dispositif spatial (parce qu’ils reposent sur le design urbain, par exemple) soulève de nouvelles interrogations : le concept d’ingérence dans les libertés doit-il être révisé pour saisir ces dispositifs ? leur existence et leurs fonctions doivent-ils être portées à la connaissance du public dans un souci de transparence (sur le modèle de ce qui existe en matière de vidéosurveillance) ? Les motifs tenant au bon ordre et au fonctionnement du lieu sont-ils des justifications suffisantes pour considérer qu’ils poursuivent un but légitime ? Comment adapter le contrôle de proportionnalité afin de saisir les effets discrets de ces dispositifs ?
Conclusion
L’intérêt de la spatialisation du droit pour l’effectivité tient à sa capacité à proposer un cadre permettant de tenir ensemble interprétation factuelle et interprétation normative en invitant à des démarches d’enquêtes complémentaires. Elle souligne la physicalité du droit et permet d’envisager l’idée que le droit ne s’arrête pas à l’énonciation, mais continue à se déployer dans le monde matériel à travers des chaînes causales100 . Le droit s’incarne dans les objets (documents, bâtiments, tracés de rues et panneaux, aménagements intérieurs, etc.) et dans les personnes présentes dans un lieu. Un agent de sécurité privé qui contrôle un passe sanitaire ou un groupe de policier qui encercle des manifestants produit une spatialité en mettant en œuvre des normes juridiques101. En effet, la norme juridique motive les agents humains à produire des espaces en traitant d’autres individus à partir de catégories géographiquement situées ou en produisant des espaces dans lesquelles les normes de comportement attendues, ce qui peut y être vu ou fait, relève de règles spécifiques. Ces règles conditionnent la manifestation des libertés, leur perceptibilité (ce qui façonne le régime de visibilité des libertés de l’espace102), en actualisant les possibilités de présence ou l’indésirabilité des individus dans les espaces. Adopter une appréhension spatialisée des libertés permet donc de se saisir des formes de régulations des libertés qui, parce qu’elles sont incorporées dans les espaces, échappent à la compréhension usuelle du droit des libertés.
1 D. Laberge, S. Roy, « Pour être, il faut être quelque part : la domiciliation comme condition d’accès à l’espace public », Sociologie et sociétés, 2001, p. 115–131.
2 S. Blanchard, J. Estebanez et F. Ripoll, Géographie sociale. Approches, concepts, exemples, Paris, Armand Colin, 2021, p. 37.
3 Le concept commun d’espace peut être entendu pour sa part comme se référant à un « fragment, matériellement borné ou pas, d’un espace réel que nous percevons ou que nous pouvons nous représenter mentalement », A. Borillo, L’espace et son expression en français, Paris, Ophrys, 1998, p. 2.
4 J. O’ Keefe, « The Spatial Prepositions in English, Vector Grammar, and the Cognitive Map Theory », in P. Bloom, M. F. Garrett, L. Nadel et M. A. Peterson (dir.), Language and Space, Bradford Books, 1996, p. 280.
5 M. Jammer, Concepts d’espace. Une histoire des théories de l’espace en physique, Paris, Vrin, 2008,
6 J.-F. Pradeau, « Des conceptions de l’espace », Espaces Temps, n°62-63, 1996, p. 52.
7 Thèse que l’on retrouvera chez Montesquieu dans sa théorie des climats, par exemple.
8 H. Lefebvre, « La production de l’espace », L’Homme et la société, 1974. p. 15-32.
9 P.-H. Prélot, F. Richard-Schott, S. Schott, Le droit constitutionnel et la géographie, IFJD, 2022, 306 pages.
10 Y. Madiot, « Vers une “territorialisation” du droit », RFDA, 1995, p. 946.
11 C. Gallo, « Recherches sur la territorialisation du droit », Le territoire, Jurisdoctoria, n° 10, 2013, p. 26.
12 Voir en ce sens les propositions de Florence Richard-Schott et Stéphane Schott lors de leur intervention « Penser le droit constitutionnel et la géographie : pourquoi et comment ? » du Colloque Le droit constitutionnel et la géographie (jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2015, université de Bordeaux, consultable en ligne).
13 V. Dussart, F. Lerique, Justice spatiale et politiques publiques territoriales, Mare & Martin, 2023, 300 pages.
14 P. Melé, « Pour une géographie du droit en action », Géographie et cultures, 2009, p. 25-42.
15 J.-B. Auby « Peut-on parler d’un “ tournant spatial ” dans le droit public ? », Chemins publics, 2022, [en ligne].
16 D. Lochak, « Espace et contrôle social », Centre, périphérie, territoire, CURAPP, 1978, p. 151-203.
17 X. Bioy, « Territoires et identité de la personne », RDP, 2017, p. 873, G. Armand, M. Fouquet-Armand, « L’uniformité territoriale dans la jouissance et l’exercice des droits et libertés fondamentaux en France », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2003, p. 11-32.
18 J.-M. Larralde, D. Custos, « Urbanisme et droits fondamentaux », Cahiers de la recherches sur les droits fondamentaux, 2016, p. 11-19.
19 O. Bui-Xuan, « Extension du domaine de la neutralité religieuse », AJDA, 2019, p. 2401.
20 S. Hennette-Vauchez, « The Mall », RFDA, 2020, p. 833.
21 R. Medard Inghilterra, « L’instauration d’une « technopolice » administrative en milieu urbain : cadre et enjeux juridiques », La Revue des droits de l’homme, 2024, [en ligne].
22 J. Waldron, « Homeless and the issue of freedom », The University of Toronto Law Journal, 1991-1992, p. 39.
23 I. Braverman, N. Blomley, D. Delaney et A. S. Kedar, « Introduction», in I. Braverman, N. Blomley, D. Delaney et A. S. Kedar (dir.), The expanding spaces of law : a timely legal geography, 2014, p. 1-29 . P. Forest, Géographie du droit : épistémologie, développements et perspectives, Laval, PUL, 2009, 296 pages.
24 C. Griffith, S. Klosterkamp, A. Cantor et A. Kocher, « Legal Geographies », in Concise Encyclopedia of Human Geography, L. Lees, D. Demeritt, Elgar, 2023, p. 223-228.
25 N. Blomley, J. Labove, « Law and geography », International encyclopedia of social an behavioural sciences, 2015, p. 474-477.
26 L’ouvrage de Nicholas Blomley (Law, Space, and the Geographies of Power, 1994) est considéré comme l’ouvrage fondateur en la matière.
27 Pour une cartographie des terrains, méthodes et résultats contemporains de la Law & geography nous renvoyons aux recensions régulières parues dans la revue Progress in Human Geography : D. Delaney, « Legal geography I : Constitutivities, complexities, and contingencies », Progress in Human Geography, 2015, p. 96-102 ; D. Delaney, « Legal geography II : Discerning injustice », Progress in Human Geography, 2016, p. 267-274 ; D. Delaney, « Legal geography III : New worlds, new convergences », Progress in Human Geography, 2017, p. 667-675 ; A. Jeffrey, « Legal geography I: Court materiality », Progress in Human Geography, 2017, p. 565-573 ; A. Jeffrey, « Legal geography II: Bodies and law », Progress in Human Geography, 2019, p. 1004-1016 ; A. Jeffrey, « Legal geography III: Evidence », Progress in Human Geography, 2020, p. 902-913; P. Kymäläinen, « Legal geography I: Everyday law », Progress in Human Geography, 2024, p. 352-361 ; P. Kymäläinen, « Legal geography II: The possibilities and disruptions of place », Progress in Human Geography, 2025, p. 323-331..
28 P. Forest, Géographie du droit, épistémologie, développement et perspectives, PUL, 2009, 286 pages, P. Melé, « Pour une géographie du droit en action », Géographie et cultures, 2009, p. 25-42 ; J. Lévy, « Introduction – Des espaces du droit », Revue Géographique de l’Est, 2018, [en ligne] ; L. Bony, M. Mellac, « Introduction. Le droit : ses espaces et ses échelles », Annales de géographie, 2020, p. 5-17 [https://doi.org/10.3917/ag.733.0005]. Exception faite de N. Belaidi, G. Koubi, « Droit et Géographie », Développement durable et territoires, 2015, [en ligne], M.-C. Ponthoreau, Le piège territorial en droit et par le droit, IFJD, 2022, 282 pages.
29 L. Bony, M. Froment-Meurice, M. Lecoquierre, « Les dimensions spatiales du maintien de l’ordre. Introduction », Carnets de géographes, 2021, [en ligne].
30 M. Bonté, « Cartographier les restrictions des usages des espaces publics par les mesures de police administrative », Du béton et des plumes, Consulté le 2 juin 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13ojs.
31 A. Nikolli, C. Girault, « L’accès à la nature au prisme de la crise sanitaire, ou le contrôle politique d’un espace de liberté », Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne],
32 N. Blomley, « Learning from Larry : Pragmatism and the Habits of Legal Space », in I. Braverman, N. Blomley, D. Delaney et A. S. Kedar (dir.), The expanding spaces of law : a timely legal geography, 2014, p. 77-94.
33 D. Delaney, « Le spatial et la pragmatique de la construction de la réalité », in P. Forest, Géographie du droit : épistémologie, développements et perspectives, 2009, PUL, p. 117 – 135.
34 Nous renvoyons ici aux textes de Mariana Valverde, Marie-Ève Sylvestre, William Damon, Nicholas Blomley et Céline Bellot traduits et analysées dans le numéro 23 de la revue Cliothemis en 2022.
35 X. Dupré de Boulois, « Existe-t-il un droit des libertés ? », Le droit des libertés en question(s), RDLF, 2017, Chron. n°4.
36 D. Delaney, « Legal geography I : Constitutivities, complexities, and Contingencies », Progress in Human Geography, 2015, p. 96–102.
37 E. Kolaneci, « The Intersection of Law and Space: Exploring Legal Geography », International Journal of Religion, 2024, p. 531 – 542
38 E. Bulygin, D. Mendonca, Normas y sistemas normativos, Marcial Pons, 2005, p. 15-16.
39 Nous entendrons ici par effectivité, dans une démarche stipulative, « le degré d’influence qu’exerce la norme juridique sur les faits au regard de sa propre finalité » (J. Bétaille, « Le concept d’effectivité, proposition de définition », L’effectivité des droits – Regards en droit administratif , Mare & Martin, 2019, p. 37). Dès lors, quelle serait la finalité du droit des libertés qui nous donne une raison de lui accorder de la valeur ? L’inviolabilité des individus. La notion d’inviolabilité, empruntée à Thomas Nagel, est un statut moral accordé aux individus et qui justifie de considérer que certaines violations sont inadmissibles. L’idée de droits fondamentaux exprime ainsi « une conception particulière du type de place qui devrait être occupée par les individus dans un système moral » (T. Nagel, « Personal Rights and Public Space », Philosophy and Public Affairs, 1995, p. 84-85.). C’est en raison de ce statut, auquel s’adosse le projet politique des droits humains, que l’effectivité est au cœur du droit des libertés (E. Millard, « Effectivité des droits de l’homme », Dictionnaire des Droits de l’homme, PUF, 2012 pp. 349- 352).
40 V. Champeil-Desplats, « Effectivité et droits de l’homme : approche théorique », À la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008, pp. 11-26
41 Ibid.
42 J. Jeanneney, Les lacunes constitutionnelles, Dalloz, 2016, p. 142.
43 F. Recanati, Philosophie du langage (et de l’esprit), Gallimard, 2008, p. 88.
44 V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, G. Giappichelli, 2012, p. 143.
45 V. Champeil-Desplats, Théorie générale des droits et libertés. Perspectives analytiques, Paris, Dalloz, 2019, p. 257.
46 N. Blomley, J. C. Bakan, Joel C, « Spacing Out : Towards a Critical Geography of Law », Osgoode Hall Law Journal, 1992, p. 661-690.
47 R. Guastini, Il diritto come linguaggio. Lezioni, Giappichelli, 2006, p. 15.
48 V. Villa, op. cit., p. 132.
49 Conseil d’État, 13 juin 1913, Castillon du perron, n° 46138.
50 V. Villa, op. cit., p. 43.
51 A. Layard, « Law, place and maps », in R. Bartel et J. Carter (dir.), Space, place and law, p. 129.
52 J. C. Torpey, The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge University Press, 284 pages.
53 M. Chambon, « L’espace et le territoire : le droit public à l’épreuve de l’extranéité », Civitas Europa, 2015, p. 95-121. https://doi.org/10.3917/civit.035.0095.
54 E. Santoire, E., J. Desroche, J. R. Garcier, « Quelles méthodes d’enquête pour les recherches géo-légales ? Retour d’expérience à partir de la mise en concurrence des concessions hydroélectriques en France », Annales de géographie, 2020, p. 228-249.
55 R. Orzeck, L. Hae, « Restructuring legal geography », progress in human geography, 2020, p. 830-851.
56 B. Forest, « Legal geographies. Placing the Law in Geography », Historical geography, 2000, p. 5-12.
57 M. Freeman, Human Rights: An Interdisciplinary Approach, Wiley, 2011, p. 89 et s.
58 F. Lecoucq, « Est-ce que des SDF ont été verbalisés en France pour non-respect du confinement ? », Libération du 24 mars 2020, [en ligne] ; P. Gaskell, « Confinements des plus vulnérables : quelles actions juridiques ? », AJ pénal, 2020, p. 189.
59 P. Auriel, « Le prix de l’ordre. Droits et marginalité dans les lieux publics », Esprit, n° 483, 2022, [en ligne].
60 D. Moeckli, Exclusion from Public Space, A Comparative Constitutional Analysis, Cambridge University Press, 2016, p. 72.
61 I. Braveman, « Who’s afraid of methodology? Advocating a Methodological Turn in Legal Geography », in I. Braverman, N. Blomley, D. Delaney et A. S. Kedar (dir.), The expanding spaces of law : a timely legal geography, 2014, p. 120-141.
62 E. Santoire, J. Desroche, R. J. Garcier, op. cit.
63 Ibid.
64 N. Blomley, G. Clark, « Law, theory and geography », Urban geography, 1990, p. 433-446.
65 K. Brickell, A. Jeffrey, F. McConnell, « Practising legal geography », Area, 2021, p. 557-561.
66 F. Chiodelli, « Research methods for legal geography », Area, 2025.
67 A. Riles, « A New Agenda for the Cultural Study of Law : Taking on the Technicalities », Buffalo Law Review, 2005, p. 973-1033.
68 F. Audren, « Un tournant technique des sciences (sociales) du droit ? », Clio@Themis, 2022, [en ligne].
69 N. Blomley, G. Clark, op. cit. ; R. Orzeck, L. Hae, op. cit.
70 D. Delaney, « Legal geography I : Constitutivities, complexities, and contingencies », Progress in Human Geography, 2015, p. 96–102.
71 M. Valverde, « Despotism’ and ethical liberal governance », Economy and society, 2006, p. 357-372.
72 S. B. Schindler, « Architectural Exclusion : Discrimination and Segregation through Physical Design of the Built Environment », The Yale Law Journal, 2015, p. 1836.
73 D. Lochak, « Espace et contrôle social », CURAPP (dir.), Centre, périphérie, territoire, PUF, 1978, p. 192.
74 La prévention situationnelle ambitionne d’empêcher le passage à l’acte incivil ou délinquant en agissant sur l’environnement, en accroissant les risques d’appréhension, en rendant plus difficile la commission de l’infraction ou en réduisant son bénéfice.
75 O. Milhaud, « L’enfermement ou la tentation spatialiste. De “ l’action aveugle, mais sûre ” des murs des prisons », Annales de géographie, 2015, 140-162.
76 H. Lefebvre, op. cit., p. 69-70
77 O. Razac, Histoire politique du barbelé, Flammarion, 2009, p. 84-85.
78 J. Waldron, op. cit.
79 D. Lochak, op. cit., p. 168.
80 J.-S. Bergé, Les situations en mouvement et le droit, Dalloz, 2021, p. 178-180.
81 A. Daillère, M. Boutros, « Amendes, évictions, contrôles : la gestion des “ indésirables ” par la police en région parisienne », Étude pour le DDD, 2025, 38 pages.
82 C. Thibierge, « Les “normes sensorielles”. Exploration de la normativité du quotidien aux confins du droit », RTD Civ, 2018, p. 567.
83 Dans Surveiller et punir où Michel Foucault écrit que « la discipline procède d’abord à la répartition des individus dans l’espace » par la clôture ou le quadrillage par exemple. Il précise plus loin que la discipline est l’ « art du rang et technique pour la transformation des arrangements. Elle individualise les corps par une localisation qui ne les implantent pas, mais les distribue et les fait circuler dans un réseau de relations ». M. Foucault, Surveiller et punir (1975), Paris, Gallimard, 1993, p. 171.
84 S. Lemoine, Le sujet dans les dispositifs de pouvoir, PUR, 2013, p. 25.
85 M. Foucault, « Le jeu de Michel Foucault », Dits et écrits (1954-1988), t. 2, Gallimard, 2001, p. 299.
86 M. de Certeau, L’invention du quotidien. Arts de faire, t. 1, Gallimard, 1990, p. 77.
87 M. Lussault, « Espace public », in J. Levy, M. Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin, 2013, p. 363-364.
88 Voir en ce sens L. Bony, M. Froment-Meurice et M. Lecoquierre, « Les dimensions spatiales du maintien de l’ordre. Introduction », Carnets de géographes, 2021, [En ligne].
89 C. Thibierge, « La densification normative. Découverte d’un processus », Recueil Dalloz, 2014, p. 840.
90 C. Thibierge, « Les “normes sensorielles”. … », op. cit.
91 L’arrêt du Conseil d’État du 21 mars 2016, Société Fairvesta International est précurseur dans l’usage de cette notion. C’est toutefois l’arrêt GISTI de 2020 qui lui donnera l’ampleur qu’on lui connaît (Conseil d’État, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, considérant 1). Confirmé par Conseil d’État, 23 septembre 2021, Forseti, n° 441255.
92 F. Grabias, « (Dés) ordre et tolérance », AJDA, 2020, p. 2069.
93 O. Razac, op. cit., p. 213-214.
94 P. Landauer, L’architecte, la ville et la sécurité, Paris, PUF, 2009, p. 18-19.
95 L’article 3 de l’arrêté énuméré environ 200 « point d’accès » désignés par leur adresse ou leur orientation par rapport d’autres lieux. Par exemple : « 75 quai de la gare, sur les quais bas, aux abords de la piscine Joséphine Baker ».
96 A. Borillo, L’espace et son expression en français, Ophrys, 1998, p. 1.
97 J. Paillard, « Le design urbain : un dispositif disciplinaire et sécuritaire “interstitiel” ? », Sciences du Design, 2023, p. 38-62.
98 D. Lyon, « Surveillance Studies: Understanding visibility, mobility and the phenetic fix », Surveillance & Society, 2002, p. 1-7.
99 P. Landauer, op. cit., p. 9.
100 D. Delaney, « Beyond the word: law as a thing of this world », in J. Holder, C. E. Harrison (dir.), Law and geography, OUP, 2003, p. 78.
101 L. Bony, M. Froment-Meurice et M. Lecoquierre, op. cit.
102 M. Lussault, « Visibilité (régime de) », in J. Levy, M. Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin, 2013, p. 1091.



