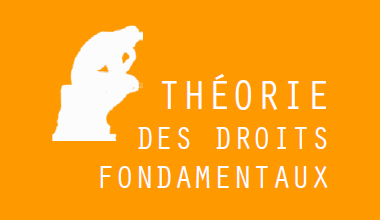M. Christelle, « Le consentement », Paris, Humensis, Que-Sais-je, 2023, 128 p.
Par Sacha Sydoryk, Maître de conférences en droit public, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS (UMR 7319)
- Le consentement est un sujet évidemment d’actualité. Il fallait donc que la collection Que sais-je ? Lui consacre une étude spécifique, et c’est chose faite grâce à la publication de cet ouvrage sobrement intitulé Le consentement, sous la plume de Maxence Christelle[1]. Il faut noter qu’il s’agit d’une réflexion déjà bien connue de l’auteur, puisque ce dernier a soutenu en 2014 sa thèse de doctorat sur le sujet Consentement et subjectivité juridique : contribution à une théorie émotivo-rationnelle du droit. La réflexion de l’auteur est donc mûrie et n’est pas intrinsèquement liée au contexte politico-social qui voit le consentement revenir largement dans le champ des réflexions. Il est également notable que l’ouvrage ne soit pas un ouvrage de droit public, ni de droit privé. Adoptant un angle philosophique pour élucider l’origine du concept de consentement, il balaye ensuite certaines de ses manifestations dans les différents champs du droit français – mais sans être une étude exhaustive des dispositions normatives spécifiques. Cette approche qui fait fi de la summa divisio est salvatrice pour l’étude, ouvrant ainsi les horizons d’une étude de théorie du droit, dans son ensemble.
- La structure de l’ouvrage illustre cette volonté théorique. Il se compose d’une introduction expliquant la démarche générale, de trois chapitres sous-divisés et d’une conclusion. Le premier chapitre vise l’« archéologie du concept de consentement », le deuxième chapitre est consacré à « la diversité des usages et des significations du consentement », incluant les usages du concept en droit positif, et enfin le troisième chapitre aborde « le doute moderne porté sur le consentement ».
- La démarche de l’auteur est claire, et annoncée dès les premières pages. « Il n’y a pas un concept de consentement, mais plusieurs » (p. 8) et alors « ce livre consiste en une recherche sur certains des différents concepts de consentement qui apparaissent en philosophie ou en droit » (p. 10). Tout au long de l’ouvrage, la distinction entre le mot « consentement » et le concept potentiellement visé est toujours présente. Le mot n’est pas le concept ; un même mot peut désigner plusieurs concepts différents ; un même concept peut être désigné par plusieurs mots.
- La thèse de l’ouvrage est également explicitée dès l’introduction. Le consentement – ou les consentements – a un noyau dur, à l’interface entre l’individu et la collectivité : l’individu consent d’abord vis-à-vis de lui-même et « accepte » volontairement quelque chose ; le consentement est apprécié par le groupe pour en déterminer la réalité, la validité, et les effets éventuels. Pour l’auteur, le consentement est donc lié à une volonté, à son expression, mais également à la manière donc le groupe social comprend et accepte cette volonté.
- Le corps de l’ouvrage est donc composé de trois chapitres. Le premier porte sur l’« Archéologie du concept de consentement », et l’auteur s’intéresse à la manière dont le consentement est né dans la philosophie grecque, pour être repris par la philosophie et le droit romain, adopté par la théologie chrétienne puis enfin inséré dans le Code civil de 1804. La méthode de cette recherche historique est explicitée, elle part de l’observation du terme pour ensuite analyser la manière dont il est repris et les sens qui lui sont attribués. Cela conduit l’auteur à soutenir l’existence historique d’un lien entre consentement et volonté, à travers les écrits d’Aristote (p. 13). Le concept de consentement n’est pas explicitement présent, mais l’idée est en germes. Les deux concepts demeurent donc, ab initio, liés. Chez les stoïciens, ce concept de consentement passe par celui d’assentiment, dont il est proche, et c’est finalement Cicéron, par son œuvre de traduction du grec vers le latin, à travers le mot « catathesis», qui sert à traduire l’assentiment grec des stoïciens. Sur le plan juridique, ce consentement innerve le consensualisme du droit romain, mais meurt à la chute de l’empire, pour revenir par la scolastique. Il se retrouve ainsi au cœur du droit civil moderne, et il est aujourd’hui appréhendé en première analyse sous l’angle contractuel, ce qui n’est pas sans incidence sur la pensée juridique en général.
- Le deuxième chapitre traite de la « diversité des usages et des significations du consentement ». La démonstration de ce chapitre permet de comprendre la thèse qui y est avancée, qui est que « la signification du concept de consentement apparaît fragmentée et la recherche d’une unité vaine » (p. 29). Qu’il s’agisse de l’analyse philosophique ou de l’analyse juridique, largement détaillées, le mot « consentement » ne renvoie jamais exactement à la même chose. C’est dans l’analyse juridique que cela apparaît le plus flagrant pour le juriste, et l’exposition consécutive du consentement en droit civil, en droit constitutionnel, en droit de la santé et en droit pénal dans les questions spécifiques du viol en est une démonstration implacable. Le droit français – mais la position de l’auteur peut sans aucun doute s’entendre au-delà de ce simple droit national – met alors en œuvre des concepts juridiques très différents derrière un même terme utilisé pour le désigner, dans les énoncés ou dans la doctrine.
- Par exemple, en droit civil, matrice du consentement juridique, le consentement désigne déjà deux éléments distincts, qui sont d’une part l’expression d’une volonté individuelle et d’autre part la réunion de ces deux volontés. De plus, la faculté de consentir est limitée à la possession de la capacité juridique. En droit constitutionnel, le concept de consentement est présent malgré les silences de la doctrine pour utiliser le mot – exception faite du consentement à l’impôt de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme. Pour autant, le vote apparaît comme un consentement donné au nom du peuple, et qui engage même les personnes n’ayant pas consenti directement. En droit de la santé, le consentement est issu du droit civil contractuel, mais des spécificités s’y sont développées. Notamment, l’accord de la personne est toujours recherché, au-delà des questions civiles de capacité juridique, par exemple les directives anticipées. Enfin, en droit pénal, et spécifiquement dans le cas du viol, le terme n’est pas utilisé, mais l’idée sous-jacente derrière les articles 222-22 à 222-26-2 du Code pénal est une protection des situations dans lesquels il n’a pas pu y avoir de consentement à la relation sexuelle. Pour autant, l’auteur montre bien le lien initial avec l’idée générale du consentement civil, puisqu’il existait des situations dans lesquelles le consentement était admis automatiquement : c’était le cas du mariage, qui était considéré comme valant automatiquement consentement, à travers le « devoir conjugal », et les évolutions jusqu’à aujourd’hui pour désigner une volonté, sans regard pour la capacité juridique ou l’âge, mais au regard de la possibilité réelle, contextuelle, d’avoir accepté l’acte. On le voit donc – et ces quelques développements ne font pas justice aux détails de l’ouvrage – chacune de ces branches du droit met en œuvre une version spécifique de consentement, sans pour autant qu’il ne soit possible de dire que les concepts sont identiques.
- Le troisième et dernier chapitre aborde « le doute moderne porté sur le consentement », tant dans des aspects philosophiques que dans des aspects juridiques. Ces développements sont notamment l’occasion de souligner le dilemme posé au consentement par les sciences sociales et la question du déterminisme, ou de la rationalité des acteurs. L’auteur y montre notamment comment tout déterminisme absolu niant la liberté de l’individu entraîne une dissolution du concept de consentement. L’auteur n’hésite pas à aborder frontalement les questions prégnantes contemporaines, comme celle du « consentement féminin » (p. 90) et la question plus large de la manière dont il est possible de concevoir juridiquement le concept de consentement dans un contexte de remise en cause d’égalité réelle de certaines situations. Sur le plan juridique, ce sont les questions de temporalité du consentement, de capacité juridique à consentir, mais également de moralité à la chose consentie, qu’il s’agisse de lancée de nain, de prostitution ou de sadomasochisme. L’auteur y souligne justement que dans ces situations, le consentement est utilisé en lui-même pour « souligner l’indignité, la responsabilité morale de ceux qui l’ont exprimé » (p. 117), illustration du caractère extérieur, social, du consentement.
- L’ouvrage permet donc une vue historique, philosophique et juridique du consentement. Il ne s’agit pas d’une présentation du consentement en philosophie ou en droit civil des contrats, mais bien une présentation philosophique du concept dans le but d’étudier ses effets sur le droit en général, en recherchant le plus petit dénominateur à ce que l’on appelle généralement « consentement ». Ces réflexions bienvenues intéresseront ainsi toute personne souhaitant une contextualisation scientifique dans les débats contemporains sur les questions du consentement, tant en matière de viol qu’en matière bioéthique de fin de vie ou de vaccination, thèmes qui ne sont d’ailleurs pas spécifiquement développés au-delà de la généralité des aspects de droit de la santé – limitation du format « Que sais-je ? » oblige. Ce format limite nécessairement l’étendue de la réflexion et la bibliographie. Plus spécifiquement, l’ouvrage intéressera aussi le juriste souhaitant nourrir des réflexions transversales sur le consentement, sans s’ancrer spécifiquement dans un système juridique national.
[1] Il nous faut préciser ici, à toute fin de transparence, être dans le même laboratoire que l’auteur de l’ouvrage.