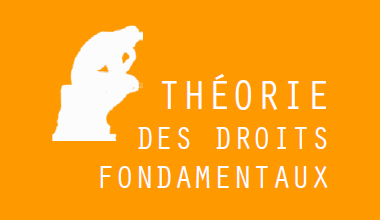Quelques considérations sur une certaine manière d’enseigner les libertés en France
Ce texte constitue une retranscription allongée d’une intervention prononcée lors d’une table ronde « table-ronde regard critique » à l’occasion d’un colloque relatif à l’enseignement du droit des libertés, organisé à Grenoble le 10 novembre 2023 par le CRJ (EA 1965) et le CESICE (EA 2420) en collaboration avec la Société d’histoire des Facultés de droit. Les actes de cette manifestation seront publiés dans la Revue d’histoire des facultés de droit.
Par Xavier Souvignet, Professeur de droit public, Faculté de droit Julie Daubié, Université Lyon 2-Lumière, Transversales
Il semble particulièrement périlleux de tenter de dresser un état de l’enseignement des libertés en France dans les Facultés de droit, même succinct. Voilà pourquoi il ne sera question dans ces quelques lignes que de quelques considérations. D’abord, il est une curieuse évidence que de l’écrire : un enseignant-chercheur n’assiste pas a priori aux cours de ses collègues. Certes l’autoanalyse est toujours possible mais les conclusions que l’on pourrait en tirer peuvent avoir un intérêt assez limité pour les autres. Demeurent alors les manuels qui ont pour effet, sinon pour vocation, précisément de codifier une didactique ; et l’on peut conjecturer sans grand risque que l’enseignement des libertés se rapproche à peu près de ce que livrent les manuels, même si la différence de volume entre un cours de trente heures et un ouvrage de plusieurs centaines de pages ne peut emporter que d’évidentes conséquences qualitatives. Car il faut bien faire des choix et livrer un contenu à des étudiants qui ne se destinent pas tous à des masters de Droits de l’Homme ou de Droits fondamentaux ; contenu dont la compréhension est susceptible d’être évaluée par l’un des exercices canoniques des Facultés de droit …
Par ailleurs, celui qui se risque à un pareil propos, forcément général, arasant, simplificateur et déformateur ne saurait qu’abstraire – c’est-à-dire occulter – en de grossières lignes une réalité forcément plus complexe. Enfin le fait de ne pas avoir publié soi-même (encore ?) de manuel impose une forme de modestie qui pourrait volontiers être mise en porte-à-faux par la dimension nécessairement critique de la réflexivité[1].
I. Paradoxale généralité
La manière d’enseigner les libertés en France n’est pas séparable de la question de son accès au statut de discipline autonome de la matière appelée formellement « droit des libertés fondamentales »[2], même si à l’évidence, celle-ci n’épuise pas à elle-seule l’enseignement de cet objet dans les Facultés ; on peut songer à ce stade à la matière appelée « droit européen et/ou international des droits de l’Homme », par exemple, qui fait souvent l’objet d’un enseignement autonome et qui a pu justifier la publication de nombreux manuels. Or la situation est assez curieuse en France puisque le droit des libertés est, à bien des égards, conçu comme une matière généraliste, alors même que l’existence d’un cours obligatoire de « Libertés fondamentales » en troisième année de Licence, participe nécessairement du développement – ni achevé ni même achevable – d’une forme de spécialisation (certains collègues s’affirment ainsi « spécialistes » du droit des libertés) ; une telle spécialisation apparait d’ailleurs comme l’une des dimensions de la spécialisation généralisée – si l’on ose l’expression – dans les Facultés de droit, laquelle puise ses racines dès la fin du XIXe siècle – moment de l’éclatement des concours d’agrégation – mais qui s’est accusée par la suite dans une parcellisation des savoirs toujours plus complexe.
Une matière donc, c’est-à-dire une substance ; ainsi il existe bien objectivement des régimes définis par des normes juridiques se rapportant à ce que la Constitution qualifie de « libertés publiques » et ceux-là sont susceptibles d’être étudiés par le juriste. C’est ainsi d’ailleurs qu’un Rivero justifiait l’existence d’un cours de Libertés publiques[3] : il y avait matière – un peu comme on dirait qu’il y a avait une occasion – d’instituer un cours dédié à des régimes que les autres cours ne prenaient pas en charge, en particulier la liberté de la presse laquelle consistait essentiellement en un contentieux judiciaire fondé sur l’application de la loi du 29 juillet 1881 ; cela faisait tout de même beaucoup pour une certaine culture publiciste, même si elle était encore jeune. La naissance d’un enseignement spécifique en 1954[4], rendu obligatoire en 1962[5], se fondait donc sur un angle mort. Mais paradoxalement, cet angle mort avait été constitué par la généralité même d’une matière qui avait essaimé dans tout l’ordre juridique : le juriste était en effet censé rencontrer les autres libertés à l’occasion, notamment, de la lecture de décisions juridictionnelles de toute nature – ce point est central – lesquelles se trouvaient susceptibles d’être exposées en détail par d’autres disciplines s’exposant en forme de dogmatique.
La généralité paradoxale de la matière trouve d’ailleurs sa preuve dans l’origine de ce cours de troisième année, lequel avait consisté d’abord en un cours optionnel de droit public général[6]. La chose était donc entendue : faire des libertés signifiaient essentiellement faire du droit public général. On retrouve curieusement cette vieille empreinte dans le concours d’accès à la magistrature où le programme de l’épreuve de « droit public » comporte « le régime juridique des Libertés publiques ». On connait assez le fondement de cette conception : les libertés publiques correspondaient à l’idée selon laquelle la loi – acte public par excellence – réglementait l’exercice de la liberté conçue comme « pouvoir d’auto-détermination » ; s’en suivait la définition ramassée de Rivero, selon laquelle les libertés publiques sont des « pouvoirs d’autodéterminations consacrés par le droit positif »[7] ; de là s’expliquait l’administrativisation de la matière puisque l’effectivité de la législation s’éprouvait essentiellement dans le contrôle de légalité exercé par le juge administratif.
Mais cette publicisation, avant administrativisation, de la matière apparaît finalement très étonnante : si la loi est un acte public, elle a bien par nature vocation à la généralité. Or sous cet aspect, les normes civiles et pénales – car le code c’est bien la loi – constituent largement du droit public ordonné pour ce qui est des premières à la protection de la propriété privée et pour ce qui est des secondes à la protection de la « liberté individuelle », selon la lettre de l’article 66 de la Constitution, inspirée par un juriste publiciste. Mais il est vrai que ces matières jouissant du code et du prestige d’une tradition romaniste, c’est-à-dire d’une technologie propre autant que d’une classe d’experts, pouvaient prétendre former un monde relativement préservé des caprices et des tempêtes de l’histoire constitutionnelle[8]. Ainsi l’abandon de la notion de droits de l’Homme pour celle de liberté publique a eu pour effet pédagogique – en plus d’en positiver l’appréhension[9] – de scinder académiquement l’étude des libertés ; avant l’entreprise de réunification par l’émergence des droits et libertés fondamentales.
Ceci explique sans doute que le « droit des libertés fondamentales » ne constitue pas une matière éligible dans les différents concours d’agrégation de droit. Au mieux – pour s’en tenir à celui du droit public que l’auteur de ces lignes connait le mieux – le choix de la matière « droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique » présente des chances intéressantes de commenter une disposition d’une déclaration de droits ou d’une décision du Conseil constitutionnel relative à une question prioritaire de constitutionnalité. A la limite la matière « droit communautaire et européen » donne l’espoir au spécialiste du droit des libertés de plancher sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme même s’il prend le risque de devoir disserter sur la notion de « marché » en droit de l’Union européenne.
A l’inverse, la « protection des libertés et des droits fondamentaux » constitue une matière pour l’examen d’accès au CRFPA et occupe même la place d’épreuve d’admission sous forme de Grand oral. Mais cette position a priori flatteuse pourrait donner l’idée qu’elle semble être conçue – avec l’épreuve d’anglais – essentiellement comme une sorte de grand examen d’« humanités » par laquelle les futures femmes et hommes de loi, qui ont fait leur preuve de leur maîtrise de la dogmatique, se trouve finalement distingués. Celle-ci doit, en effet, « permettre d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale »[10] : culture, art oratoire, anglais qui semble tenir lieu de latin ; tout semble conçu comme si la connaissance du droit de Libertés comptait comme un élément de la culture générale du juriste, devant lui permettre de témoigner du libéralisme de l’ordre juridique et celui de sa classe. En ce sens le doit des libertés semble jouer – du moins en apparence – comme une matière par laquelle un juriste se reconnait[11].
L’institutionnalisation d’un cours devenu « droit des Libertés fondamentales » en troisième année de Licence a provoqué lui-aussi des effets contrastés. Il a certes conduit à autonomiser pédagogiquement – sinon académiquement – la matière, sans lui donner totalement au fond le statut de discipline[12]. La discipline étant précisément une matière en règles avec son lot de catégories, principes et rapports, le droit des libertés apparaît fort peu réglé, à commencer par son intitulé même[13]. Dans le même temps les autres matières juridiques, subissant le contrecoup de cette autonomisation, ont souvent opéré une synthèse dynamique entre une fondamentalisation de leur contenu et un conservatisme relatif de la forme.
Ainsi la fondamentalisation de l’ordre juridique – l’idée que les droits fondamentaux fondent et imprègnent l’ordre juridique dans son ensemble – représente un phénomène qui est devenu un topos – ce qui ne veut pas d’ailleurs dire qu’il soit faux – de la doctrine juridique française du début du XXIe siècle. Pourtant, les manuels des autres disciplines dominées par la dogmatique – en particulier les manuels de droit civil et de droit administratif – reposent toujours généralement sur les grandes summa divisio, relativement indifférentes – à première vue – à la question des droits et des libertés fondamentales. Pour s’en tenir à ces deux exemples – mais qui constituent les matières fondamentales de l’enseignement dans les Facultés de droit – l’on constatera que les manuels de droit civil, singulièrement le droit des obligations, conservent leurs grandes catégories ordonnatrices que sont la formation/effet du contrat et le fait générateur de responsabilité/modalité d’obligation ; il faut bien souvent se reporter au paragraphe d’une introduction et quelquefois à une petite division dans le développement pour trouver des développements consacrés aux « droits fondamentaux »[14]. Les manuels de droit des personnes et de la famille sont plus massivement touchés, y compris dans leurs structures, leurs développements – on pense aux « droits de la personnalité » en particulier – apparaissant presque comme une présentation de la réception législative et jurisprudentielle du droit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Quant aux manuels de droit administratif, ceux-là sont le plus souvent construits – en dépit d’une évidente diversité – autour des distinctions canoniques police/service public, acte administratif unilatéral/contrat, légalité/responsabilité… Certes la protection des libertés est toujours envisagée dans maints chapitres – et dans les introductions saluant le « libéralisme du juge administratif » au XXe siècle – et souvent bien longuement, mais elle ne saute pas toujours aux yeux dans les structures[15].
La fondamentalisation de l’ordre juridique s’étant accompli par sa constitutionnalisation – le concept est assez étrange d’ailleurs car on peine à imaginer un ordre juridique non constitutionnalisé – l’importance des droits et libertés fondamentales se traduit peut-être plus volontiers dans l’enseignement du droit constitutionnel. Historiquement c’est d’ailleurs par cette discipline – que l’on songe par exemple au cinquième tome Traité de droit constitutionnel de Duguit[16]– que le régime des libertés trouva à être exposé. Mais cette reconnaissance s’est davantage fondée sur une redéfinition contentieuse de la matière, prenant acte que le droit constitutionnel – le droit constitutionnel « substantiel » de Favoreu – était devenu essentiellement un contentieux des droits et des libertés – phénomène évidemment accentué par la Question prioritaire de constitutionnalité – que par une théorisation de la « constitution » comme instrument fondamental de « garantie des droits ». Dans cette perspective les droits fondamentaux n’apparaissent plus vraiment comme quelque chose entretenant un rapport avec les fondements et les fins de l’ordre juridique mais comme un objet particulier « saisi par le droit », comme les normes constitutionnelles peuvent se saisir de l’archéologie préventive, des néonicotinoïdes ou des concessions funéraires.
II. Diversités contrariées
L’institutionnalisation du cours de troisième année devenu « droit des Libertés fondamentales » a eu surtout pour effet la production de manuels dédiés ; celui qui les fréquente ne peut que constater une grande diversité que l’on ne retrouve guère à ce degré dans les autres matières dogmatiques avec leurs nécessaires figures imposées.
D’abord – mais cela n’est en rien propre à la matière – il convient de noter une diversité d’un manuel à un autre de volume ce qui, d’après l’adage engelsien, ne peut emporter que des différences qualitatives. On ne s’attardera pas ensuite quant à la disparité dans la conceptualisation de l’objet, lequel ne peut être défini stipulativement dès lors que les « droits et libertés fondamentales » – à supposer que cela soit bien l’objet de la matière – ne sont pas définis en tant que tels par les normes juridiques : ainsi peut-on lire des manuels de droits de l’Homme, libertés publiques ou fondamentales et même de droits humains (et libertés)[17]. Curieusement cette disparité dans la conceptualisation de l’objet n’empêche pas pour autant les auteurs de ces manuels d’analyser les mêmes libertés à l’aide des mêmes arrêts… La diversité des cadres d’analyse – même s’il elle n’est pas toujours explicitée, ce qui n’est pas là encore propre à la matière – frappe également, tout comme l’expression des motivations, lesquelles peuvent quelquefois laisser transparaître une forme d’engagement axiologique prononcé. Il faut enfin noter une relative diversité dans l’appréhension des sources, selon, le plus souvent, la formation initiale de l’auteur.
Cependant, il n’est pas certain que l’on enseigne les droits et les libertés de manière si différente que celle avec laquelle on enseigne les autres matières dominées par la dogmatique juridique. Il n’est évidemment pas question de nier qu’il existe des régimes juridiques que les étudiants se doivent de maîtriser, notamment à travers l’étude des décisions de justice, qui seront proposées à leur attention, notamment dans des travaux dirigés. Mais cela emporte-t-il comme nécessité une optique très souvent jurisprudentialiste ? Celle-ci voit dans la décision de justice l’instance de la révélation de la signification des énoncés, voire de la production de la norme, quand ce jurisprudentialisme est un réalisme. Que les énoncés juridiques dotés d’une très grande généralité et d’une grande abstraction, et singulièrement ceux qui entendent proclamer des droits et des libertés, apparaissent largement indéterminés, constitue une évidence. Mais, si « dans le monde du code il faut viser le code »[18], dans le monde de la déclaration, conviendrait-il peut-être de viser plus nettement la déclaration. Il est vrai que le paradigme de l’Etat de droit assimilant assez largement le droit au juge, l’enseignement des libertés se retrouve presque agi par cette figure, non seulement oracle de la signification mais protecteur des valeurs de l’ordre juridique. Dès lors, les textes fondateurs – et leur intelligence – tendent à disparaître derrière la sédimentation jurisprudentielle. Evidemment l’on en mentionne systématiquement l’existence, notamment à l’important chapitre des « sources ». Mais il est tout de même curieux qu’un texte comme la Déclaration de 1789 – et même d’une certaine manière la Convention européenne des droits de l’Homme – eu égard à son autorité qui surpasse d’ailleurs sa valeur normative, ne fasse généralement l’objet de plus amples développements concernant par exemple son élaboration, son destin et surtout la signification de ses énoncés. Mais au fond, tout se tient si l’on considère que ces textes ne sont pas porteurs de sens en eux-mêmes.
Cette concentration sur la décision juridictionnelle tend à exclure d’ailleurs le point de vue d’autres interprètes que la dogmatique des libertés érige pourtant en garanties – non-juridictionnelles – de celles-là. L’on n’insistera même pas sur les garanties politiques qui, selon paradigme de l’Etat de droit, n’en sont pas. Certes les droits politiques – notamment tels que saisis par l’article 3 Protocole n°1 de la Convention européenne – constituent des droits fondamentaux ; mais ceux-là enseignent-ils quelque chose quant à la liberté politique, qui pour être politique constitue bien l’une des dimensions de la liberté ? Dans cette perspective, que dire d’un droit de résistance à l’oppression, pourtant formellement proclamé comme droit par la Déclaration de 1789 – et presque par prétérition par la Déclaration universelle de 1948 – mais également rappelé par le Conseil constitutionnel[19] ?
Chaque manuel enfin consacre une section, qui peut d’ailleurs être relativement importante, aux rôles des autorités administratives indépendantes. Mais ni le droit souple qu’elles produisent, ni leur activité quasi-juridictionnelle ne constituent, loin de là, une véritable matière faisant l’objet de systématisation.
Le droit des Libertés fondamentales ne pouvait pas ne pas disposer alors de son recueil de grands arrêts, édité d’ailleurs dans la même collection que ses célèbres devanciers[20], témoignage de la dimension technologique de la matière ; même si, à l’évidence, un recueil d’arrêts dans une matière non structurée autour du culte de la jurisprudence d’un juge unique ne saurait avoir la même fonction ni la même signification que celles que les GAJA occupent pour le droit administratif, pour prendre l’exemple le plus évident.
Toujours est-il que l’une des difficultés de l’optique jurisprudentialiste – et cela n’est pas propre à notre matière – consiste tout de même dans l’identification des critères adoptés dans la sélection des arrêts à travers lesquelles coulera la matière (car au fond là apparaît la véritable source du droit des Libertés) : tel arrêt constitue-t-il un exemple ? Contient-il l’ensemble des principes gouvernant le régime de tel droit ? Est-il le plus généreux en ce qu’il aurait le plus et le mieux pourvu au rayonnement de tel droit ?
L’indiscutable grande diversité des manuels disponibles s’articule pourtant avec des plans d’études qui s’ordonnent globalement autour d’une théorie générale des libertés fondamentales (quelque soit l’appellation retenue), puis d’une suite de régimes juridiques relatifs à une sélection de droits et libertés. Cette théorie générale s’affirme essentiellement d’ailleurs comme une théorie des sources. Là encore, la manière d’enseigner des libertés diffère assez peu de la dogmatique juridique générale : le droit se découvre à travers ses « sources », nécessairement formelles et hiérarchisées. Cette métaphore ciceronienne (le droit coule de lui-même) constitue sans doute de celle qui ont le plus puissamment façonné l’enseignement et la pédagogie dans les Facultés de droit à partir de la seconde partie du XXe siècle. C’est elle qui a largement déterminé par la suite la transformation de la matière en « Libertés fondamentales » en organisant l’unification de cette liberté qui imprègne l’ensemble des actes du législateur. D’autant plus qu’à travers ces sources, ce sont plutôt les juges qui apparaissent justifiés par la théorie générale, chacun de ceux-là incarnant la source dont il est censé être le puisatier. C’est ainsi que l’on peut comprendre la place absolument centrale de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, juge supra-national érigé pour « la sauvegarde et le développement selon le préambule des droits de l’Homme et des liberté fondamentales » dans la matière, en dépit d’une autorité formellement relative de ses arrêts.
A l’inverse, les propositions de théorisations des droits fondamentaux en France qui pourraient se réclamer d’une certaine théorie générale du droit, ne semblent pas avoir véritablement eu d’influence déterminante sur la manière de penser et de présenter la matière[21].
La théorie générale justifie ensuite l’exposé de régimes juridiques ; exposé qui résulte forcément d’un choix de l’auteur puisqu’il est évident que l’on ne peut lister de manière exhaustives les libertés, si bien la liberté consiste à faire « tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Tout au plus peut-on présenter les libertés reconnues explicitement par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’Homme (et pourquoi pas celles du juge administratif du référé-liberté). Mais même dans cette perspective, on peut s’interroger quelquefois sur la place relative de quelques droits ou libertés, dont on aurait pu s’attendre à davantage de centralité compte tenu de la valeur que leur confèrent certains textes pourtant éminents. Pour nous en tenir à un seul exemple, on sait qu’au terme de la Déclaration de 1789, la propriété est « sacrée », fruit d’une longue réflexion qui puise chez les théologiens espagnols (le domaine propre laissée à l’Homme) pour se révéler en termes plus laïcs chez Locke. On peine néanmoins très souvent à déceler cette centralité dans les manuels de droit des Libertés, ne serait-ce que pour la contester philosophiquement ou politiquement : on peut, à ce titre, considérer que la propriété est affaire de convention. L’explication de ce décalage réside dans le fait que le droit positif ne rend tout simplement pas compte de cette fondamentalité, dès lors que le Conseil constitutionnel n’exerce dans ce domaine qu’un contrôle de la « dénaturation » – c’est-à-dire un contrôle restreint[22] – et que la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît généralement une large marge nationale d’appréciation dans le contentieux de l’article 1er du Protocole n°1[23].
On constate enfin et surtout une place généralement très limitée de l’approche historique. Cela s’avère finalement très logique si, encore une fois, l’on considère à la fois que la matière est faite de jurisprudence et que la signification des énoncés est révélée par l’interprétation du juge. Elle l’est sans doute moins si l’on pose que pour identifier la signification d’un texte tel que la Déclaration de 1789, il n’est sans doute pas absurde de connaître les hommes de 1789, leurs lectures ainsi que leurs intentions ; même s’il est clair que ces hommes de 1789 ne savent pas forcément le texte qu’ils font. Certes les manuels de droit des libertés comportent quelques développements historiques mais ceux-là ne participent pas véritablement d’un cadre d’analyse. Que l’on ne se méprenne pas : il n’est pas question dans ces quelques lignes d’en appeler à une absurde et dépassée interprétation fondée sur l’original intent. Mais enfin, si les catégories juridiques peuvent être certes relativement soustraites à l’histoire, elles demeurent produites par l’histoire. Il s’en suit une place variable mais relativement limitée de l’histoire de la pensée juridique pour ne pas dire de la philosophie des droits de l’Homme. Il ne s’agit pas encore une fois de faire de l’Histoire et de la philosophie en quelque sorte gratuitement, parce que les étudiants ne perdraient rien à être plus cultivés ; mais plutôt de penser comment les humanités ou une partie d’entre elles, pour l’écrire rapidement, pourrait aider à l’intelligence du droit positif. Retrouver quelle idée de l’Homme gît dans les textes – qu’après tout, les juges sont bien censés appliquer (si ce n’est pas toujours ce qu’ils font, c’est au moins ce qu’ils disent faire) – semble en effet de quelque utilité afin de déterminer et d’évaluer les moyens juridiques (les normes) propres à le protéger.
*
Ces quelques observations, bien trop brèves, appellent finalement à considérer que si le droit des Libertés fondamentales peut aspirer à occuper une place de droit commun au sein des Faculté, il ne peut le faire qu’en réconciliant la maîtrise des moyens avec l’intelligence des fins.
[1] L’auteur de ces lignes remercie les directeurs de cette revue, par ailleurs auteurs d’excellents manuels.
[2] Arrêté du 19 février 1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales droit et aux licences et aux maîtrises du secteur droit et science politique.
[3] J. Rivero, Cours de Libertés publiques, polyc., 1963-1964.
[4] Décret du 27 mars 1954.
[5] Décret du 10 juillet 1962.
[6] X. Dupré de Boulois, « La naissance du droit de l’enseignement du droit des libertés en France : faux départ et nouvelle donne », RDLF 2023, chron. 49.
[7] J. Rivero, Libertés publiques, 3e ed., Paris, PUF, 1981, p. 16.
[8] N’a-t-on pas prétendu d’ailleurs que le code civil était la véritable constitution de la France ?
[9] A ce titre le plan de l’ouvrage de J. Rivero présente un gouffre incomblable : le premier tome est consacré aux droits de l’Homme et le second, sans transition, au « régime des principales libertés ». Cette transition eût été justement constituée d’une théorie des libertés publiques. Cf. sur ce point, O. Beaud, « Remarques introductives sur une absence de théorie des libertés publiques dans la doctrine publiciste », JusPoliticum n°5, 2010.
[10] Article 7 de l’arrêté du 16 octobre 2016.
[11] En apparence seulement puisque l’examen porte essentiellement – bien que les sujets donnés puissent être à l’évidence forts divers – sur la connaissance et la maîtrise du régime juridique d’une ou plusieurs libertés.
[12] X. Dupré de Boulois, « Existe-t-il un droit des libertés ? », RDLF 2017, chron. 04.
[13] Sur ce point cf. notamment J. Chevallier, « Ce qui fait discipline en droit », in F. Audren et S. Barbou des Places, Qu’est-ce qu’une discipline juridique ?, Paris, LGDJ, 2018, pp. 47-59.
[14] Ainsi dans des développements relatifs au « contenu du contrat » le Terré consacre une subdivision aux « droits fondamentaux » à la conformité desquels est subordonné sa licéité (F. Terré et al., Droit civil. Les Obligation, 13e ed., Paris, Dalloz, 2022, pp.595-601).
[15] Par exemple le grand Manuel de Droit administratif général de B. Plessix, publié chez LexisNexis, ne contient dans son index rerum qu’une seule référence à son entrée « Liberté » mais si le régime de plusieurs « libertés » sont largement détaillées.
[16] L. Duguit, Traité de droit constitutionnel. Cinquième tome : Les Libertés publiques, 2ee. Paris, 1925. Par ailleurs, les Cours de droit constitutionnel (1935-1936) de Rossi étaient déjà consacrés à l’étude du « Droit public des Français » donné par la Charte.
[17] Y. Lecuyer et F. Lemaire, Cours de droits humains et libertés, 2e ed., Paris, Gualino, 2024 ; S. Hennette Vauchez et D. Roman, Droits des Libertés fondamentales et des Droits humains, 6e ed., Paris, Dalloz, 2025.
[18] S. Rials, « Dogmatique et humanités. Considérations françaises sur une séparation », Droits 2009/2, n°50, p. 204.
[19] Décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, cons. 13.
[20] X. Dupré de Boulois (coord.), X. Bioy, L. Burgorgue-Larsen, P. Deumier, E. Dreyer, A. Martinon, R. Tinière, Les grands arrêts du droit des Libertés fondamentales, 5e ed., Paris, Dalloz, 2025.
[21] On pense aux propositions de O. Pfersmann, « Esquisse d’une théorie des droits fondamentaux », in L. Favoreu et al., Droit des Libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2000, p. 92 et d’E. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA, spéc., 1998 ; bien que ce dernier répugnerait à voir sa pensée rangée au rayon de la Théorie du droit.
[22] Décision n° 84-172 DC du 26 juillet 1984, Loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage, cons. 3
[23] Cour EDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c/ Suède, A-52.