La ville en tant que garante des droits fondamentaux : quelles stratégies de protection ?
Les villes sont, en général, dotées d’une autorité de gouvernance limitée et ne disposent pas d’un pouvoir législatif. S’émancipant de l’autorité étatique, elles parviennent néanmoins à développer des stratégies de protection des droits fondamentaux. L’adoption des chartes municipales des droits de l’homme, leur auto-proclamation en « villes des droits de l’homme » ou la mise en place des réseaux interurbains internationaux comme le C40 Climate Leadership Group ou le World Mayors Council on Climate Change font figure de stratégies de ce type. Ces dernières, dont la normativité fait souvent défaut, ne peuvent néanmoins pas contredire les priorités du gouvernement central. Si certains discours prônent la constitutionnalisation du statut de la ville comme seule voie pouvant garantir l’efficacité des politiques urbaines en matière de droits fondamentaux, un certain scepticisme s’impose face à cet argument. Plaider en faveur d’un constitutionnalisme urbain n’est pas une démarche dénuée de toute considération idéologique dès lors que cet argument peut constituer un outil de rationalisation ou de légitimation du pouvoir des maires et des municipalités ou encore refléter une vision localiste des droits fondamentaux.
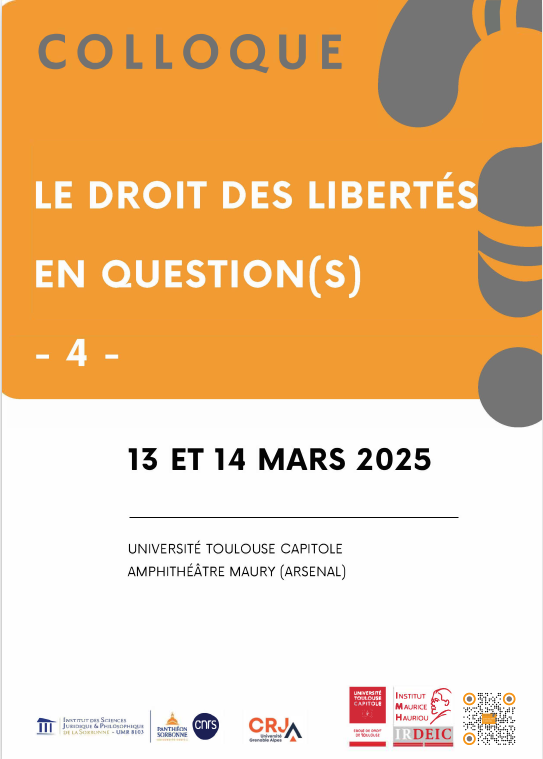 Nefeli Lefkopoulou, Docteure en droit public, Institut d’études politiques de Paris et Enseignante-chercheuse contractuelle à Sciences Po Paris
Nefeli Lefkopoulou, Docteure en droit public, Institut d’études politiques de Paris et Enseignante-chercheuse contractuelle à Sciences Po Paris
Il en est des villes comme des rêves :
tout ce qui est imaginable peut être rêvé
mais le rêve le plus surprenant est un rébus
qui dissimule un désir, ou une peur, son contraire.
Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs,
même si le fil de leur discours est secret,
leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses;
et toute chose en cache une autre1.
« While nations talk, cities act »,
Mike Bloomberg, ancien maire de la ville de New York,
Tweet 12 mars 2003
Le XXIe siècle a été caractérisé comme le « siècle de la ville »2. D’ici 2050, près de 70 % de la population mondiale (estimée à 10 milliards d’individus) vivra dans des villes (85 % dans les pays de l’OCDE)3. Cela représente une concentration humaine sans précédent dans les zones urbaines. Toutefois, la ville apparaît délaissée en tant qu’objet d’étude autonome en droit constitutionnel. Hormis la première étude monographique de Ran Hirschl, City, State. Constitutionalism and the Megacity4 et quelques écrits qui s’inscrivent dans cette lignée5, les défis majeurs de la gouvernance urbaine n’ont pas attiré l’attention de la doctrine constitutionnaliste, tant française qu’étrangère.
Un premier écueil tient à la définition de la ville ou de la zone urbaine. Quelle est la taille minimale pour qu’une zone soit considérée comme une ville ? La difficulté à définir la ville provient à la fois de la détermination du seuil statistique qui peut considérablement varier d’un État à l’autre (200 habitants au Danemark, 50 000 au Japon) et des limites spatiales, c’est-à-dire de la continuité du bâti construit. D’un point de vue géographique, « c’est par l’expérience collective, par les pratiques spatiales, (…) par la coprésence, par un maximum d’interactions sociales qu’un espace est identifié comme relevant de l’urbain. La ville est alors l’association de la densité et de la diversité (…)6 ». D’un point de vue juridique, il existe de nombreuses définitions différentes, qui vont de celles qui utilisent un seul critère (par exemple, un seuil de population) à celles qui utilisent une combinaison de critères (par exemple, la taille de la population, la densité, la délimitation administrative, l’activité économique, etc.).
En France, la définition légale de « ville » n’est pas strictement codifiée. Il n’existe pas de seuil de population officiel pour qu’une commune soit qualifiée de ville. Cependant, le terme « ville » est souvent associé à la notion d’unité urbaine qui prend en compte la continuité du bâti et un certain nombre d’habitants. L’INSEE définit une unité urbaine comme un ensemble de communes contiguës où la densité de construction est élevée et où le nombre d’habitants dépasse un certain seuil (généralement 2 000 habitants). Le terme « ville » est souvent utilisé pour désigner une commune connaissant une densité de population significative et une infrastructure suffisamment développée : des hôpitaux, des universités, des réseaux de transport public et des centres commerciaux.
Outre ces critères habituels, c’est la description proposée par Sylvain Petitet qui parait la mieux adaptée dans le cadre d’une analyse portant sur le pouvoir de la ville. Ainsi qu’il le note, « l’étymologie (polis) n’est pas trompeuse et à les considérer d’un point de vue diachronique ou comparatiste, les villes se distinguent moins par des critères démographiques, sociologiques ou économiques que par une spécificité d’ordre politique et institutionnelle. (…) L’histoire des villes et des institutions urbaines ne peut donc se comprendre que rapportée au pouvoir, ou plutôt aux pouvoirs qui s’y affrontent, les dominent ou les dirigent7 ». Or, la spécificité institutionnelle des villes par rapport à d’autres subdivisions administratives ou entités territoriales réside dans le fait que, malgré une reconnaissance de leurs compétences par la constitution (le cas des communes françaises), elles ne disposent pas d’un pouvoir législatif et que leur pouvoir normatif – réglementaire – s’exerce dans le cadre du respect des lois nationales. Elles ne disposent pas non plus d’une autonomie fiscale. En France, les collectivités territoriales bénéficient seulement d’une autonomie financière, de ressources propres dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Si elles peuvent recourir à l’impôt pour financer leurs dépenses, le pouvoir fiscal local n’est toutefois pas un pouvoir normatif pouvant créer, modifier ou supprimer un impôt. Quelle que soit la structure étatique – fédérale, régionale ou unitaire –, la plupart des ordres constitutionnels traitent les villes comme des entités infra-étatiques, entièrement immergées dans un cadre constitutionnel westphalien et dotées d’une autorité de gouvernance limitée.
Du point de vue du droit positif, les villes ne sont pas ainsi dotées d’un statut constitutionnel leur permettant de répondre de manière efficace aux préoccupations urbaines telles que le changement climatique, la densité ou les intérêts des populations vulnérables dans les périphéries urbaines. Or, la capacité des États à protéger les droits fondamentaux, tels que le droit au logement ou le droit à un environnement sain peut désormais faire défaut. La protection de ces droits peut dépendre de plus en plus de la glocalité, c’est-à-dire d’une action à la fois locale et mondiale. Les villes peuvent donc être considérées plus efficaces que les nations souveraines et leurs réseaux internationaux pour faire face aux défis globaux et interdépendants8.
Si les juristes ont, dans l’ensemble, négligé la nouvelle réalité de l’urbanisation extensive9, la ville a suscité beaucoup d’intérêt chez la communauté des sciences humaines. La théorie politique contemporaine a relancé le débat sur l’espace urbain en tant que lieu d’interactions sociales, en tant qu’alternative à la communauté politique fondée sur l’État ou l’ethnicité, et sur la ville en tant que source potentielle des droits de ses habitants à une vie urbaine renouvelée10. Ces dernières années, certains politologues ont aussi suggéré que, en raison de leur proximité avec la population, les villes sont souvent mieux à même de résoudre les problèmes que l’appareil étatique, détaché des réalités locales11. Les villes devraient ainsi saisir l’esprit du temps actuel, marqué par un « nouveau localisme », et prendre le contrôle de la résolution des problèmes sociaux et économiques qui relèvent de leur compétence12. Richard Schragger démontre, à son tour, comment les villes peuvent gouverner malgré les limitations constitutionnelles, et pourquoi nous devrions le souhaiter13. Il soutient qu’à l’ère du capital mondial, le pouvoir municipal est plus pertinent pour le bien-être des citoyens, et que la ville devrait être au centre même de notre réflexion économique, juridique et politique.
L’ouvrage du politologue Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World, est sans doute le plus audacieux dans le discours dominant pour plaider en faveur d’un renforcement du pouvoir des villes14. L’argument de l’auteur est surtout pragmatique : les villes peuvent agir là où les gouvernements centraux ne le peuvent pas. Il suggère que la tendance des villes à trouver des solutions pratiques aux grands défis politiques, ainsi que leur combinaison unique d’engagements locaux et d’inclinations cosmopolites, les rendent mieux adaptées que les États pour faire face aux problèmes de gouvernance contemporains. Ainsi qu’il l’explique, les villes offrent « un miracle de ‘glocalité’ civique promettant le pragmatisme plutôt que la politique, l’innovation plutôt que l’idéologie, et des solutions plutôt que la souveraineté15 ».
La crise de la gouvernance nationale peut d’ailleurs être perçue comme une crise de la souveraineté, de la capacité de l’État-nation à respecter les termes du contrat social sur lequel repose sa légitimité. L’incapacité des États à protéger les droits fondamentaux peut à la fois permettre et exiger une action de la part des autorités municipales. Selon la théorie du contrat social, l’autonomisation des villes peut donc être justifiée par leur capacité à garantir la vie, la liberté et la propriété de leurs citoyens. Ainsi que le pense Benjamin Barber, « En tant que représentants des citoyens, qui sont eux-mêmes la source ultime de la souveraineté, les municipalités comprennent que leur revendication de compétence repose non seulement sur leur capacité à agir efficacement, mais aussi sur leur droit à le faire lorsque les instances supérieures ne s’acquittent pas de leurs responsabilités en matière de souveraineté16 ». Les villes ont le droit de se gouverner elles-mêmes et de s’associer à d’autres villes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs frontières nationales.
Les dernières décennies ont alors vu un regain d’intérêt et une réflexion novatrice sur l’urbanisation et les villes à travers les sciences humaines.
Néanmoins, l’analyse ne vise pas à identifier les théories pouvant fonder le droit des villes d’agir ni à plaider en faveur d’un renforcement de leur pouvoir. Elle vise, au contraire, à démontrer, sur le plan empirique, comment la ville parvient à développer des stratégies de protection des droits fondamentaux. Certaines villes attribuent une forme de citoyenneté à leurs résidents. D’autres adoptent des chartes municipales des droits de l’homme, s’établissent en tant que « villes des droits de l’homme » ou collaborent entre elles en mettant en place des réseaux internationaux. Ces stratégies restent cependant limitées dans un univers constitutionnel dominé par l’État. Elles coexistent avec les cadres constitutionnels ou internationaux formels qui régissent les juridictions nationales, sans constituer une partie intégrante de ces cadres. De ce fait, elles sont peu susceptibles d’amener les centres urbains à mener efficacement des politiques, notamment lorsque ces dernières sont en contradiction avec les objectifs de leurs gouvernements nationaux ou avec l’ordre hiérarchique établi par les cadres constitutionnels dans lesquels ils opèrent.
Après avoir démontré comment la ville parvient à s’émanciper vis-à-vis de l’État en vue de la protection des droits fondamentaux (I), il convient ainsi de se demander si une constitutionnalisation du pouvoir des villes est nécessaire au regard de l’accomplissement de cet objectif (II).
I- Des stratégies de protection autonomes
Le silence constitutionnel sur le pouvoir urbain pousse parfois les dirigeants des villes à avancer leurs programmes en allant au-delà de l’ordre constitutionnel étatique17. Or, les initiatives allant « au-delà de l’État » peuvent signifier deux choses. Elles peuvent, en premier lieu, impliquer une protection des droits fondamentaux « contre l’État » car elles visent soit à s’opposer à l’action étatique soit à se substituer à l’inaction étatique (A). Elles peuvent, en second lieu, suggérer une stratégie de protection « sans l’État » car elles se développent en l’absence d’une concertation avec ce dernier (B).
A- Des stratégies de protection « contre » l’État
Les villes peuvent promouvoir des programmes de citoyenneté urbaine – souvent sous la forme de certificats ou de cartes d’identité basés sur la résidence qui permettent à leurs titulaires d’accéder aux services municipaux essentiels (1). Les villes peuvent encore élaborer des concepts tels que « les villes des droits de l’homme » afin d’afficher leur engagement dans une pratique particulièrement protectrice des droits de leurs citadins (2).
1- L’attribution de la citoyenneté urbaine
Alors que la citoyenneté locale était courante pendant des siècles, l’émergence de l’État-nation moderne a placé l’appartenance politique, avec tous les engagements, droits et devoirs qui en découlent, sous le contrôle de l’État. Un appareil étatique complexe s’est développé, chargé de questions telles que l’enregistrement de la population, la délivrance des passeports, le contrôle de l’immigration et les tests de naturalisation, toutes fondées sur l’appartenance à la communauté politique nationale comme base ultime de l’appartenance18. Aujourd’hui cependant, la réalité de plus en plus complexe de l’élaboration des politiques, de la prestation de services et de l’application de la loi à plusieurs niveaux crée des différents statuts liés à l’appartenance qui fonctionnent simultanément19.
D’un point de vue normatif, des théoriciens politiques tels qu’Avner de-Shalit et Rainer Bauböck ont avancé un concept de citoyenneté urbaine qualifiée de « city-zenship » et envisagée comme une alternative à l’appartenance à un État20. Ce concept se concrétise par la délivrance de cartes d’identification ou de certificats de résidence permettant à leurs détenteurs d’accéder à des services publics locaux. Le programme des cartes d’identité municipales de la ville de New York, lancé en 2015, à l’initiative du maire Bill de Blasio, en est un exemple frappant. À cette fin, IDNYC sert de forme d’identification valide pour entrer dans les écoles et les bâtiments de la ville, ainsi que pour les interactions avec le département de la police de la ville de New York. La carte offre également des abonnements gratuits aux institutions culturelles gérées par la ville, elle peut être utilisée comme carte de bibliothèque, elle donne droit à des réductions dans les pharmacies et les supermarchés, elle permet d’accéder aux banques, etc. Plus important encore, cette forme de carte d’identité municipale est gratuite et accessible à tous les résidents de New York âgés de 14 ans ou plus qui peuvent fournir une pièce d’identité (y compris un passeport étranger, une carte d’identité consulaire ou un permis de conduire) et une attestation de résidence à New York, quel que soit leur statut d’immigration officiel.
En tant que manifestation d’appartenance contrôlée par la ville et disponible sans documents fédéraux, la carte reflète la nature fracturée de la citoyenneté aux États-Unis et ailleurs. Selon Linda Bosniak, la structure fédéraliste hybride étasunienne accorde au gouvernement fédéral le contrôle de l’appartenance à la communauté nationale par le biais de son pouvoir d’admission ou d’expulsion des migrants et d’attribution ou de refus de la citoyenneté, tandis que la réglementation de la vie quotidienne des migrants, qu’ils aient des papiers ou non, est largement entre les mains des autorités locales21. De plus, il y a toujours eu aux États-Unis une double appartenance, à l’Union et à l’État fédéré. La superposition des identités et appartenances y est donc certainement plus naturelle que dans d’autres États.
Plusieurs grandes villes européennes ont expérimenté des cartes d’identité municipales basées sur le modèle new-yorkais. La variante parisienne a, par exemple, été introduite par la maire Anne Hidalgo, à la suite des attaques terroristes de 2015. La carte citoyenne de Paris est ouverte à tous les Parisiens sans condition de nationalité et à partir de 7 ans. Chaque personne qui réside, travaille ou étudie à Paris peut la demander et profiter de l’ensemble des événements gratuitement22. Elle est accessible via un formulaire en ligne ne nécessitant qu’une adresse postale, un e-mail et une photo d’identité. Cependant, elle ne vaut pas justificatif de domicile pour des démarches avec des acteurs extra-municipaux : ouverture d’un compte en banque, inscription à l’université, etc.
Dans une logique d’inclusivité similaire, d’autres villes ont adapté leur dispositif de recensement. En Espagne, toutes les communes espagnoles possèdent un système d’enregistrement des résidents appelé empadronamiento qui requiert un justificatif de domicile. Or, à l’initiative d’Ada Colau, arrivée à la tête de la mairie de Barcelone en 2015, les conditions d’obtention du padrón se sont considérablement assouplies. Au lieu de fournir un justificatif de domicile ou de prouver un rattachement auprès d’un centre social, la personne qui se trouve en situation de sans-abrisme doit uniquement préciser son lieu « d’enracinement », c’est-à-dire le lieu où se déroule sa vie quotidienne et sociale. En Italie, le « décret sécurité » de 2018 pris par le Ministre de l’Intérieur de l’époque, Matteo Salvini, a interdit l’inscription des demandeurs de protection internationale à l’état civil, limitant alors leur accès à de nombreux droits et services. L’ancien maire de Palerme, Leoluca Orlando, jugeant ces nouvelles modalités d’inscription administrative anticonstitutionnelles, a toutefois refusé d’ajuster le dispositif de recensement et a préféré maintenir le projet de citoyenneté locale. D’autres municipalités italiennes se sont jointes à l’initiative palermitaine par des actions de désobéissance, attribuant ainsi à celle-ci une portée réelle à l’échelle nationale.
Il en va de même avec l’attribution de cartes locales à l’usage des publics spécifiques. Tel est le cas de la « U Card – Utrecht for everyone » délivrée sur critères sociaux, de la « BBB Card – Bed, Bath and Bread » pour les personnes en situation irrégulière ou encore de la « carta de vecindad (carte de voisinage) barcelonaise. Bien que ces documents n’aient aucune valeur légale au regard de la loi nationale et ne protègent pas leurs titulaires d’une arrestation, il s’agit d’une façon pour les villes d’afficher leur soutien dans le parcours d’intégration des personnes en situation irrégulière sur leur territoire23.
Certains auteurs considèrent l’introduction de tels programmes d’identité municipale comme une évolution juridique susceptible d’affirmer les pouvoirs des villes en créant une nouvelle forme de citoyenneté pour leurs résidents24.
Cependant, dans la grande majorité des cas, les cartes d’identité municipales n’ont aucune incidence sur le statut constitutionnel de leurs titulaires ou des villes qui les délivrent25. En fait, la notion même d’une « citoyenneté urbaine », qu’elle soit alternative ou complémentaire à la citoyenneté nationale, va à l’encontre de la conceptualisation même de l’État moderne et de la vision étatiste de son ordre constitutionnel. Bien que ces cartes étendent explicitement les avantages du statut de l’immigré, elles ne prévalent pas sur la loi fédérale ou nationale. Aucune de ces cartes ne tente pas non plus de réglementer la politique d’immigration. En d’autres termes, elles ne créent pas de nouveaux droits pour les immigrés sans papiers.
Une autre stratégie d’autonomisation vis-à-vis des autorités étatiques consiste pour les villes à s’auto-déclarer « villes des droits de l’homme » – human rights cities.
2- Du droit à la ville aux villes des droits de l’homme
La définition de la « ville des droits de l’homme » peut parfois présenter un recoupement avec le droit à la ville, un mouvement plus ancien, né dans les années 1960, et qui trouve ses origines dans la théorie urbaine radicale26. Le « droit à la ville » a été défini comme « à la fois la liberté individuelle d’accéder aux ressources urbaines (y compris l’espace, les services et les infrastructures) et la capacité d’exercer un pouvoir collectif pour remodeler les processus d’urbanisation27 ». Tel qu’il a été conçu à l’origine, le droit à la ville ne faisait pas explicitement référence à un cadre normatif des droits humains. Certains chercheurs considèrent même que les deux mouvements sont en tension directe, les normes relatives aux droits de l’homme servant à défendre les droits de propriété classiques que le droit à la ville remet directement en cause28. Pourtant, les recoupements entre le droit à la ville et les normes englobées dans le concept de ville respectueuse des droits humains sont également évidents, notamment en ce qui concerne les droits à la participation et aux services de base29. Dès lors, la promotion d’un droit à la ville au niveau municipal a été étroitement liée aux efforts déployés par certaines villes pour s’établir en tant que « villes des droits de l’homme ».
Une telle auto-déclaration ne renvoie pourtant pas à un contenu très précis au regard des missions assumées. Les communautés qui revendiquent le statut de « villes des droits de l’homme » varient considérablement dans leur niveau de respect envers le droit international des droits de l’homme, et il n’existe aucun mécanisme officiel d’adhésion ou de contrôle permettant aux gouvernements locaux d’établir officiellement un tel statut. Certains chercheurs, comme le sociologue Michele Grigolo, continuent de mettre l’accent sur la pratique des droits humains dans la définition de la ville des droits de l’homme, c’est-à-dire une ville organisée autour des normes et des principes des droits de l’homme30. D’autres affirment que pour obtenir ce statut, il ne suffit pas d’adopter les droits de l’homme de manière rhétorique ni de les pratiquer par le biais de programmes éducatifs ; les documents constitutifs de la communauté doivent plutôt citer explicitement la Déclaration universelle des droits de l’homme ou d’autres principes officiels relatifs aux droits de l’homme31.
Michele Grigolo démontre comment certaines villes étasuniennes promouvant les droits civiques et luttant contre la discrimination dans les années soixante ont évolué vers des villes des droits de l’homme. Le Civil Rights Act de 1964 a été un tournant, établissant des lois anti-discrimination à l’échelle locale. Depuis les années 1990, de nouvelles villes des droits de l’homme ont émergé, intégrant les droits économiques et sociaux. Ces initiatives sont souvent dirigées par des organisations de la société civile et des activistes. Le mouvement vise à « ramener les droits humains à la maison » et à les intégrer dans les politiques locales. Des organisations comme le US Human Rights Network ont, par exemple, été créées pour promouvoir cette approche.
Souhaitant attribuer une certaine normativité à ces différentes initiatives, certaines villes adoptent seules ou avec d’autres villes partenaires des chartes des droits de l’homme. Ces dernières visent à redéfinir les droits de l’homme en tenant compte des spécificités urbaines et des compétences locales. Elles incluent des droits tels que le droit à la ville, le droit à un développement harmonieux et le droit à la tranquillité. La « Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville », adoptée à Saint Denis en 2000, la Charte montréalaise des droits et responsabilités de 2006 ou encore le programme « Ville des droits » de Barcelone de 2015 offrent une bonne illustration de régimes de droits locaux ou transnationaux. La Charte européenne a rassemblé plus de 350 autorités locales signataires à travers le globe, consolidant ainsi le mouvement des villes pour les droits humains en Europe.
Les villes d’autres régions du monde ont également lancé des initiatives similaires. En Asie, les organisations de la société civile et les responsables gouvernementaux se sont réunis à Gwangju, en Corée du Sud, en 1998, pour lancer la Charte asiatique des droits humains. De même, en 2011, les plus de cent participants au cinquième Forum annuel des villes des droits de l’homme à Gwangju ont adopté la Déclaration de Gwangju sur les villes des droits de l’homme. Dans cette déclaration, les participants ont d’ailleurs cherché à définir le concept de ville des droits de l’homme, affirmant qu’il s’agit « à la fois d’une communauté locale et d’un processus sociopolitique dans un contexte local où les droits de l’homme jouent un rôle clé en tant que valeurs fondamentales et principes directeurs32 ». Depuis 2011, le nombre de communautés à travers le monde – en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud – adoptant le label « ville des droits humains » n’a cessé d’augmenter. Quelle que soit la raison – pression exercée par des militants, intérêts des dirigeants de la ville, ou les deux –, ce mouvement fait désormais que « les droits humains jouent un rôle clé dans l’orientation des décisions locales33 ». Néanmoins, l’effet juridique des chartes municipales des droits de l’homme demeure incertain. Relevant du droit souple, elles ne peuvent pas, dans la plupart des cas, se substituer aux garanties constitutionnelles à l’échelle de l’État34.
Au lieu d’adopter leurs propres chartes des droits de l’homme, d’autres villes se sont engagées à respecter des traités internationaux spécifiques en matière de droits de l’homme. En 1998, San Francisco est devenue la première ville au monde à s’engager en faveur de la Convention onusienne sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en adoptant les dispositions de cette dernière sous une forme d’ordonnance locale. Autre exemple intéressant est celui du district de Shibuya, au centre de Tokyo, qui a commencé, en 2015, à délivrer des certificats de « preuve de partenariat » aux couples de même sexe alors que le mariage entre ces derniers n’est pas reconnu par la loi constitutionnelle ni par le code civil japonais.
Par ailleurs, et en matière de protection des droits des migrants, une ville peut s’auto-dénommer de manière davantage précise. Aux États-Unis, on retrouve les villes « sanctuaires ». Héritières des mobilisations des années 1980, ces villes « se caractérisent par leur refus de collaborer aux politiques nationales d’immigration, de prendre en compte la situation administrative des personnes pour l’accès aux services municipaux et de partager des informations sur les migrants avec les autorités fédérales35 ». En réponse aux politiques restrictives adoptées par leurs gouvernements nationaux et à la rhétorique anti-migrants des partis nationalistes-populistes, certains dirigeants des villes européennes ont également déclaré leurs villes « villes solidaires » ou « villes refuge ». Tel a été le cas des maires de Barcelone, Paris, Lesbos et Lampedusa qui ont lancé, en 2015, un appel pour « la constitution d’un réseau de villes-refuge garantissant au niveau local ou municipal des conditions d’accueil décentes pour les exilés, migrants et demandeurs d’asile cherchant refuge en Europe36 ».
Les villes peuvent ensuite décider de mettre en place des réseaux internationaux ou de coopérer avec les organisations internationales. Or, ces stratégies d’émancipation ne rentrent pas en conflit, du moins pas directement, avec l’État.
B- Des stratégies de protection « sans » l’État
Aucun traité international, aucune convention des Nations Unies, et aucune décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ne reconnaît les villes comme des entités juridiques en vertu du droit international37. Les villes sont cachées derrière le voile ou la « boîte noire » de leur État38. Pourtant, il ne fait guère de doute que le statut réel, de facto et fonctionnel des villes en droit international et dans les relations internationales a considérablement changé depuis le début du millénaire, et ce de manière croissante au cours de la dernière décennie39. Les villes protègent et font respecter les normes et obligations juridiques internationales40, nouent des liens et établissent des réseaux et relations internationaux41. Elles sont devenues des objets de la gouvernance mondiale et sont ciblées par des organisations internationales telles que l’ONU, la Banque mondiale et l’OCDE afin de faire progresser divers programmes mondiaux42. Pour certains auteurs, observer comment les villes agissent réellement amène à remettre totalement en question l’idée reçue qui nie leur personnalité juridique internationale43.
Malgré l’absence de reconnaissance officielle d’une telle personnalité juridique, les villes coopèrent à la fois avec les organisations internationales en établissant des coalitions verticales (1) et entre elles en formant des coalitions horizontales (2).
1- Des coalitions verticales
Pour plusieurs raisons, les organisations internationales s’intéressent de plus en plus à la collaboration avec les villes, et ces dernières s’intéressent de plus en plus à la collaboration avec les organisations internationales.
Un grand nombre de villes des droits de l’homme établissent, en premier lieu, des relations étroites avec des organisations internationales des droits de l’homme. C’est aussi le cas des réseaux de villes internationaux en matière d’immigration44. De telles coalitions permettent aux villes de tirer profit de multiples façons45. Par exemple, elles peuvent renforcer leur capital politique vis-à-vis de leur État-nation, permettant ainsi à l’administration locale de bénéficier d’une autonomie afin d’élaborer des politiques en matière de droits de l’homme. Ces coalitions permettent également aux municipalités d’accumuler du pouvoir sur la scène internationale.
Inversement, les villes peuvent être considérées par les organisations internationales comme des laboratoires pour expérimenter des politiques des droits humains46. Reconnaissant l’importance croissante des gouvernements infranationaux dans la réalisation des droits de l’homme, les organismes des Nations Unies ont pris plusieurs mesures concrètes pour encourager une plus grande participation des villes et autres gouvernements infranationaux à l’élaboration des politiques en la matière. Par exemple, le rôle des gouvernements locaux au sein de l’ONU-Habitat dont la mission est de promouvoir le développement durable ainsi que l’accès à un logement décent pour tous dans les villes, s’est élargi. Le Nouveau Programme pour les Villes adopté lors de la Conférence Habitat III, en 2016, est la « première déclaration des Nations Unies qui attribue aux autorités locales la responsabilité directe de protéger, de respecter et de promouvoir les droits de l’homme dans tous les domaines relevant de leur compétence47 ».
De même, les organes conventionnels des Nations Unies ont encouragé à plusieurs reprises les États à intégrer les perspectives des gouvernements locaux dans leurs rapports de suivi des traités48. En 2018, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a répondu favorablement lorsque les gouvernements locaux ont demandé à participer aux sessions de rédaction du Pacte mondial sur les migrations49. Et, en 2019, le HCDH a préparé un rapport pour le Conseil des droits de l’homme sur les « méthodes visant à favoriser la coopération entre les gouvernements locaux et les parties prenantes locales pour la promotion et la protection efficaces des droits de l’homme50 ». Les recommandations du HCDH comprenaient la suggestion que les Nations unies soutiennent les gouvernements locaux « en fournissant des orientations et en renforçant leurs capacités, en invitant plus systématiquement les représentants des gouvernements locaux aux réunions des Nations unies et en abordant le thème des droits de l’homme et des gouvernements locaux lors des événements organisés par les Nations unies51 ». Il convient notamment de noter que lorsque le HCDH a sollicité des contributions dans le cadre de ce rapport, il a reçu 19 contributions de la part de collectivités infranationales52. La majorité de ces contributions provenaient de collectivités locales actives au sein de réseaux de villes des droits de l’homme ou ayant explicitement revendiqué ledit label.
Cependant, les dirigeants municipaux et les défenseurs des droits humains qui ont soumis des commentaires au HCDH n’étaient pas satisfaits des canaux d’engagement actuels. La ville de Nuremberg a, par exemple, plaidé en faveur d’un plus grand nombre de projets des Nations Unies liés au travail local, ainsi que des structures onusiennes plus transparentes et participatives53. Le HCDH a lui-même noté qu’« il est toujours nécessaire de resserrer les liens entre les entités des Nations unies et les autorités locales », du moins en ce qui concerne l’établissement des rapports au titre des traités54.
Au-delà de leur réponse aux appels à contribution lancés par les Nations Unies, les villes des droits de l’homme s’engagent aussi de manière proactive dans d’autres causes similaires. San Francisco, qui a intégré la CEDAW dans sa gouvernance locale, envoie souvent des représentants aux réunions des Nations Unies consacrées aux droits des femmes et rend compte des progrès réalisés par la ville dans la mise en œuvre du traité sur les droits des femmes55. De même, Berkeley, en Californie, reconnue comme villes des droits de l’homme, a déposé des « rapports parallèles » dans le cadre du suivi du respect par les États-Unis de leurs obligations au titre des traités relatifs aux droits de l’homme56. Il en va pareillement pour la ville de Graz, en Autriche, première ville des droits de l’homme en Europe, qui collabore avec l’UNESCO sur plusieurs programmes différents en matière de droits de l’homme57. En résumé, le statut d’une ville qui s’est autoproclamée ville des droits de l’homme semble être associé à une participation active à la surveillance internationale des droits de l’homme, à l’établissement de rapports et à un dialogue de haut niveau avec les institutions des Nations Unies.
Les villes peuvent également s’unir au niveau international autour de questions plus spécifiques liées aux droits de l’homme, comme l’illustrent les villes arc-en-ciel (LGBTI) ou les villes C40 (climat). Ce type de mise en commun et de coopération horizontale entre les villes peut s’avérer particulièrement efficace dans des domaines qui ne sont pas directement abordés par le droit constitutionnel étatique, tels que la protection de l’environnement.
2- Des coalitions horizontales
Certains aspects de la protection de l’environnement sont devenus des domaines majeurs de collaboration internationale entre les villes. Les réseaux interurbains tels que le C40 Climate Leadership Group, le World Mayors Council on Climate Change, le ICLEI – Local Governments for Sustainability facilitent l’échange de connaissances et permettent aux municipalités d’unir efficacement leurs voix, de s’engager dans la gouvernance climatique, de mieux représenter les besoins des citoyens et d’agir plus rapidement que les États-nations en la matière58. Parmi ces trois organisations, la première peut être considérée comme la plus « offensive » pour l’ordre constitutionnel car elle remet en question le monopole de l’État dans la définition du statut, des droits et des devoirs de ses membres, ainsi que des limites de l’adhésion elle-même. Certains de ces réseaux ont d’ailleurs joué un rôle influent dans la gouvernance mondiale. L’ICLEI a, par exemple, contribué de manière décisive à faire adopter l’Agenda 21 des Nations Unies pour la protection de l’environnement lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992.
Le Parlement mondial des maires – Global Parliament of Mayors (GPM) – est ensuite considéré par Benjamin Barber comme la dernière étape du chemin déjà bien tracé par ces réseaux59. Plutôt que de s’inspirer d’une institution mondiale traditionnelle, le GPM se présente comme un réseau adoptant des concepts de gouvernance mondiale innovants. Il est multipartite, incluant non seulement les maires, mais aussi les principaux acteurs urbains au-delà des responsables locaux. Les principaux domaines de coopération vont du partage des connaissances, à l’élaboration de normes et à la formulation de politiques, en passant par la mise en œuvre de solutions concrètes. Il reste cependant un modèle de gouvernance mondiale « douce ».
Il s’ensuit que les différentes stratégies d’émancipation « sans l’État » ne contraignent en rien ce dernier. Ainsi que le soulève Ran Hirschl, « si ces initiatives interurbaines ont permis de redorer le blason des villes sur la scène internationale, elles n’ont eu que peu ou pas d’effet sur le plan constitutionnel60 ». Dans une large mesure, ces réseaux échappent au contrôle du droit public61. Aucun de ces réseaux internationaux ne jouit d’une personnalité juridique à part entière, que ce soit en droit constitutionnel ou en droit international. Ils ne peuvent pas saisir la Cour internationale de justice ou d’autres tribunaux internationaux compétents pour violation des obligations internationales. Les mécanismes de responsabilité et de conformité mis en place par ces réseaux ne sont pas pleinement développés et manquent souvent d’autorité externe. S’il n’est pas rare que ces réseaux interviennent dans des litiges constitutionnels par le biais de mémoires d’amicus curiae ou en tant que tiers intervenants, ils ne le font pas en tant que parties au procès.
Bien que ni les villes ni les réseaux interurbains n’aient pas qualité pour agir devant la CIJ, les premières sont cependant de plus en plus impliquées dans des procédures judiciaires devant d’autres cours et tribunaux internationaux, tels que le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il semblerait ainsi que les villes possèdent une personnalité juridique distincte de celle de leurs États et, à ce titre, elles comparaissent régulièrement en tant que parties devant la CJUE62. Le problème de l’absence du standing doit alors être apprécié avec une certaine prudence.
Une autre limite de ces stratégies émancipatrices tient au fait que de nombreuses constitutions nationales accordent au gouvernement national un pouvoir exclusif en matière d’affaires étrangères. Cela signifie que les municipalités ont une autorité juridique très limitée pour conclure des accords avec des organisations intergouvernementales. De plus, les gouvernements infranationaux dans les États fédéraux peuvent considérablement limiter les activités internationales des villes. Entre 2013 et 2015, un mouvement d’opposition à la protection de l’environnement dans le cadre de l’Agenda 21 de l’ONU a conduit les représentants des États de l’Arizona, de la Géorgie et du Texas à introduire une législation interdisant aux municipalités de conclure des accords avec des organisations intergouvernementales.
Il en résulte qu’aussi significatives que les stratégies de protection des droits fondamentaux puissent paraître au niveau pratique ou symbolique, la marge de manœuvre des villes reste sérieusement limitée dans un univers constitutionnel dominé par l’État. Ces stratégies présentent des limites importantes et peuvent s’avérer moins efficaces que le cadre constitutionnel qui accorderait aux villes des pouvoirs législatif et fiscal propres.
II- Vers une constitutionnalisation des stratégies de protection ?
Malgré leurs initiatives émancipatrices, les villes ne parviennent pas toujours à protéger les droits fondamentaux. C’est notamment le cas lorsque la politique urbaine contredit celle de l’État. Les autorités étatiques peuvent d’ailleurs attaquer en justice ces initiatives. Et, les autorités juridictionnelles ne sont en principe pas compétentes pour procéder à un équilibrage des pouvoirs entre le gouvernement central et la ville. Certains discours prônent ainsi la constitutionnalisation du statut de la ville comme seule voie pouvant garantir l’efficacité des politiques urbaines en matière de droits fondamentaux (A). Or, plaider en faveur d’un constitutionnalisme urbain n’est pas une démarche dénuée de tout projet idéologique. La rhétorique du constitutionnalisme peut uniquement servir à rationaliser ou à légitimer le pouvoir des maires et des municipalités. La voie de constitutionnalisation ne peut donc pas se présenter comme une démarche nécessaire (B).
A- Une constitutionnalisation préconisée
En raison de nombreux conflits dont la résolution ne semble pas avantager la ville (1), une partie de la doctrine propose de reconnaître les pouvoirs de cette dernière sur la plan constitutionnel (2).
1- La ville, partie perdante
Les villes assument parfois des obligations juridiques internationales en raison de l’inaction, du mépris ou du non-respect de leurs États à l’égard de ces obligations63. Or, l’engagement d’une ville en faveur des normes relatives aux droits de l’homme peut être source de tensions entre les autorités locales et nationales64.
Ces tensions sont, par exemple, illustrées par la campagne Cities for CEDAW aux États-Unis65. Les États-Unis sont l’un des rares États membres de l’ONU à ne pas avoir ratifié la CEDAW. S’appuyant sur l’adoption de la CEDAW par San Francisco en tant que loi municipale en 1998, des militants ont lancé cette campagne afin d’encourager d’autres villes à adopter la convention dans le cadre de leur législation municipale locale. L’objectif de cette campagne n’est pas seulement de mettre en œuvre la CEDAW ville par ville aux États-Unis, mais d’accroître la pression exercée sur le gouvernement national pour que celui-ci la ratifie aussi66. Cependant, ces efforts locaux peuvent parfois se retourner contre eux, car le gouvernement national peut toujours réaffirmer son contrôle sur la mise en œuvre du droit international des droits de l’homme et faire annuler par le juge les initiatives locales en exerçant son autorité fédérale67.
Les initiatives des villes des droits de l’homme en matière d’immigration peuvent également rencontrer la résistance de l’État. C’est ce qui s’est produit lorsque les villes d’Utrecht et d’Amsterdam ont offert un hébergement d’urgence aux réfugiés, contrairement aux politiques nationales néerlandaises. Le gouvernement néerlandais a fait valoir que le droit national interdit cette aide et a rejeté l’argument selon lequel les villes des droits de l’homme peuvent se soustraire aux obligations légales nationales en invoquant les normes relatives aux droits de l’homme68. Le statut de ville des droits de l’homme ne permet donc pas à ces autorités locales de se soustraire aux lois nationales.
Il en va exactement de même eu égard aux villes sanctuaires étasuniennes. Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été marqué par de nombreuses batailles judiciaires entre son administration et lesdites villes. Dès sa prise de fonction en 2017, le Président étasunien avait signé un ordre exécutif selon lequel les villes sanctuaires violeraient les lois nationales et mettraient en péril la sécurité des États-Unis69. Ces villes ont été à l’époque menacées de se voir retirer les subsides fédéraux. La procédure avait été bloquée puis finalement jugée inconstitutionnelle70.
Lors du second mandat de Donald Trump, les tensions s’annoncent encore plus vives. L’équipe présidentielle est bien mieux préparée que lors de son premier passage à la Maison Blanche, rassemblant cette fois-ci les deux chambres législatives et une majorité de juges à la Cour Suprême, face à un camp démocrate divisé. Le président américain a signé en avril 2025 un ordre exécutif71, intitulé « Protéger les communautés américaines contre les étrangers criminels » autorisant le Procureur général et le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis à prendre toute mesure légale pour empêcher les villes sanctuaires de recevoir des fonds fédéraux. Plusieurs municipalités ont depuis porté plainte contre cette action gouvernementale, qu’elles jugent inconstitutionnelle. Le gouvernement Trump a également supprimé une politique interdisant aux agents fédéraux de procéder à des arrestations dans les écoles, lieux de cultes, hôpitaux et autres « lieux sensibles ». Début mars 2025, les maires démocrates de quatre grandes villes américaines (Boston, Chicago, Denver et New York) ont d’ailleurs été entendus devant la commission de surveillance et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants à la demande d’élus républicains qui dénoncent le statut de ville sanctuaire72. Ainsi que l’a déclaré Tom Homan, directeur de l’agence responsable du contrôle des frontières et de l’immigration, ou communément appelé « le tsar des frontières », « les villes sanctuaires sont des sanctuaires pour les criminels73 ».
Rien ne permet de prédire si l’administration Trump réussira à suspendre les financements des villes qu’elle considère comme non coopératives en la matière et si elle se heurtera à nouveau au principe du fédéralisme, selon lequel les fonds fédéraux ne peuvent pas être gelés en représailles. En 2020, la Cour d’appel du premier circuit a confirmé le jugement rendu par le tribunal de district en faveur des municipalités du Rhode Island dans le cadre de leur action en rapport avec les conditions de l’octroi de subventions fédérales, estimant que le ministère américain de la Justice (DOJ) avait outrepassé son autorité légale74. Les cours d’appel fédérales restant néanmoins divisées sur la question de savoir si la loi fédérale délègue au DOJ le pouvoir d’imposer ces conditions, la Cour suprême sera probablement amenée à trancher cette question. Dans tous les cas, le fait que le statut des villes sanctuaires ne soit pas juridiquement reconnu, complique davantage la résolution du conflit.
Le domaine de l’immigration relève, certes, de ce qui peut être qualifié de high politics. Il serait à cet égard utile de recourir à la distinction entre high politics et low politics pour délimiter les sphères d’action, soit restreintes aux exécutifs des États centraux, soit ouvertes à la participation des villes75. Les questions liées à la sécurité et à la survie de l’État seraient plus difficilement confiées aux villes par rapport à celles liées à la culture, l’éducation ou encore l’environnement. Si adopter une forme de distinction thématique aide à expliquer les échecs des initiatives urbaines dans certains domaines, la victoire judicaire n’est pas non plus garantie dans les domaines de la « basse politique ». Pour certains, en l’absence d’une constitutionnalisation de ses compétences, la ville ne peut jamais être rassurée de sortir gagnante du conflit.
2- L’argument constitutionnel
Ran Hirschl propose un programme assez exhaustif visant à constitutionnaliser le statut de la ville76. Certaines de ses recommandations méritent d’être succinctement abordées.
Premièrement, les systèmes électoraux peuvent être conçus de manière à mieux représenter les citoyens urbains. Une conception de systèmes électoraux qui tiennent compte de la dimension spatiale de la politique et représentent mieux les électeurs urbains ou, à tout le moins, ne les sous-représentent pas par rapport aux électeurs ruraux est à ce titre avancée. Le système électoral et les limites des circonscriptions électorales sont souvent conçus pour répondre aux exigences d’une représentation géographique égale. Or, les systèmes électoraux actuels, avec des circonscriptions urbaines et rurales distinctes, sous-représentent les villes. Une option envisageable est celle des circonscriptions électorales mixtes urbaines-rurales ou d’un système électoral dénommé « représentation proportionnelle rurale-urbaine » (rural-urban proportional representation).
Deuxièmement, Ran Hirschl propose un cadre constitutionnel propice à l’action des villes en matière d’inégalités de logement et de changement climatique. Un statut constitutionnel renforcé, accompagné d’une plus grande capacité fiscale et législative, est susceptible d’aider les villes à prendre des mesures importantes en faveur de la réalisation du droit au logement et de la protection de l’environnement.
Troisièmement, il incite à repenser certains éléments du fédéralisme fiscal tels que le principe de péréquation financière. Traditionnellement envisagé comme un mécanisme de redistribution des ressources visant à réduire les inégalités entre plusieurs collectivités territoriales, ce principe peut être adapté au niveau intra-métropolitain de façon à réduire les écarts socio-économiques au sein des métropoles.
Quatrièmement, le principe de subsidiarité peut également être repensé. La subsidiarité désigne la norme qui favorise l’attribution du pouvoir aux autorités locales plutôt qu’aux autorités centrales. Comme pour le fédéralisme, la plupart des écrits sur la subsidiarité n’ont cependant que très peu fait référence à l’autonomisation constitutionnelle des villes77, malgré l’application apparemment évidente de ce principe dans un tel contexte. Il serait donc possible d’envisager la subsidiarité en combinaison avec la redéfinition de l’« unité », c’est-à-dire de l’entité territoriale, dans le fédéralisme. Yishai Blank soutient que la subsidiarité est au contraire un meilleur modèle que le fédéralisme pour intégrer les gouvernements locaux dans la dynamique de la gouvernance mondiale à plusieurs niveaux78. Le fédéralisme a une prédisposition favorable à l’État en tant que sphère territoriale souveraine, tandis que la subsidiarité ne privilégie aucun niveau particulier de gouvernement.
Dans une tentative pour concrétiser certaines de propositions de Ran Hirschl, Maartje De Visser relie ensuite le principe de subsidiarité aux nouvelles théories de la gouvernance79. Elle oppose un modèle de délégation de pouvoir centré sur le gouvernement au modèle de subsidiarité centré sur les citoyens, qui reflète une gouvernance ascendante et vise à donner aux citoyens les moyens de participer à leur propre gouvernance. À l’aide d’exemples européens, elle décrit comment le modèle centré sur le gouvernement a été utilisé pour soutenir un modèle de délégation de la gouvernance : la ville est conçue comme un agent. Selon cette conception des villes, leur relation avec le gouvernement national s’apparente à celle d’un mandant et d’un mandataire. Une approche centrée sur les habitants se concentre, à l’opposé, sur la protection des droits fondamentaux de tous ceux qui vivent dans une ville. Elle imagine des accords de partage du pouvoir et soutient que les États pourraient accepter officiellement le rôle des villes dans la réalisation d’un éventail plus complet de droits fondamentaux allant au-delà du vote et de la participation politique. Pour les États qui seraient réticents à intégrer le droit à la ville dans leur constitution en raison de son caractère potentiellement illimité, la concrétisation offerte par la Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville offre du moins la perspective de reconnaître un ensemble plus spécifique de droits à garantir par et au sein des villes.
Néanmoins, l’argument plaidant en faveur d’une constitutionnalisation de la ville peut aussi être associé à des considérations idéologiques ou être porteur des agendas politiques. Il est ainsi important de s’interroger sur la nécessité de choisir le point de vue du constitutionnalisme. Bien que cette démarche théorique et pratique ait un certain caractère intuitif, elle n’est peut-être pas la seule voie à emprunter.
B- Une constitutionnalisation non-nécessaire
La rhétorique de la constitutionnalisation renvoie à une organisation du rapport politique assez connue, assez prévisible, très précise voire rigide. Si la familiarité de la communauté juridique avec cette structure explique en partie la préconisation de la voie du constitutionnalisme, il n’en demeure pas moins que son principal défi est la question des élites dont elle est l’instrument (1) et, en l’occurrence, des élites urbaines (2).
1- Un cadre conceptuel idéologiquement connoté
D’un point de vue épistémologique, le constitutionnalisme apparaît comme une manière spécifique d’encadrer les questions sociales, politiques ou morales. Le cadre constitutionnel peut théoriquement fournir une clarté juridique sur les compétences et responsabilités des gouvernements locaux, des normes et un cadre discursif. Une constitution habilite les autorités à atteindre les objectifs qu’elle définit, et ces objectifs justifient à leur tour leurs actions80. Le langage propre au droit constitutionnel peut donc contribuer à l’établissement, à la rationalisation, à la stabilisation et à la légitimation du pouvoir urbain. Ainsi que le souligne Reinhart Koselleck, le vocabulaire constitutionnel présente « un fort potentiel de légitimation » pour l’autorité qui s’en revendique81. À cet égard, l’émancipation de certaines villes de leurs États respectifs, qui se traduit par des chartes des droits de l’homme ou par l’attribution de la citoyenneté reflète la manière dont elles se pensent et se présentent à leur environnement. L’auto-constitutionnalisation est ensuite un moyen de solidifier les structures de gouvernance qu’elles sont de facto. Le langage constitutionnel est d’ailleurs intrinsèquement lié à la protection des droits fondamentaux, de sorte qu’il devient difficile pour quiconque de contester l’argumentaire de l’autorité urbaine qui s’en réclame.
Le constitutionnalisme peut être rassurant car la langue vernaculaire du constitutionnalisme étatique, lorsqu’elle est transposée dans les villes, véhicule des notions telles que la dignité humaine, la liberté, la régularité de la procédure, la proportionnalité, la limitation du pouvoir, etc. Si un acteur prétend être constitutionnel, il aspire à prendre au sérieux un certain nombre de droits fondamentaux. Il invite également les communautés soumises à son pouvoir à remettre en question la « constitutionnalité » du régime qui leur est imposé. La constitutionnalisation renforce une structure institutionnelle donnée, mais elle lui impose également des contraintes. Ainsi que le précise Guillaume Tusseau à propos du constitutionnalisme digital, « Tout autant qu’il est un moyen de contenir le pouvoir, le constitutionnalisme est un moyen de le renforcer et de le rationaliser82 ». Il peut ainsi être déduit que les citadins sont mieux protégés par une ville dont les pouvoirs sont constitutionnalisés car ces derniers sont nécessairement encadrés.
Or, ce vocabulaire se prêtant à de multiples et variés usages, la constitutionnalisation, en tant que seule voie du renforcement du pouvoir des villes, n’offre pas nécessairement une meilleure protection des droits fondamentaux que celle conférée par l’État. Un discours constitutionnel peut en outre être « porteur d’un message d’hégémonie83 ». Plusieurs auteurs considèrent, par exemple, que le constitutionnalisme comporte un risque inhérent de conservatisme84. En dissimulant la dimension du pouvoir et en assurant un contrôle apparent du désordre, le discours constitutionnel renforce les situations existantes. Le label constitutionnel peut donc se révéler un instrument pour renforcer les structures de pouvoir existantes, en particulier les structures urbaines, et promouvoir le statu quo et sa reproduction85.
Ce constat rejoint en partie l’analyse de Richard Bellamy qui prône un « constitutionnalisme politique86 ». Selon lui, la rigidité constitutionnelle limite la capacité d’une société à délibérer. L’argument selon lequel, à tout le moins, le cadre formel de la délibération et les droits d’y participer doivent être rigides ne tient pas. En effet, ce cadre et ces droits eux-mêmes sont l’objet du débat politique87. Ce dernier doit donc être aussi ouvert que possible, et assurer la construction d’une culture publique de définition collective de l’ordre social juste. L’exclusion de ces éléments du débat politique, alors même que leur contenu fait l’objet des désaccords les plus fondamentaux au sein de toute communauté, risque d’être arbitraire et de favoriser une forme spécifique de domination politique préétablie88. La constitutionnalisation peut donc être un sophisme destiné à garantir l’exclusion du débat politique de questions aussi essentielles que les droits fondamentaux et la limitation du pouvoir politique. Selon cette ligne d’analyse, l’inflation constitutionnelle contemporaine est un mépris de l’énergie politique du peuple89. Il va donc de soi qu’une gouvernance urbaine par le bas, ascendante, ne peut impliquer que les élites politiques des villes dans la définition de l’ordre urbain juste mais aussi et surtout les citadins.
Pour d’autres auteurs, il existe d’ailleurs un lien évident entre le « néolibéralisme disciplinaire », qui impose aux États des réformes structurelles, la libéralisation du commerce, la garantie des droits de propriété, le libre-échange, la liberté contractuelle et les droits des investisseurs, garantissant ainsi un environnement stable pour le capitalisme, et le constitutionnalisme mondial90. Faisant écho à des préoccupations similaires, Martin Loughlin estime que « le constitutionnalisme est devenu le principal moyen par lequel une élite isolée, tout en faisant semblant de soutenir les revendications démocratiques, est en mesure de perpétuer son autorité pour gouverner91 ».
Afin de ne pas se laisser emporter par certaines pratiques de protection des droits fondamentaux, partielles et locales, qui tendent à en occulter d’autres, une certaine prudence s’impose donc face à la préconisation, nécessairement intéressée, du cadre constitutionnel. Le discours prônant une constitutionnalisation du pouvoir des villes est notamment susceptible de dissimuler une pure stratégie de marketing de la part de maires souhaitant asseoir leur légitimité ou imposer leur propre vision des droits fondamentaux.
2- Une vision localiste des droits fondamentaux
Les stratégies des villes visant à protéger les droits fondamentaux tels que l’accès aux services publics, le principe de non-discrimination, le droit au logement, le droit à un environnement sain, etc. reflètent une vision humaniste de la société. Il devient dès lors difficile pour quiconque de douter des intentions des villes qui s’en réclament. Les programmes municipaux associés aux droits de l’homme ne sont cependant pas toujours porteurs de la même vision de la citoyenneté urbaine ni des droits de l’homme. Les opinions et discours sur ces droits sont produits par divers acteurs et leurs organisations, en relation avec les différents enjeux qui émergent dans chaque ville. Ils divergent ainsi considérablement et peuvent rendre compte d’une vision localiste et contextuelle des droits fondamentaux.
Certains auteurs démontrent à ce titre comment les droits de l’homme peuvent être intégrés dans une « logique néolibérale de gestion urbaine » visant à contrôler et à moraliser l’espace public et à normaliser son utilisation par les communautés marginalisées92. Une telle logique associe les droits de l’homme à la sécurité et à l’ordre public ainsi qu’à des notions vagues de « bonne citoyenneté ». Le cas de la ville de Barcelone en offre un bon exemple. Sous le mandat de Jordi Hereu, maire de la capitale catalane de 2006 à 2011, les droits de l’homme ont été associés à un programme municipal axé sur « l’ordre public ». Une nouvelle charte de la citoyenneté de Barcelone a notamment été approuvée93. Contrairement à la Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville, la nouvelle charte n’était toutefois pas un document interurbain, mais plutôt un document produit à Barcelone, par et pour Barcelone, auquel ont contribué des experts, mais aussi tous les partis politiques représentés au conseil municipal. Si cette charte proclame sa continuité avec la Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville, elle affirme également la nécessité d’une articulation plus locale des droits. Il s’ensuit que certaines visions municipales de la citoyenne ou des droits de l’homme peuvent être plus sécuritaires et moins inclusives que d’autres.
D’autres auteurs remettent en cause, de manière encore plus radicale, le caractère humaniste de la démarche en soulignant le caractère « intéressé » du projet ou la « personnalisation » des politiques d’accueil municipales. Ainsi que le souligne Filippo Furri, « l’exposition médiatique et l’investissement personnel de certains maires en matière d’accueil ne sont souvent que la partie visible du travail de négociation ou de confrontation entre tous les acteurs impliqués (…). La capacité de maîtriser cette ‘tension verticale’ se conjugue parfois avec la volonté des villes de rompre avec l’administration centrale en soutenant des actions novatrices, ou encore de se mettre en avant en faisant de leur penchant humanitaire ou humaniste un produit marketing94 ». Par exemple, la revendication de la ville de Barcelone à prendre en charge une partie significative de l’accueil des réfugiés, en 2017, doit être replacée dans le contexte « d’une revendication plus large de néo-municipalisme et d’autonomie au nom d’une reconfiguration ‘en commun’ de l’espace public95 ».
Il peut en aller de même à propos de l’orientation idéologique de la politique économique urbaine. Si certaines villes, dénommées « rebelles », telles que Caire, Madrid, Athènes ou New York ont été le théâtre de mouvements de contestation et d’opposition au capitalisme financiarisé96, la marge de manouvre que possède une ville pour mettre en œuvre un programme « anti-néolibéral » est relativement restreinte. Ainsi que le démontre Ran Hirschl, de nombreuses villes ont opté pour une collaboration étroite avec le secteur privé dans des domaines ou des projets d’intérêt commun97. Or ces collaborations reflètent souvent le schéma suivant. Les entités du secteur privé contribuent au financement ou au coparrainage de projets de développement urbain dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’architecture, la culture, les sports et les loisirs. En contrepartie, les villes octroient des concessions et adoptent des politiques favorables aux entreprises en matière de fiscalité, de zonage ou de permis de construire. Lorsqu’une ville pâtit d’un sous-financement, elle a besoin de soutien financier pour répondre aux demandes toujours croissantes et tenant aux infrastructures et aux services sociaux. Les financiers privés proposant de combler ce vide le font en échange d’un prix politique, plaçant ainsi les autorités municipales dans une relation intrinsèquement délicate avec les grandes entreprises.
Les villes peuvent donc devenir tributaires des intérêts des grandes entreprises98. Richard Schragger souligne à cet égard que « les villes n’ont d’autre choix que d’adopter des politiques favorables au marché et de rechercher des alliances avec de puissants intérêts commerciaux dans leur quête de croissance99 ». En échange d’investissements, les villes peuvent adopter des politiques favorables aux entreprises afin d’attirer ces dernières et d’empêcher la fuite des capitaux, ou de s’assurer que le secteur privé continue à cofinancer des projets. Lorsque les villes tentent de demander des comptes aux entreprises qui prospèrent en leur sein pour la flambée des prix de l’immobilier, la pénurie de logements sociaux et l’augmentation du nombre de sans-abri, la menace de la fuite des capitaux reste probable. C’est exactement ce qui s’est passé, en 2019, lorsque le conseil municipal de Seattle a adopté à l’unanimité une taxe de 275 dollars par employé sur les entreprises de Seattle afin de financer des logements abordables et de prévenir le sans-abrisme. Amazon a riposté en mettant fin à la construction d’une tour dans le centre-ville, suggérant qu’elle la sous-louerait à la place. Craignant les conséquences économiques, les responsables municipaux ont fait marche arrière. Un mois après l’adoption de la proposition fiscale, le conseil municipal l’a abrogée. Le degré de protection du droit au logement peut dès lors considérablement varier d’un contexte urbain à l’autre.
L’ambiguïté qu’englobe tout discours sur la nécessité de constitutionnalisation des pouvoirs de la ville ne doit pas être négligée. Il faudrait éventuellement admettre que les droits fondamentaux ne sont pas nécessairement mieux protégés par une ville constitutionnalisée. Le risque de pérenniser une structure de pouvoir existante ou une forme de gouvernance descendante nous amène à constater que la constitutionnalisation n’est peut-être pas la seule et unique voie pour permettre à la ville de garantir les droits fondamentaux. Ou alors, il faut simplement être conscient du fait que cette constitutionnalisation ne se limite qu’à renforcer une autre entité territoriale et à répartir d’une autre façon le pouvoir entre les différents échelons sans pour autant que cette répartition équivaille à une meilleure protection des droits des citadins.
1 I. Calvino, Les villes invisibles, trad. it., M. Rueff, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 2019, 208 p., p. 58.
2 The Rockefeller Foundation, Report: Century of the City, 18 décembre 2006, https://www.rockefellerfoundation.org/report/century-of-the-city/.
3 « World Urbanization Prospects, The 2018 Revision », Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), https://population.un.org/wup/assets/WUP2018-Report.pdf.
4 R. Hirschl, City, State : constitutionalism and the megacity, Oxford, Oxford UP, 2020, 266 p.
5 V. p. ex. B. Gussen, Axial Shift City Subsidiarity and the World System in the 21st Century, Singapore, Springer Nature, Palgrave Macmillan, 2019, xvii+493 p. ; A. Flynn, R. Albert, N. Des Rosiers (ed.), Cities and the Constitution: Giving Local Governments in Canada the Power They Need, Montreal, Kingston, London, Chicago, McGill-Queen’s UP, 2024, xiv+282 p.
6 « Ville », Géo-confluences, https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ville ; J. Lévy, M. Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013, 1127 p., pp. 1078–1081.
7 S. Petitet, « Villes », in S. Rials, D. Alland (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy PUF, 2003, xxv+1649 p., pp. 1517-1521.
8 B.R. Barber, Cool Cities : Urban Sovereignty and the Fix for Global Warming, New Haven, Yale UP, 2017, xv+207 p., p. 15.
9 Pour une exception en France v. J.-B. Auby, Droit de la ville : Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, 2e éd., Paris, LexisNexis, 2016, xi+348 p.
10 V. p. ex. M. Kohn, The Death and Life of the Urban Commonwealth, New York, NY, Oxford UP, 2016, ix +268 p.
11 B. Katz, J. Nowak, The new localism: how cities can thrive in the age of populism, Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2017, xii+290 p.
12 Ibid.
13 R.C. Schragger, City Power. Urban Governance in a Global Age, New York, NY, Oxford UP, 2016, xi+322 p.
14 B.R. Barber, If mayors ruled the world: dysfunctional nations, rising cities, New Haven, Yale UP, 2013, xv+416 p.
15 Ibid., p. 5.
16 Ibid., p. 18.
17 R. Hirschl, City, State : constitutionalism and the megacity, op. cit., pp. 151-171.
18 J.C. Torpey, The Invention of the Passport : Surveillance, Citizenship and the State, 2nd ed., Cambridge, United Kingdom, New York, NY, Cambridge UP, 2018, xix+ 255 p. ; R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, MA, Harvard UP, 1998, 270 p.
19 W. Mass, « Multilevel Citizenship » in A. Shachar et al. (ed.), Oxford Hanbook of Citizenship, New York, NY, Oxford UP, 2017, xiv+880 p., pp. 644-668 ; L. Bosniak, « Status Non-citizens », in ibid., pp. 314-336 ; L. Bosniak, The Citizen and the Alien : Dilemmas of Contemporary Membership, Princeton, N.J., Princeton UP, 2008, xii+222 p.
20 A. de-Shalit, Cities and Immigration : Political and Moral Dilemmas in the New Era of Migration, Oxford, Oxford UP, 2018, 179 p. ; R. Bauböck, « Reinventing Urban Citizenship », Citizenship Studies, Vol. 7, 2003, pp. 137-158 ; M. Bookchin, The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship, San Francisco, Sierra Club Books, 1987, xii+300 p.
21 Pour une analyse détaillée sur ce point v. L. Bosniak, The Citizen and the Alien : Dilemmas of Contemporary Membership, op. cit.
22 Pour plus d’informations sur son mode d’obtention et les services auxquels elle donne accès v. le site officiel de la Mairie de la Ville de Paris, https://www.paris.fr/pages/la-carte-citoyenne-3284#foire-aux-questions.
23 Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants, « Cartes d’identité municipales. Vers une citoyenneté locale inclusive », décembre 2021, pp. 1-32, https://www.anvita.fr/assets/MlbcResource/RAPPORT-ANVITA-CARTE-LOCALE-Decembre-2022.pdf, p. 9.
24 V. p. ex. K.A. Stahl, Local Citizenship in a Global Age, Cambridge, Cambridge UP, 2020, 300 p. ; A.C. Torres, « ‘I Am Undocumented and A New Yorker’ : Affirmative City Citizenship and New York City’s IDNYC Program », Fordham Law Review, Vol. 86, 2017, pp. 335-366.
25 R. Hirschl, City, State : constitutionalism and the megacity, op. cit., p. 169.
26 H. Lefebvre, préf. de R. Hess, S. Deulceux, G. Weigand, Le droit à la ville, 3e éd., Paris, Economica Anthropos, 2009, xviii+135 p.
27 A. Domaradzka, « Urban Social Movements and the Right to the City: An Introduction to the Special Issue on Urban Mobilization », Voluntas International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 29, 2018, pp. 607–620, p. 612.
28 M. Grigolo, « Towards a sociology of the human rights city: focusing on practice », in B. Oomen, M. Davis, M. Grigolo (ed.) Urban Global Justice : The Rise of Human Rights Cities, New York, NY, Cambridge UP, 336 p., pp. 276-293.
29 V. p. ex. K. Gomes da Silva, « The new urban agenda and human rights cities : Interconnections between the global and the local », Netherlands Quarterly of Human Rights, 2018, Vol. 36, n° 4, pp. 290-310, p. 294 ; M. Goodhart, « Human rights cities: making the global local », in A. Brysk, M. Stohl (ed.), Contesting Human Rights. Norms, Institutions and Practice, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, xi+233 p., pp. 142–158.
30 M. Grigolo, The human rights city : New York, San Francisco, Barcelona, London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, x+224 p.
31 B. Oomen, M. Baumgärtel, « Human Rights Cities » in A. Mihr, M. Gibney (ed.), The SAGE Handbook of Human Rights, Los Angeles, London, New Dehli, SAGE Publications Ltd, 2014, 2 vol., xlviii+1081 p., pp. 709-728.
32 Gwangju Declaration on Human Right City, 2011 World Human Rights Cities Forum, https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf.
33 M.F. Davis, « Finding international law close to home: the case of human rights cities », in P.A. Helmut, E.N. Janne, M.N. Marcenko (ed.), Research handbook on international law and cities, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2021, xx+479 p., pp. 227-239, p. 228.
34 Pour une analyse détaillée sur la normativité de la Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville v. C. Chabrot, « La Charte européenne des droits de l’homme dans la ville : un exemple d’acte ‘pré-juridique’ », Revue du droit public, 2007, pp. 355-377.
35 M. Paquet, « Aux États-Unis, des villes sanctuaires », Plein droit, Dossier « Villes et hospitalités », n° 115, 2017, pp. 11-14.
36 F. Furri, « Villes-refuge, villes rebelles et néo-municipalisme », Plein droit, Dossier « Villes et hospitalités », n° 115, 2017, pp. 3-6.
37 Pendant l’entre-deux-guerres, un statut unique a néanmoins été accordé à diverses sous-entités, telles que la ville libre de Dantzig. Cette dernière est une cité-État placée sous la protection de la Société des Nations de 1920 à 1939.
38 Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 44, 2006, pp. 868-931, pp. 875.
39 Y. Blank, « International legal personality/subjectivity of cities », in P.A. Helmut, E.N. Janne, M.N. Marcenko (ed.), Research handbook on international law and cities, op. cit., pp. 103-120.
40 V. p. ex. Y. Blank, « Localism in the New Global Order », Harvard International Law Journal, Vol. 47, n° 1, 2006, pp. 263-281 ; G.E. Frug, D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, Vol. 38, n° 1, 2006, pp. 1-63 ; J.E. Nijman, « The Future of the City and the International Law of the Future », in S. Muller et al. (ed.), The Law of the Future and the Future of Law, Oslo, Torkel Opsahl EPublisher, 2011, xxvii+744 p., pp. 213-229 ; J.E. Nijman, « Renaissance of the City as Global Actor : The Role of Foreign Policy and International Law Practices in the Construction of Cities as Global Actors », in G. Hellmann, A. Fahrmeir, M. Veet (ed.), The Transformation of Foreign Policy : Drawing and Managing Boundaries, Oxford, Oxford UP, 2016, viii+304 p. ; H.P. Aust, « Shining Cities in the Hill ? The Global City, Climate Change and International Law », European Journal of International Law, Vol. 26, 2015, pp. 255-278.
41 S. Curtis, Global Cities and Global Order, Oxford, Oxford UP, 2016, 218 p. ; M. Acuto, Global Cities, Governance and Diplomacy : The Urban Link, Oxon, Routledge, 2013, ix+210 p.
42 OECD, Governing the City, OECD Publishing 2015.
43 Y. Blank, « International legal personality/subjectivity of cities », op. cit., p. 108.
44 V. p. ex. E. Durmus, B. Oomen, « Transnational city networks and their contributions to norm-generation in international law: the case of migration », Local Government Studies, 2022, Vol. 48, n° 6, pp. 1048–1069 ; B. Oomen, M. Baumgärtel, E. Durmus, Transnational City Networks and Migration Policy Report, Cities of Refuge Research, décembre 2018, https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/e7bab1/policy_brief_dec_2018.pdf ; J. Resnik, « Law’s Migration : American Exceptionalism, Silent Dialogues, and Federalism’s Multiple Ports of Entry », Yale Law Journal, Vol. 115, 2006, pp. 1564-1670.
45 B. Oomen, M. Baumgärtel, « Frontier cities: The rise of local authorities as an opportunity for international human rights law », European Journal of International Law, Vol. 29, n° 2, 2018, pp. 607-630.
46 Pour une analyse approfondie à ce sujet v. J.K. Cogan, « International organizations and cities », in A. Helmut, E.N. Janne, M.N. Marcenko (ed.), Research handbook on international law and cities, op. cit., pp. 158–172.
47 K. Gomes da Silva, « The new urban agenda and human rights cities : Interconnections between the global and the local », op. cit., p. 291.
48 R. Kaufman, « ‘By Some Other Means’: Considering the Executive’s Role in Fostering Subnational Human Rights Compliance », Cardozo Law Review, 2012, Vol. 33, n° 5, pp. 101-159, p. 113.
49 C.F. Swiney, S. Foster, Cities Are Rising in Influence and Power on the Global Stage, CityLab, 2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-15/denied-by-united-nations-cities-make-global-pacts, (consulté le 10 août 2025).
50 Human Rights Council, Résolution 27 septembre 2018, « Local government and human rights », A/HRC/RES/39/7, §2-3 ; UN High Rights Commissioner, « Local government and Human Rights », Rapport 1er juillet 2019, A/HRC/42/22.
51 UN High Rights Commissioner, « Local government and Human Rights », op. cit., § 66.
52 OHCHR, Local Governments and Human Rights : Responses received, Local Governments, https://www.ohchr.org/en/about-us/what-we-do/partnership/local-governments.
53 Ibid., § 48.
54 Ibid.
55 City and County of San Francisco, Department on the Status of Women, Local Implementation of CEDAW and cities of CEDAW campaign leadership, Report to UN CEDAW Committee, November 2015.
56 M.F. Davis, « Cities, human rights and accountability » in B. Oomen, M.F. Davis, M. Grigolo (ed.), Global Urban Justice The Rise of Human Rights Cities, New York, Cambridge UP, 2016, 336 p., pp. 23-43, p. 31.
57 UN High Rights Commissioner, « Local government and Human Rights », op. cit., § 50.
58 V. p. ex. M. Betsill, H. Bulkeley, « Looking Back and Thinking Ahead : A Decade of Cities and Climate Change Research », Local Environment, Vol. 12, 2007, pp. 447-456 ; D.G. Adams, « Why We Cannot Wait : Transational Networks as a Viable Solution to Climate Change Policy », Santa Clara Journal of International Law, Vol. 13, 2015, pp. 307-331 ; H.M. Osofsky, J.K. Levit, « The Scale of Networks : Local Climate Change Coalitions », Chicago Journal of International Law, Vol. 8, 2008, pp. 409-436 ; H.P. Aust, « Shining Cities in the Hill ? The Global City, Climate Change and International Law », op. cit. ; J. Setzer, « Testing the Boundaries of Subnational Diplomacy : The International Climate Action of Local and Regional Governments », Transational Environmental Law, Vol. 4, 2015, pp. 319-337.
59 B.R. Barber, If mayors ruled the world, op. cit., pp. 336-359.
60 R. Hirschl, City, State : constitutionalism and the megacity, op. cit., pp. 157-158.
61 A. Sajó, « Transnational Networks and Constitutionalism », Acta Juridica Hungarica, Vol. 47, 2006, pp. 209-225.
62 F. Nicola, « Invisible Cities in Europe », Fordham Urban Law Journal, Vol. 35, 2012, pp. 1282-1363.
63 H.P. Aust, « The Shifting Role of Cities in the Global Climate Change Regime : From Paris to Pittsburgh and Back ? », Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 28, 2019, pp. 57-66.
64 V. p. ex. D.J. Barron, « Foreword : Blue State Federalism at the Crossroads », Harvard Law & Policy Review, Vol. 3, 2009, pp. 1-8 : J. Kron, « Red State, Blue City : How the Urban-Rural Divide is Splitting America », The Atlantic, Boston, 30 November 2012.
65 M. Och, « The Local Diffusion of International Human Rights Norms-Understanding the Cities for CEDAW Campaign », International Feminist Journal of Politics, Vol. 20, n° 3, 2018, pp. 425-443.
66 J. Kalb, « The Persistence of Dualism in Human Rights Treaty Implementation », Yale Law & Policy Review, Vol. 30, 2011, pp. 71-121.
67 V. p. ex. Cour suprême des États-Unis, Crosby v. National Foreign Trade Council (2000), 530 US 363.
68 B. Oomen, M. Baumgärtel, « Frontier cities: The rise of local authorities as an opportunity for international human rights law », European Journal of International Law, Vol. 29, n° 2, 2018, pp. 607-630.
69 Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/presidential-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united.
70 V. p. ex. City and County of San Francisco v. Trump, No. 17-17478 (9th Cir. 2018) ; County of Santa Clara v. Donald J. Trump, 3:17-cv-00574, (N.D. Cal.) ;
71 Executive Order : Protecting American Communities from Criminal Aliens, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/protecting-american-communities-from-criminal-aliens/.
72 « Des maires de villes américaines ‘sanctuaires’ pour les migrants convoqués devant le Congrès », Le Devoir, 5 mars 2025, https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/851731/maires-villes-americaines-sanctuaires-migrants-convoques-devant-congres.
73 « Denver, ville sanctuaire pour les migrants, résiste au plan d’expulsion de masse prévu par le gouvernement des Etats-Unis », Le Monde, 3 mars 2025, https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2025/03/02/denver-ville-sanctuaire-pour-les-migrants-dans-le-viseur-de-trump-je-ne-vais-pas-les-laisser-me-separer-de-ma-famille_6572715_4500055.html.
74 V. p. ex. City of Providence v. United States Department of Justice, No. 19-1802 (1st Cir. 2020).
75 V. p. ex. G. Cartier, « The relationship between the state and the city from a comparative (constitutional) perspective » in P.A. Helmut, E.N. Janne, M.N. Marcenko (ed.), Research handbook on international law and cities, op. cit., pp. 381–397.
76 R. Hirschl, City, State : constitutionalism and the megacity, op. cit., pp. 173-232.
77 Pour un exception v. I. Benslimane, R. Magni-Berton, Libérons nos communes !, Paris, PUF, 2024, 192 p.
78 Y. Blank, « Federalism, Subsidiarity, and the Role of Local Governments in an Age of Global Multilevel Governance », Fordham Urban Law Journal, Vol. 37, 2010, pp. 509-558.
79 M. De Visser, « Constitutionalizing Cities : Realizing Government Agendas or Sites for Denizen Engagement ? », in A. Flynn, R. Albert, N. Des Rosiers (ed.), Cities and the Constitution : Giving Local Governments in Canada the Power They Need, Montreal, Kingston, London, Chicago, McGill-Queen’s UP, 2024, xiv+282 p., pp. 118-138.
80 M.-S. Kuo, « The End of Constitutionalism as We Know It ? Boundaries and the State of Global Constitutional (Dis)Ordering », Transnational Legal Theory, Vol. 1, 2010, pp. 329-369.
81 R. Koselleck, « Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe », in Id., Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichlicher Zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988, 389 p., pp. 211-259, pp. 211, 213.
82 A. Marketou, E. Céleste, G. Tusseau, « Autour de l’ouvrage d’Edoardo Celeste, ‘Digital Constitutionalism : The Role of Internet Bills of Rights’ », Dossier « Constitutionnalisme numérique et approches critiques en droit et technologie », RDLF 2025 chron. n° 49, https://revuedlf.com/droit-constitutionnel/autour-de-louvrage-dedoardo-celeste-digital-constitutionalisme-the-role-of-internet-bills-of-rights/.
83 G. Tusseau, « Taking Chaos Seriously: From Analog to Digital Constitutionalism(s) », 2023, https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2023/11/chaire-digitale-g-tusseau-consitutionalism.pdf.
84 V. p. ex. G. Tusseau, « ¿Descolonizar el derecho constitucional?: algunas dudas y esperanzas sobre un proyecto », in L. Estupiñán Achury, L. Balmant Emerique, Constitucionalismo en clave descolonial, Bogotá, Universidad Libre, 2022, 349 p., pp. 215-239.
85 D. Kennedy, « The Mystery of Global Governance », in J.-L. Dunoff, J.-P. Trachtman, Ruling the World. Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge, Cambridge UP, 2009, xvi+414 p., pp. 37-68, pp. 59-60.
86 R. Bellamy, Political Constitutionalism. A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, Cambridge, Cambridge UP, 2007, x+270 p.
87 Ibid., p. 178.
88 Ibid., pp. 145-175.
89 R.D. Parker, ‘Here the People Rule’. A Constitutional Populist Manifesto, Cambridge, Mass., Harvard UP, 1994, 133 p., pp. 66, 76, 98, 105, 107.
90 S. Gill, The Constitution of Global Capitalism, 2000, http://www.stephengill.com/erkko_inaugural_lecturefor_website.pdf.
91 M. Loughlin, Against Constitutionalism, Cambridge, Mass., Harvard UP, 2022, xi+258 p.
92 V. p. ex. M. Grigolo, The human rights city : New York, San Francisco, Barcelona, op. cit., p. 126.
93 Carta de Ciudadania, Ayuntamiento de Barcelona, 2010, https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
94 F. Furri, « Villes-refuge, villes rebelles et néo-municipalisme », op. cit.
95 Ibid.
96 D. Harvey, Villes rebelles. Du droit à la ville à la révolution urbaine, Paris, Buchet-Chastel, 2015, 296 p.
97 R. Hirschl, City, State : constitutionalism and the megacity, op. cit., p. 182.
98 V. p. ex. N. Brenner, N. Theodore (ed.), Spaces of Neoliberalism : Urban Restructuring in North America and Western Europe, Malden, MA, Oxford, UK, Blackwell, 2002, xi+294 p. ; R.C. Schragger, City Power. Urban Governance in a Global Age, op. cit.
99 R.C. Schragger, « Cities on a Hill ? », Boston Review, 14 février 2018.



