La preuve civile, au cœur des conflits de droits fondamentaux
Géraldine Vial, Maître de conférences à la Faculté de droit de Grenoble, CRJ
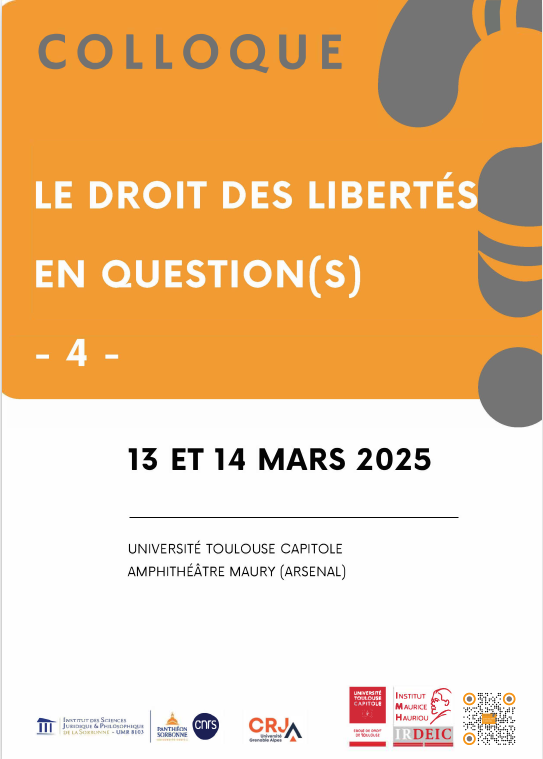 Composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le droit à la preuve a connu une évolution jurisprudentielle majeure ces dernières années. Affirmé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, puis progressivement intégré dans le droit positif français par les différentes chambres de la Cour de cassation, ce droit permet aujourd’hui à chaque partie à un litige, d’obtenir et de présenter les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions. Ainsi consacré, le droit à la preuve a rendu possible la production en justice de preuves illicites, susceptibles de heurter d’autres droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée, les secrets professionnels ou encore le principe de loyauté probatoire. La recevabilité de la preuve est ainsi, progressivement, devenue le terrain d’affrontements de droits subjectifs concurrents.
Composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le droit à la preuve a connu une évolution jurisprudentielle majeure ces dernières années. Affirmé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, puis progressivement intégré dans le droit positif français par les différentes chambres de la Cour de cassation, ce droit permet aujourd’hui à chaque partie à un litige, d’obtenir et de présenter les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions. Ainsi consacré, le droit à la preuve a rendu possible la production en justice de preuves illicites, susceptibles de heurter d’autres droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée, les secrets professionnels ou encore le principe de loyauté probatoire. La recevabilité de la preuve est ainsi, progressivement, devenue le terrain d’affrontements de droits subjectifs concurrents.
Cet article explore les fondements et les implications de cette évolution. Il met en lumière l’ascension du droit à la preuve en tant que droit autonome qui a, dans un premier temps, placé la preuve au cœur de conflits de droits subjectifs concurrents (I), puis la diffusion du contrôle de proportionnalité qui a, dans un second temps, été consacrée comme méthode générale de résolution de ces conflits (II).
I. L’ascension du droit à la preuve : la naissance des conflits de droits en matière probatoire
L’essor du droit à la preuve s’est accompagné d’une double dynamique : d’une part, sa reconnaissance progressive comme droit autonome a permis son enracinement et sa propagation dans les différents contentieux (A) ; d’autre part, cette reconnaissance a suscité l’émergence de tensions avec d’autres droits fondamentaux, conduisant à l’affaiblissement de différents obstacles probatoires et à une reconfiguration du régime de recevabilité des preuves illicites (B).
A. La propagation du droit à la preuve
La notion de droit à la preuve émerge dans la doctrine civiliste au début du XXe siècle1. À l’époque, elle accompagne l’idée d’abandon progressif d’une procédure civile formaliste, héritée du code napoléonien qui limitait la recherche de la preuve, au profit d’une procédure orientée vers la recherche de la vérité matérielle, avec l’introduction, par le « nouveau » Code de procédure civile, des mesures d’instruction destinées à faciliter l’administration de la preuve2.
Un prolongement du droit à un procès équitable. À partir des années 90, sous l’impulsion des exigences conventionnelles issues de l’article 6 § 1 CESDH, le droit à la preuve acquiert une dimension nouvelle : il s’inscrit désormais dans le prolongement direct du droit à un procès équitable qui implique que chaque partie soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, et des nouvelles prérogatives qui en découlent3. La Cour de cassation l’envisage ainsi sous l’angle du principe d’égalité des armes4 – qui implique que chaque partie à un procès doit pouvoir présenter ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire – ou encore des droits de la défense5.
Un droit autonome. Le droit à la preuve a, par la suite, été expressément reconnu en tant que droit autonome par la Cour européenne dans ses arrêts L.L. c/ France6 et N.N et T.A. c/ Belgique7, puis par la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 5 avril 20128. Dans cet arrêt, la Cour a décidé qu’une lettre confidentielle, portant atteinte à la vie privée de son auteur et au secret des correspondances qui en découle, était recevable en justice, dès lors qu’elle s’avérait indispensable à l’exercice du « droit à la preuve » de la partie qui l’invoquait. Initialement affirmé en matière civile, le droit à la preuve s’est ensuite propagé de manière transversale, dans les différentes chambres de la Cour de cassation, notamment dans les contentieux commercial9 et social10.
Les différentes prérogatives du droit à la preuve. Le droit à la preuve se compose de deux prérogatives distinctes11 : d’une part, le droit pour une partie de produire en justice un élément de preuve qu’elle détient (un mail, une attestation, des images, des enregistrements, un rapport d’enquête privée…), d’autre part, celui d’obtenir, de la part du juge, un élément de preuve qu’elle ne détient pas (au moyen de la production forcée de pièces ou de la réalisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile)12. Cette propagation du droit à la preuve s’est effectuée dans le même temps pour ses deux volets. Concernant la production spontanée d’une preuve que la partie détient, un arrêt de la chambre sociale a ainsi, par exemple, considéré que la production de photos et documents contenant des informations personnelles d’un salarié – par des délégués du personnel pour établir le non-respect du repos dominical par l’employeur – portant atteinte à la vie privée du salarié, se trouvait « justifiée par le droit à la preuve dès lors que cette production était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte était proportionnée au but poursuivi »13. Il en est allé de même concernant la production ordonnée par le juge d’une preuve que la partie ne détient pas. Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que « la communication des documents litigieux, nécessaire à la solution du litige pouvait être exigée de la banque sans que celle-ci puisse invoquer les règles du secret bancaire »14.
Le droit à la preuve présente la particularité d’être mobilisé par une partie au procès lorsque la preuve, recherchée ou produite en justice, porte atteinte à un intérêt antinomique. L’adversaire va alors s’opposer à la recevabilité de cette preuve en soulevant son caractère illicite et son rejet consécutif des débats. C’est dans ce contexte conflictuel que le droit à la preuve va produire son effet.
B. L’assaut du droit à la preuve contre les preuves illicites
Sous certaines conditions, le droit à la preuve va rendre recevables en justice des éléments de preuves illicites qui devraient, à ce titre, être écartés des débats.
L’identification des preuves illicites. Un élément de preuve peut être considéré comme illicite pour trois motifs. Tout d’abord, une preuve peut être illicite en ce qu’elle a été recherchée ou produite en violation d’une règle de droit. C’est le cas d’une preuve obtenue par la réalisation d’une infraction ; par exemple, une preuve volée à l’adversaire15. C’est encore le cas de la preuve issue d’un traitement de données personnelles en violation des prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)16, ou de la preuve provenant de la géolocalisation d’un salarié, réalisée en violation de l’article L.1121-1 du Code du travail17. Une preuve peut ensuite être considérée comme illicite en ce qu’elle provient de la violation d’un autre droit également protégé. Il peut s’agir d’un droit de la partie adverse ou bien du droit d’un tiers. Parmi ces droits figurent notamment le respect de la vie privée, le secret des correspondances, le secret bancaire, le secret professionnel de l’avocat, le secret médical ou encore le secret des affaires. C’est ainsi par exemple, que sont illicites en ce qu’ils portent atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée : le rapport de filature de l’enquêteur privé ayant suivi cette personne18, le message publié par cette personne sur son compte privé Facebook19 ou encore les images de la personne sur son balcon prises depuis la voie publique20 ou issues d’une vidéosurveillance installée par son employeur dans les locaux de l’entreprise dans laquelle elle travaille21. De la même manière, est illicite en ce qu’elle porte atteinte au secret bancaire, la production spontanée par une banque des relevés de compte de sa cliente, pour obtenir le remboursement des retraits effectués22 ou encore la production forcée des copies de verso de chèques utilisées par le tireur pour engager la responsabilité civile de la banque23. Une preuve peut enfin être jugée illicite en ce qu’elle a été obtenue de manière déloyale. Une preuve déloyale est une preuve qui a été obtenue par une partie en piégeant son adversaire. Elle peut revêtir deux formes. La première est celle de la preuve recueillie de manière clandestine, c’est-à-dire à l’insu de l’adversaire. Tel est le cas de la preuve qui provient d’une filature, d’une vidéosurveillance, d’une géolocalisation ou de la captation de propos ou d’images, sans information de la personne concernée. La seconde forme de déloyauté correspond à la mise en œuvre d’un stratagème. La preuve n’est plus seulement obtenue à l’insu de l’adversaire ; elle est recueillie grâce à l’élaboration d’un plan ou d’une mise en scène. Tel est le cas de la pratique des « clients mystères »24 ou encore de celle des « lettres festives »25 (cf. infra). Le stratagème peut viser soit, à constater l’existence de la faute (provocation à la preuve), soit à provoquer la réalisation de celle-ci (provocation à la faute, encore appelée « provocation à l’infraction » en matière pénale). Autrement dit, la faute qui est constatée, n’aurait pas été commise sans la réalisation du stratagème.
Le régime des preuves illicites. Il existe une multiplicité de régimes associés aux preuves illicites. Autrement dit, toutes les preuves illicites ne suivent pas le même régime juridique. Par exemple, lorsqu’une preuve illicite a été formalisée dans un acte de procédure (comme peut l’être une expertise judiciaire), elle ne peut être contestée que par la voie de la nullité et doit, pour ce faire, suivre les conditions posées par le Code de procédure civile exigeant notamment la preuve d’un grief (art. 175)26. La preuve illicite en raison d’une violation du principe du contradictoire (par exemple, la pièce qui a été communiquée tardivement ou qui n’a pas été communiquée à l’adversaire27) suit, quant à elle, un autre régime. Le respect du contradictoire est en effet considéré comme un principe intangible et la preuve non contradictoire ne peut jamais être admise aux débats28.
À ces deux catégories particulières de preuves illicites s’ajoute celle, plus générale, des preuves obtenues en violation d’une règle de droit ou d’un autre droit également protégé. Longtemps, ces preuves illicites ont été automatiquement écartées des débats29. Ce principe d’exclusion automatique structurait l’ensemble du contentieux probatoire civil. Toutefois, à partir de 2007, puis de manière plus affirmée à compter de 2012, cette conception rigide a progressivement cédé sous l’effet de la reconnaissance croissante du droit à la preuve comme droit fondamental autonome. Le premier assouplissement est intervenu dans le champ des atteintes à la vie privée. Dans un arrêt du 15 mai 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis, à propos de la production de pièces concernant la vie privée de l’une des parties, qu’« une atteinte à la vie privée peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence »30. Ce raisonnement dessinait déjà une mise en balance entre le droit de prouver (rattaché à l’époque au principe d’égalité des armes31) et le droit antinomique en présence, en l’occurrence le droit au respect de la vie privée. Quelques années plus tard, la consécration explicite du droit à la preuve par l’arrêt du 5 avril 201232 a marqué un tournant. En reconnaissant que la production d’une lettre confidentielle, portant atteinte à la vie privée de son auteur, est admissible si elle est « indispensable à l’exercice du droit à la preuve » de la partie qui l’invoque, cet arrêt est venu rompre clairement avec la logique binaire antérieure : l’illicéité de la preuve obtenue en violation du respect de la vie privée ne justifie plus son rejet automatique des débats.
Cette évolution s’est ensuite étendue à d’autres domaines, notamment aux secrets juridiquement protégés (secret bancaire33, secret professionnel de l’avocat34, secret médical35, secret des affaires36) progressivement considérés comme des obstacles relatifs, pouvant dorénavant céder face au droit à la preuve de la partie adverse37.
La barrière de la loyauté probatoire a, quant à elle, résisté plus longtemps. L’arrêt d’Assemblée plénière du 7 janvier 201138 réaffirmait encore son caractère infranchissable en matière civile, en consacrant l’exclusion systématique des procédés probatoires obtenus au mépris de la loyauté39. Par exemple, la pratique dite des « lettres festives » visant à utiliser des enveloppes qui libèrent une encre indélébile lorsqu’elles sont ouvertes, afin d’identifier l’auteur de leur ouverture, mise en œuvre par la Poste pour piéger des facteurs qu’elle soupçonnait, a été jugée déloyale et, par conséquent, non admise à faire la preuve des actes suspectés40. Il en est encore ainsi de la technique dite du « client mystère » consistant pour un faux client à se présenter chez un professionnel pour réaliser un acte d’achat aux fins de démontrer que ce professionnel commet une fraude. Cette pratique a été jugée déloyale par la chambre commerciale de la Cour de cassation et le mode de preuve ainsi obtenu a été automatiquement écarté des débats41. Mais cette exclusion rigoureuse a fini par céder face à l’essor du droit à la preuve. C’est l’arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 202342 qui a mis un terme définitif à cette logique d’éviction automatique. Dans le sillage de la jurisprudence de la CEDH considérant qu’une preuve déloyale n’a pas à être automatiquement écartée des débats43, la Cour de cassation a décidé dans cet arrêt de principe qu’une preuve déloyale – obtenue au moyen d’un stratagème ou à l’insu de la personne concernée – peut être admise aux débats devant le juge civil, à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte qu’elle porte au droit concurrent soit proportionnée au but poursuivi. Cette solution généralise le raisonnement par mise en balance et consacre ainsi un changement de paradigme, en transférant au juge du fond la charge de trancher, au cas par cas, le conflit entre des droits fondamentaux de valeur équivalente.
Ce basculement ouvre la voie à une nouvelle méthode d’évaluation : le contrôle de proportionnalité, désormais érigé en outil privilégié de résolution des conflits entre le droit à la preuve et les droits antinomiques, dans l’ensemble du contentieux probatoire (II).
II. La diffusion du contrôle de proportionnalité : la consécration d’une méthode de résolution des conflits de droits
Bien qu’elle soit justifiée par le respect du droit à la preuve des parties, la recevabilité d’une preuve illicite aux débats provoque nécessairement un conflit de droits et, par conséquent, un arbitrage juridictionnel. Cet arbitrage prend alors la même forme que le contrôle des droits fondamentaux réalisé dans la jurisprudence de la Cour européenne.
Progressivement imposé aux juges du fond par les différentes chambres de la Cour de cassation44, dans la lignée de la jurisprudence de la CEDH, cet arbitrage doit être réalisé in concreto, en fonction des intérêts et des circonstances de l’espèce. Plus précisément, il consiste à analyser la recevabilité de l’élément de preuve au prisme d’une grille de lecture à trois niveaux (A). Pour guider les juges du fond dans cette tâche, une typologie jurisprudentielle des atteintes admissibles semble aujourd’hui se dessiner (B).
A. Une grille de lecture à trois niveaux
Pour statuer sur la recevabilité d’un élément de preuve, la Cour de cassation impose aux juges du fond d’identifier tout d’abord, le caractère illicite de la preuve (atteinte à une règle, à un droit ou obtention déloyale), puis de vérifier son caractère indispensable et enfin, d’apprécier si l’atteinte portée au droit de l’adversaire par la recherche ou la production de la preuve est proportionnée au but poursuivi.
Une preuve illicite. La première étape du contrôle de proportionnalité consiste à identifier la source de l’illicéité de la preuve. Comme nous l’avons vu précédemment, celle-ci peut provenir d’une atteinte au respect de la vie privée (par exemple, la production d’un rapport de filature réalisée par un enquêteur privé), à un secret juridiquement protégé (telle la production de documents couverts par le secret médical ou le secret bancaire) ou encore au principe de loyauté probatoire (par exemple, lorsqu’une partie produit aux débats un enregistrement réalisé à l’insu de l’adversaire). Si l’atteinte est caractérisée, le mode de preuve est illicite mais il n’est plus, en tant que tel, automatiquement écarté des débats. Son admission doit donner lieu à un examen au cas par cas par les juges du fond. Il leur revient de mesurer l’impact de cet élément de preuve sur l’issue du litige. Pour cela, ils vont devoir, lors d’une deuxième étape, s’interroger sur son caractère nécessaire ou indispensable.
Une preuve nécessaire ou indispensable. Le contrôle de proportionnalité utilisé par la Cour européenne impose une mise en balance entre la « nécessité » de rapporter la preuve et le respect du droit antinomique en présence (respect de la vie privée, secret ou loyauté). Dans l’arrêt du 5 avril 2012, ayant imposé ce contrôle de proportionnalité en droit interne, la première chambre civile de la Cour de cassation a renforcé cette exigence de nécessité en imposant que la production de la preuve soit « indispensable » à l’exercice du droit à la preuve de l’adversaire pour pouvoir être admise aux débats45. La première chambre civile est, par la suite, restée fidèle à cette exigence46. Tel n’a pas été le cas des autres chambres de la Cour de cassation ayant fluctué, au fil de leurs décisions, de l’adjectif « indispensable » à celui de « nécessaire ». C’est ainsi que la deuxième chambre civile et la chambre commerciale se sont, dans certains arrêts, contentées du caractère « nécessaire »47 de l’élément de preuve ; tandis que la chambre sociale semble être passée du caractère « nécessaire » à celui d’« indispensable » à partir d’un arrêt du 30 septembre 202048. Si le terme « nécessaire » renvoie à la notion de preuve utile à la solution du litige, le caractère « indispensable » signifie que la partie ne peut pas se passer de l’élément de preuve pour établir le fait invoqué. La preuve ne se contente pas d’être utile, elle est déterminante pour soutenir la prétention du plaideur. L’arrêt rendu en Assemblée plénière le 22 décembre 202349 a mis fin à l’incertitude en posant expressément l’exigence d’une preuve « indispensable ». Il ne suffit plus de démontrer que la preuve facilite la démonstration d’un fait litigieux ; il faut désormais établir qu’elle est unique ou décisive pour le succès de la prétention. À la suite de cet arrêt de principe, plusieurs décisions ont permis de saisir la portée de cette clarification. Par exemple, dans une affaire où un salarié produisait un enregistrement clandestin pour prouver un harcèlement moral, la chambre sociale a jugé que cette preuve n’était pas indispensable, car d’autres éléments permettaient déjà de supposer l’existence du harcèlement50. La preuve illicite était redondante et, par conséquent, irrecevable. En revanche, dans une autre affaire, un enregistrement clandestin a été jugé indispensable pour établir un accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur, car la victime ne pouvait s’appuyer sur d’autres témoignages51.
Ainsi, la preuve indispensable est celle qui, par son caractère unique ou décisif, justifie une atteinte aux droits antinomiques ; encore faut-il toutefois que cette atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Une atteinte proportionnée. Ce dernier point de contrôle doit être analysé de manière indépendante du caractère indispensable de la preuve. Il doit faire l’objet d’une appréciation autonome. L’analyse de la proportionnalité suppose d’évaluer, au cas par cas, l’intensité de l’atteinte portée au droit de l’adversaire en fonction du but poursuivi par la preuve. Plus la méthode employée pour obtenir la preuve est intrusive, plus l’atteinte devra être justifiée par l’importance de l’enjeu du litige. Par exemple, la captation clandestine d’une conversation ponctuelle peut être admise aux débats si elle permet d’établir des actes de harcèlement grave52. De même, la production de photographies de la défenderesse se trouvant sur son balcon, réalisées depuis la voie publique, est autorisée si elle se réduit à établir la simple constatation de l’absence de port de lunettes de la partie adverse53. Est encore proportionnée (au but poursuivi par l’entreprise, en l’occurrence le droit de veiller à la protection de ses biens), la production par l’employeur de données personnelles d’une salariée, issues d’un système de vidéosurveillance54. Dans ces différents exemples, les éléments de preuve portent atteinte au respect de la vie privée de l’adversaire mais cette atteinte est jugée proportionnée au regard du but poursuivi par la preuve. La proportionnalité tient soit au caractère léger de l’atteinte (les vues sur le balcon), soit à l’importance du but poursuivi (établir des actes de harcèlement ou protéger ses biens). À l’inverse, la surveillance continue d’un assuré, ainsi que de ses proches, réalisée par un enquêteur privé à la demande d’un assureur, pendant plusieurs semaines, pour vérifier le degré de mobilité et d’autonomie de l’assuré constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’assuré55. On comprend ici qu’une atteinte d’une telle intensité ne peut être justifiée par la seule défense des intérêts patrimoniaux de l’assureur.
De ces différents exemples ressort l’idée que la mise en œuvre du critère de proportionnalité suppose une gradation de l’atteinte portée par la preuve au droit antinomique de l’adversaire.
B. Vers une typologie jurisprudentielle des atteintes admissibles ?
Concernant l’atteinte à la vie privée de l’adversaire, la jurisprudence établit implicitement une échelle des degrés d’intrusion réalisée par la recherche de la preuve, allant du comportement légèrement intrusif (telle une filature discrète ou une photographie prise sur la voie publique) au comportement très intrusif (telle une filature réalisée pendant plusieurs mois). Puisque la recevabilité de la preuve déloyale suit aujourd’hui le même régime que celui de la preuve attentatoire à la vie privée, les juridictions du fond vont désormais avoir pour mission de hiérarchiser les différents procédés déloyaux, pouvant s’échelonner de la simple clandestinité jusqu’au piège tendu. Nous pourrions ainsi trouver au premier degré de cette hiérarchie, les preuves ayant été obtenues à l’insu de l’adversaire (enregistrements, filatures…) ; au second degré, les preuves provoquées par la mise en œuvre d’un stratagème et au sommet, les situations de provocations à la faute, dans lesquelles le stratagème engendre la faute qu’il prétend révéler.
Si elle peut sembler simple en apparence, cette hiérarchisation des procédés probatoires déloyaux soulève tout de même des difficultés de mise en œuvre. La frontière entre un stratagème et la simple clandestinité est parfois difficile à tracer. Par exemple, la vidéosurveillance clandestine permet d’obtenir une preuve à l’insu de l’adversaire mais elle suppose également la mise en place d’un dispositif technique préalable d’enregistrement de l’image pouvant s’apparenter à un stratagème… Les juges du fond vont donc se trouver confrontés à la difficulté de mesurer le degré de l’atteinte portée par la preuve au principe de loyauté.
En définitive, en quelques années, l’essor du droit à la preuve, érigé au rang de droit fondamental autonome, est venu bouleverser les équilibres probatoires existants en matière civile. Sous l’impulsion de la CEDH, puis de la Cour de cassation, cette évolution a donné naissance à un contentieux en pleine croissance56 et complexe, dans lequel l’illicéité de la preuve n’est plus synonyme d’irrecevabilité. Au cœur de cette évolution, le contrôle de proportionnalité s’est imposé, conférant désormais aux juges du fond un rôle central dans la conciliation des droits en conflit. Imposant à ces juges la délicate mission d’apprécier in concreto la manière dont la preuve a été obtenue, cette nouvelle approche modifie le raisonnement judiciaire sur les preuves. Elle introduit une part de subjectivité dans l’examen des procédés probatoires, susceptible d’engendrer des solutions divergentes selon les juridictions du fond. Elle incite également les plaideurs à tenter leur chance en utilisant des procédés probatoires audacieux, mais également fragiles devant le contrôle juridictionnel.
1 V. not. A. Bergeaud, Le droit à la preuve, LGDJ, 2010, n°5 ; G. Lardeux, « Le droit à la preuve : tentative de systématisation », RTD civ. 2017, p. 1.
2 V. not. R. Perrot, « Le droit à la preuve », in Effectiveness of judicial protection and constitutional order, W. J. Habscheid (dir.), 1983, p. 96.
3 CEDH, 27 oct. 1993, Dombo Beheer c/ Pays-Bas, req. n° 14448/88.
4 V. not. Cass. Com., 15 mai 2007, n° 06-10.606 : « le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions » est contraire au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable.
5 V. not. Cass. Civ.1, 16 oct. 2008, n° 07-15.778.
6 CEDH, 10 oct. 2006, L.L. c/ France, req. n° 7508/02.
7 CEDH, 13 mai 2008, N.N et T.A. c/ Belgique, req. n° 65097/01.
8 Cass. Civ.1, 5 avr. 2012, n° 11-14.177.
9 Voir not. Cass. Com. 24 mai 2018, n° 17-27.969.
10 Voir not. Cass. Soc., 9 nov. 2016, n°15-10.203 ; 30 sept. 2020, n°19-12.058.
11 Voir not. G. Goubeaux, « Le droit à la preuve », in La preuve en droit, Ch. Perelman et P. Foriers (dir.), Bruylant, 1981, p. 277.
12 Voir not. sur cette distinction : E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF, Coll. Thémis, 2è éd., 2022, n° 276 et s.
13 Cass. Soc. 9 nov. 2016, arrêt précit.
14 Cass. Com. 24 mai 2018, arrêt précit.
15 Voir par ex : Cass. Com. 31 janv. 2012, n° 11-13.097 concernant des documents volés produits à titre de preuve.
16 Voir par ex : Cass. Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802 concernant une preuve par vidéosurveillance.
17 Selon ce texte, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Voir par ex : Cass. Soc. 14 févr. 2024, n° 21-19.802.
18 Par exemple : Cass. Civ. 1, 5 févr. 2014, n° 12-20.206.
19 Cass. Soc. 30 sept. 2020, arrêt précit.
20 Cass. Civ. 1, 10 sept. 2014, n° 13-22.612.
21 Cass. Soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073.
22 Cass. Com., 4 juill. 2018, n° 17-10.158.
23 Cass. Com., 15 mai 2019, n° 18-10.491.
24 Cass. Com., 10 nov. 2021, n° 20-14.669 et n° 20-14.670. Voir déjà en ce sens, Cass. Com., 26 sept. 2013, n° 12-23.387.
25 Cass. Soc., 4 juill. 2012, n° 11-30.266.
26 Voir not. Cass. Civ. 2, 31 mars 2013, n° 12-16.995 ; 29 nov. 2012, n° 11-10.805 ; 26 sept. 2019, n° 18-18.054.
27 Cass. Civ. 2, 25 nov. 1981, n° 78-13.880.
28 Cass. Civ. 1, 3 mars 1998, n° 96-10.142.
29 V. par exemple : Cass. Soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852.
30 Cass. Com., 15 mai 2007, arrêt précit.
31 Cf. supra.
32 Cass. Civ.1, 5 avr. 2012, arrêt précit.
33 Cass. Com., 4 juill. 2018, arrêt précit. et Cass. Com., 15 mai 2019, arrêt précit.
34 Cass. Civ. 1, 6 déc. 2023, n° 22-19.285 : « le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 CPC dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l’avocat, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates ».
35 Cass. Soc., 29 mai 2024, n° 23-12.856 : « La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Il appartenait [à la CA] de rechercher si la production des pièces litigieuses n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte au secret médical n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
36 Cass. Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954 et 5 févr. 2025, n° 23-10.953.
37 Seul le secret professionnel du notaire semble avoir résisté et demeure, pour l’instant, intangible. Voir Cass. Civ.1, 4 juin 2014, n° 12-21.244 : « le droit à la preuve (…) ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle l’impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret ».
38 Cass. Ass. plén. 7 janv. 2011, n° 09-14.316.
39 Voir not. Cass. Com., 25 fév. 2003, n° 01-02.913 ou Cass. Civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-13.082.
40 Cass. Soc., 4 juill. 2012, n° 11-30.266, arrêt précit.
41 Cass. Com., 10 nov. 2021, n° 20-14.669 et 20-14.670, arrêts précit.
42 Cass. Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648.
43 Voir not. CEDH, Gde ch., 5 sept. 2017, Bărbulescu c/ Roumanie (mail obtenu par l’employeur). CEDH, Gde ch., 17 oct. 2019, López Ribalda c/ Espagne (captations vidéos réalisées à l’insu des salariés). CEDH, 13 déc. 2022, Florinda de Almeida Vasconcelos Gramaxo c/ Portugal (géolocalisation du véhicule d’un salarié).
44 Voir not. Cass. Soc., 25 nov. 2020, n° 17-19.523 et Cass. Com., 1er déc. 2021, n° 19-22.135.
45 Cass. Civ.1, 5 avril 2012, arrêt précit.
46 Voir not. Cass. Civ.1, 5 juill. 2017, n° 16-22.183 ; Cass. Civ.1, 6 déc. 2023, arrêt précit.
47 Voir not. Cass. Com., 1er déc. 2021, arrêt précit ; Cass. Civ. 2, 23 nov. 2023, n° 23-15.993.
48 Cass. Soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058 ; 1er juin 2022, n° 21-15.991 et 5 avr. 2023, n° 21-20.254.
49 Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2023, arrêt précit.
50 Cass. Soc. 17 janvier 2024, n° 22-17.474.
51 Cass. Civ. 2e, 6 juin 2024, n° 22-11.736.
52 Cass. Soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900.
53 Cass. Civ. 1, 10 sept. 2014, arrêt précit.
54 Cass. Soc., 14 fév. 2024, arrêt précit.
55 Voir par ex. : Cass. Civ.1, 22 sept. 2016, n° 15-24.015.
56 L’étude des bases de données montre qu’au cours des cinq dernières années, 195 arrêts ont été rendus par la Cour de cassation sur la conciliation entre droit à la preuve et intérêts antinomiques.



