La stratégie des parties devant la Cour européenne des droits de l’homme
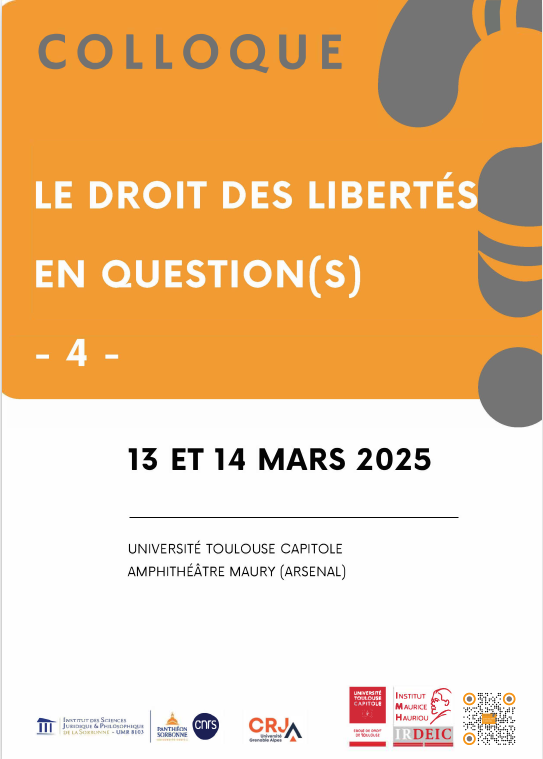 Thibaut Larrouturou, professeur à l’Université Évry Paris-Saclay, CRLD, Ancien référendaire à la Cour européenne des droits de l’homme
Thibaut Larrouturou, professeur à l’Université Évry Paris-Saclay, CRLD, Ancien référendaire à la Cour européenne des droits de l’homme
Puisque nos sociétés modernes ont fait du procès le mode de résolution privilégié de tous les conflits, qu’ils soient interindividuels ou opposent des personnes aux autorités étatiques, il n’est pas étonnant qu’une partie du vocabulaire autrefois réservé aux affrontements physiques ait trouvé son chemin vers le prétoire du juge. Il n’est qu’à penser au principe d’égalité des armes, expression qui inviterait sans doute un enfant à imaginer un tournoi de chevaliers plutôt qu’une bataille juridique. La stratégie, du grec stratêgia, l’art de conduire une armée, est l’un de ces termes issus du domaine militaire implantés avec succès dans le champ du droit. Il faut admettre qu’il s’y acclimate particulièrement bien : dans son sens contemporain d’ensemble d’actions conçues, menées et coordonnées dans le but d’atteindre une fin précise, il peut parfaitement correspondre à l’action des acteurs juridiques, particulièrement lorsqu’ils se résolvent à saisir un juge.
Ou plus précisément à l’action d’une partie de ces acteurs juridiques. Si Jules César a bien conçu et mis en œuvre une stratégie pour conquérir la Gaule, l’action d’un petit groupe de pillards attaquant un village aux marches de l’Empire romain lorsque le besoin s’en faisait sentir ne pouvait pas bénéficier d’un tel label. De la même manière, un justiciable se lançant maladroitement, sans conseil juridique, dans un recours pour lequel la représentation n’est pas obligatoire ne met pas en œuvre une stratégie juridique au sens strict, là où un grand groupe solidement appuyé par des cabinets d’avocats, mesurant ses actions possibles et pesant finement les avantages et inconvénients de tel ou tel recours, en déploie bel et bien une. La stratégie contentieuse suppose un niveau de conscientisation des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre qui rend malaisée sa délimitation. Il s’agit là d’une première difficulté liée à l’usage de cette notion dans le champ du droit : il faut se garder de percevoir des stratégies partout, mais sans pouvoir identifier avec précision là où elles naissent.
Un deuxième obstacle relatif à l’étude, par les juristes, de la stratégie réside dans les limitations de la science du droit : dans la mesure où tous les moyens développés par les parties ne sont pas nécessairement des outils juridiques, et où les fins poursuivies par elles ne sont pas toujours évidentes – elles recèlent une part de non-dit, voire de secret ou de tromperie –, le juriste peut être déboussolé lorsqu’il s’aventure sur le terrain de la stratêgia. La seule étude des décisions juridictionnelles, ainsi que des écritures des parties s’il y a accès, ne lui donnera jamais qu’une vision très parcellaire de l’action contentieuse en jeu dans un litige donné. Il en va d’autant plus fort que la stratégie juridique n’est pas enseignée en tant que telle à l’université. En effet, la plupart de nos enseignements se limitent à apprendre aux étudiants comment fonctionne telle ou telle branche du contentieux, mais délaissent la question du pourquoi une partie peut avoir intérêt à activer ou non un mécanisme juridique, à soulever ou non un moyen, dans une logique propre à l’acteur concerné – les chances de succès sont loin d’être la seule aune à laquelle se mesure l’intérêt d’agir en justice. La question des moyens non juridiques déployés au soutien d’une stratégie contentieuse ne manque pas non plus d’intérêt.
Une troisième difficulté de l’appréhension de la stratégie se dissimule dans le fait que les parties sont loin d’être les seules à en déployer une dans le cadre d’un procès, de sorte que les moyens qu’ils utilisent comme les objectifs qu’ils poursuivent sont susceptibles d’interférer avec d’autres.
En premier lieu, en effet, un certain nombre de tiers peuvent avoir des buts et mettre en œuvre des moyens pour les réaliser. Il peut s’agir, d’une part, d’acteurs qui interviendront officiellement dans le procès, à l’instar des « tiers intervenants » devant la Cour européenne des droits de l’homme – États non mis en cause dans l’affaire, organisations non gouvernementales, institutions, universitaires… Pour eux, la décision de s’immiscer ou non dans un procès comporte une dimension stratégique en termes de ressources, d’utilité ou encore de positionnement institutionnel. Il peut également s’agir, d’autre part, de tiers restant parfaitement extérieurs à l’instance, et qui peuvent chercher à garder le secret sur leur participation indirecte à celle-ci – à l’instar des maisons mères de sociétés parties au procès, ou d’organisations qui financent et impulsent en sous-main des actions contentieuses afin de faire avancer leur agenda. La logique contentieuse d’une juridiction donnée peut favoriser ces mouvements d’ombres. Par exemple, la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui refuse que des associations la saisissent lorsqu’elles n’ont pas été victimes d’une violation de leurs droits propres 1, conduit beaucoup d’entre elles à pousser certains de leurs membres ou de leurs sympathisants à mener une action devant la Cour qu’elles auraient sinon entreprise.
En second lieu, les juridictions elles-mêmes peuvent être amenées à concevoir et appliquer des stratégies, singulièrement les juridictions suprêmes, dans des buts de bonne administration de la justice, de correcte exécution de leurs décisions ou encore de renforcement de l’acceptabilité de ces dernières. L’exemple de la Cour européenne des droits de l’homme est là encore éclairant. Depuis 2021, tous ses rapports annuels font état de stratégies de gestion des contentieux – sans hélas les expliciter réellement. Celles-ci peuvent avoir une influence directe sur le temps mis pour adopter un arrêt donné, à l’instar des politiques de priorisation. Elles peuvent aussi, et c’est plus notable, avoir une incidence sur le contenu même de l’arrêt. Pour ne prendre que quelques exemples, la décision d’adopter ou non un arrêt-pilote dans une affaire donnée a évidemment des conséquences drastiques sur la détermination des obligations de l’État défendeur et sur leur suivi en termes d’exécution 2 ; la décision d’accorder une satisfaction équitable plus ou moins généreuse peut avoir des effets décisifs sur les plaideurs qui pourraient être tentés d’imiter un requérant victorieux s’agissant d’un problème répétitif ou structurel ; la décision d’étudier individuellement des milliers de requête ou de les rayer du rôle pour confier leur sort au Comité des ministres est déterminante pour la juridiction comme pour les requérants 3. Tous ces choix de la juridiction strasbourgeoise poursuivent des buts précis, déterminés par la formation de jugement mais régulièrement évoqués en interne au-delà de ce cadre, et prennent la forme de moyens juridiques utilisés afin de les atteindre.
Malgré ces divers écueils, s’intéresser aux seules stratégies déployées par les parties – nécessité dictée à la fois par des raisons de cohérence du propos et de faisabilité dans le cadre d’un colloque – peut s’avérer particulièrement instructif pour deux raisons principales. La première est que le développement de ces stratégies révèle bien des choses quant à l’évolution du droit et à la place du juge dans nos démocraties. Pour ne prendre qu’un exemple en matière de droits et libertés, la multiplication des ordres juridiques qui les garantissent et des juridictions ou quasi-juridictions qui les protègent ouvre un vaste éventail de moyens juridiques à disposition des requérants, dont l’usage ou le non-usage dit beaucoup des rapports entre le législateur et la figure du juge, ou encore des qualités respectives de chaque ordre juridique et de chaque institution internationale. La seconde raison pour laquelle l’examen des stratégies des parties est potentiellement particulièrement intéressant réside dans leur capacité d’influence sur la jurisprudence d’une juridiction donnée, ainsi que sur sa pratique interne. Les actions et abstentions des requérants entraînent nécessairement des réactions de la part des acteurs juridictionnels, qui contribuent à façonner l’état du droit substantiel comme du droit du contentieux.
L’ambition doit toutefois rester raisonnable, l’identification des stratégies des parties étant à elle seule une tâche difficile, pour laquelle il paraît bien délicat de prétendre à l’exhaustivité en l’absence d’une longue pratique du conseil aux requérants et aux gouvernements défendeurs. Or, sur ce terrain, malgré les oublis qu’expliquent les insuffisances de l’expérience et de l’imagination de l’auteur de ces lignes, ce qui frappe est la grande variété qui règne dans la pratique des parties au procès européen, aussi bien quant aux buts qu’elles poursuivent (I) qu’en matière de moyens qu’elles déploient (II).
I- La pluralité des buts recherchés par les parties
Que recherche un requérant qui saisit la Cour européenne des droits de l’homme ou un gouvernement appelé à se défendre devant elle ? La réponse est, dans la grande majorité des cas, unique et particulièrement simple : à emporter le procès européen, ce qui se traduit pour le premier par un arrêt de violation et pour le second par une décision d’irrecevabilité ou un arrêt de non‑violation. Encore faut-il souligner que cet objectif peut être une fin en soi (le requérant recherche la reconnaissance de sa qualité de victime d’une violation de ses droits fondamentaux et/ou la réparation de son préjudice par l’octroi d’une satisfaction équitable), comme il peut s’inscrire dans une stratégie plus large visant à obtenir des gains par ricochet (la réouverture d’une procédure interne ou la modification par les autorités nationales d’un état du droit jugé inconventionnel). Constitue un cas d’école de cette dernière hypothèse la stratégie de l’Observatoire international des prisons au sujet des conditions de détention : elle assume avoir impulsé des recours individuels devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont donné lieu à l’arrêt J.M.B. et autres c/ France 4, avant de téléguider une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel sur ce même sujet 5. L’objectif était de bénéficier d’une certaine forme d’audace sur ce sujet de la Cour de Strasbourg, afin de forcer la main de la juridiction de Montpensier dans un second temps et de profiter de la sorte de l’effet juridique erga omnes de l’abrogation de la loi litigieuse. Tous les requérants n’ont ainsi pas la même vision de ce que la victoire signifie. Néanmoins, de façon bien plus remarquable, il peut être soutenu qu’il existe nombre de cas dans lesquels l’objectif peut ne pas être seulement de gagner – l’ambiguïté stratégique (A) – et même un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles l’objectif n’est tout simplement pas de gagner – le repli stratégique (B).
A- L’ambiguïté stratégique des parties
Dans un certain nombre d’hypothèses, la victoire n’est pas la seule, voire n’est pas la principale motivation qui se cache derrière une saisine de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans de telles configurations, les requérants ne renâcleraient pas à voir leurs prétentions l’emporter devant le juge strasbourgeois, bien au contraire, mais peuvent très bien s’accommoder d’une défaite car la seule saisine de ce dernier leur apporte des avantages réels ou supposés.
Les considérations médiatiques et sociétales sont, dans cette optique, parmi les principales qui peuvent être intégrées dans la stratégie d’une partie. La saisine de la Cour peut en ce sens s’inscrire dans une volonté d’attirer l’attention des médias ou du public sur une affaire donnée ou sur une cause précise, et être envisagées dès lors en partie comme une caisse de résonance. Les requêtes initiées par la chaîne de télévision C8 paraissent pouvoir s’inscrire dans ce cadre 6. La saisine très médiatisée de la Cour dans certaines affaires climatiques peut également sans doute être appréhendée par le prisme d’une volonté de placer le changement climatique au cœur du débat politique, médiatique et sociétal 7. Dans une logique tout à fait inversée, affirmer sa volonté de saisir la Cour peut être considéré comme une forme de contre-feu dans des affaires soumises à une attention médiatique indésirable du point de vue du justiciable concerné. Ce n’est pas un hasard si les hommes politiques condamnés pénalement annoncent systématiquement se tourner vers la Cour européenne des droits de l’homme, quand bien même d’ailleurs ils critiquent par ailleurs vertement celle‑ci, voire proposent de dénoncer la Convention : montrer une détermination judiciaire totale et laisser le lecteur d’un article de presse sur les points de suspension ouverts par la saisine d’une juridiction internationale constituent des objectifs à part entière d’une saisine du juge européen. L’idéal est alors, à défaut d’un arrêt de condamnation de l’État, une discrète décision de juge unique à laquelle aucun média n’aura ainsi accès, afin d’éviter de nouveaux remous médiatiques pareils à ceux connus récemment par François Fillon à la suite du rejet de sa requête par la Cour 8.
Sur un tout autre plan, la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, comme celle de toute autre juridiction par ailleurs, peut être envisagée comme un levier de négociation avec la partie adverse plus que comme une fin en soi. L’idée est alors de chercher à obtenir la communication d’une requête au Gouvernement défendeur, dans le but d’entamer des tractations avec celui-ci – l’abandon de la requête contre un avantage accordé, que celui-ci porte sur le contentieux à l’origine de la requête ou sur un tout autre objet. La procédure instituée par la Cour, qui inclut une phase non-contentieuse pendant laquelle les parties sont invitées à s’entendre à l’amiable, peut favoriser cette logique. Si le sujet n’est pas documenté, toutes ces tractations ayant pour spécificité de rester très largement dans l’ombre dans la mesure où la procédure de règlement amiable est confidentielle, l’expérience de l’auteur de ces lignes indique qu’il ne s’agit pas d’une appréhension ultra-minoritaire dans le contentieux, mais d’une réalité tangible.
De manière beaucoup plus anecdotique, heureusement, les requérants peuvent enfin chercher à impacter la Cour européenne des droits de l’homme elle-même. Les requêtes « Zambrano », portant sur le passe sanitaire instauré en France pendant la crise du covid-19, en constituent un exemple topique : ces milliers de requêtes, introduites sous l’impulsion de M. Zambrano, avaient pour objectif selon les termes de ce dernier de créer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour, de « paralyser son fonctionnement » ou encore « de forcer la porte d’entrée de la Cour » « pour faire dérailler le système » 9. Dont acte.
En revanche, certains objectifs pernicieux qui peuvent être poursuivis par des procédures au niveau national, à savoir gagner du temps (procédures dilatoires) ou effrayer judiciairement des personnes considérées comme pouvant nuire (procédures bâillons à l’encontre de journalistes ou d’universitaires) ne se transposent que très mal au niveau européen. L’absence d’effet suspensif de la saisine de la Cour dans l’immense majorité des cas (moins d’une affaire sur deux-cents voit l’application d’une mesure provisoire par la juridiction strasbourgeoise, susceptible de paralyser un temps une décision nationale) et le fait que les défendeurs sont systématiquement des États parties à la Convention rendent en effet très peu accessibles ces deux buts éventuels dans le champ de la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme – signe que les stratégies des parties doivent bien évidemment s’adapter à l’échelon de juridiction envisagé.
Pour autant, la variété des objectifs qui peuvent accompagner le désir de victoire reste notable. Elle l’est d’autant plus qu’elle est complétée d’objectifs qui, eux, excluent tout à fait la volonté de l’emporter dans le prétoire européen.
B- Le repli stratégique
L’ambiguïté stratégique évoquée ci-dessus concerne évidemment avant tout les requérants individuels – quoique les États requérants dans des requêtes interétatiques puissent avoir également une pluralité d’objectifs politiques et diplomatiques, comme l’illustre le lawfare initié par l’Ukraine à la suite de l’invasion russe. Ils sont en effet à l’initiative de l’écrasante majorité des saisines de la Cour, et donc les mieux placés pour établir une stratégie complexe. L’hypothèse du repli stratégique concerne en revanche quant à elle essentiellement les États défendeurs, qui peuvent être tentés de ne pas se défendre farouchement devant la juridiction européenne, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, un État peut estimer, face à une jurisprudence bien établie, que la bataille est nécessairement perdue et, partant, ne pas même chercher à obtenir la victoire. Par exemple, dans l’affaire Fernandez-Rodriguez c/ France 10, les requérants dénonçaient la violation du principe de l’égalité des armes en ce que, contrairement à eux, l’avocat général près la Cour de cassation avait disposé du rapport et des éventuels projets d’arrêt établis par le conseiller rapporteur. Or, un tel état de fait avait déjà entraîné la condamnation de la France sous le pavillon de l’article 6 § 1 de la Convention à de nombreuses reprises au fil des années précédentes 11. Plutôt que de chercher à défendre malgré tout sa position initiale au sujet de cette problématique, le Gouvernement défendeur s’en est ici remis, sur le fond, à la « sagesse de la Cour ». L’objectif poursuivi ici n’est ainsi pas la victoire, mais la préservation des ressources du service et le maintien de la crédibilité de l’État aux yeux de la Cour – on ne défend bien que lorsque l’on choisit quoi défendre. Les déclarations unilatérales des États s’inscrivent largement dans cette logique, puisque celles-ci se développent essentiellement dans le cadre des affaires répétitives et de celles qui relèvent de la jurisprudence bien établie de la Cour 12. Or, à elles seules, dans la dernière décennie, elles ont permis d’éviter à un millier d’affaires par an en moyenne d’encombrer le prétoire de la juridiction strasbourgeoise – un repli stratégique fréquemment utilisé par les États, en somme.
En deuxième lieu, un État peut se moquer éperdument que la bataille soit perdue, quand bien même il aurait des chances de l’emporter s’il décidait de lutter. Il est permis de penser, pour illustrer le propos, à un État qui serait mis en cause devant la Cour européenne des droits de l’homme du fait d’une ancienne législation, abrogée postérieurement à l’introduction de la requête. Dans un tel cas de figure, se défendre ne présente pas nécessairement un intérêt de taille pour l’État, qui peut là encore dans un souci d’économie s’en remettre à la sagesse de la Cour. Une seconde configuration, malheureusement bien établie en pratique, correspond également à ce cas de figure : la stratégie de la chaise vide adoptée par la Russie à la suite de son exclusion du Conseil de l’Europe. Quand bien même celle-ci reste tenue par la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant de ses actions et omissions antérieures à la date de son exclusion, elle a fait le choix de cesser toute participation aux procédures dans lesquelles elle est partie devant la Cour. L’objectif poursuivi par l’État russe n’est pas ici de gagner, mais bel et bien de montrer son dédain pour la justice internationale et de souligner sa position, selon laquelle elle n’est plus tenue par les arrêts de la Cour.
En troisième et dernier lieu, plus remarquable encore, un État peut souhaiter perdre la bataille devant la Cour – il n’est pas seulement indifférent à la victoire ou à la défaite, mais appelle cette dernière de ses vœux. La configuration la plus usuelle, pour ce cas de figure, est celle d’une alternance politique au sein d’un État : le nouvel accédant au pouvoir, qui peut avoir vertement critiqué une mesure donnée alors qu’il était dans l’opposition, est conduit par le jeu de l’écoulement du temps à défendre devant le juge européen cette même mesure. Le contentieux polonais relatif à l’État de droit l’illustre parfaitement : le gouvernement polonais conduit par Donald Tusk est depuis la fin de l’année 2023 en charge de la défense des mesures de mise au pas de la magistrature adoptées par le PiS, alors qu’il n’a eu de cesse de les dénoncer pendant la campagne électorale. Il va sans dire que, s’agissant des requêtes qui ne sont pas traitées par la voie du règlement amiable ou de la déclaration unilatérale, par exemple parce que l’intérêt des droits de l’homme veut que la Cour se prononce sur une question inédite, l’objectif du gouvernement polonais actuellement en place n’est en aucun cas la victoire. Une variante moins spectaculaire, et à la logique très différente, de cette configuration – l’État ne veut surtout pas triompher – s’observe lorsque celui-ci renonce à une exception d’irrecevabilité qui pourrait prospérer dans le but de voir la Cour trancher la problématique de fond. Il s’agit ici, dans la réflexion stratégique du Gouvernement défendeur, de choisir le terrain d’affrontement : perdre volontairement la bataille de la recevabilité pour emporter ailleurs une bataille plus décisive encore, que l’on espère bien gagner 13.
Ces diverses configurations du repli stratégique ne sont pas rares dans le contentieux européen des droits de l’homme : outre les milliers de requêtes déjà évoquées et traitées dans le cadre de la phase précontentieuse, pas moins de 1.100 occurrences des termes « sagesse de la Cour » sont identifiables sur la base de données Hudoc, alors même que cette expression n’est pas systématiquement employée lorsqu’un État renonce à se défendre efficacement pour une raison ou pour une autre. Si, dans la plupart de ces affaires, la sagesse de la Cour est invoquée au stade de la détermination de la satisfaction équitable, nombre d’entre elles voient bien l’État renoncer soit au maniement d’une exception de recevabilité 14 soit à une défense sur le fond 15.
L’on mesure bien à quel point, à la lecture de ces quelques lignes incomplètes, les objectifs poursuivis par les parties devant la Cour européenne des droits de l’homme peuvent être variés. Les moyens déployés ne le sont toutefois pas moins, ce qui dessine un panel de stratégies possibles extrêmement varié.
II- La variété des moyens déployés par les parties
Atteindre les buts que l’on se fixe suppose dans la plupart des cas de déployer des moyens adéquats pour y parvenir – quoique non systématiquement : si l’objectif est de perdre un procès, ou de marquer son mépris de la juridiction strasbourgeoise, c’est vers l’inaction ou l’action minimaliste, s’en remettre à la sagesse de la Cour, qu’il s’agit de se tourner. Dans les configurations plus classiques toutefois, les parties au procès européen peuvent rivaliser d’ingéniosité pour mettre toutes les chances de leur côté. Là encore, il est difficile de prétendre à l’exhaustivité en la matière, mais une ligne claire de distinction de ces moyens peut s’imposer : il est loisible de distinguer entre les moyens déployés au sein du prétoire, que le droit appréhende aisément parce qu’ils sont prévus par lui (A) des moyens déployés en dehors du prétoire, plus difficilement perceptibles mais visibles tout de même en ce que le droit cherche à contrecarrer plusieurs d’entre eux (B).
A- Les moyens déployés au sein du prétoire
Dans le cadre d’un procès, les décisions à prendre pour tenter de l’emporter ne manquent pas. Beaucoup d’entre elles sont prises en amont de l’introduction de la requête, et le raisonnement qui les soutient n’est souvent guère accessible à l’observateur. Par exemple, s’agissant de la seule détermination des personnes appelées à soumettre une requête à la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre d’un problème répétitif ou structurel, faut-il favoriser une requête unique ou la multiplication de requêtes portées par des personnes différentes ? Parmi elles, faut-il favoriser les personnes physiques, les personnes morales, ou un panachage des deux ? La requête à l’origine de l’arrêt de Grande Chambre dans l’affaire climatique « KlimaSeniorinnen » 16 montre le poids que ce genre de considérations peut avoir pour voir prospérer des griefs, et l’intérêt qu’il peut y avoir à multiplier les requérants à l’origine d’une requête dans la perspective de minimiser les risques d’irrecevabilité.
Bien évidemment, pour un requérant et son conseil, le principal vecteur d’augmentation des chances de succès d’une requête donnée est l’invocation de moyens juridiques pertinents et, au soutien de ceux-ci, d’une argumentation susceptible d’emporter la conviction du juge. Dans ce cadre, les options stratégiques sont nombreuses. L’utilisation plus ou moins marquée de certains éléments juridiques est l’une d’entre elles. En effet, le droit comparé, les autres branches du droit international, le point de vue de la doctrine sont autant de points d’appui potentiels pour une requête. L’usage d’éléments extra-juridiques constitue également un facteur susceptible d’influer sur les chances de succès d’une argumentation : l’économie, la sociologie, l’histoire, la science politique, les sciences dures sont autant d’exemples qui peuvent être cités. Il a été relevé que certains d’entre eux ont d’ailleurs une place croissante dans le contentieux, parfois sans que la juridiction européenne ne s’avère très à l’aise – l’illustrent très bien les données scientifiques, dont le poids va croissant dans les contentieux environnementaux, climatiques ou encore sanitaires. À ce sujet, il peut être relevé que la parole du requérant n’est pas toujours la seule qui s’exprime au sein d’une requête : certains justiciables, lorsqu’ils en ont les moyens, n’hésitent pas à débourser des sommes plus ou moins conséquentes pour solliciter une consultation d’expert, par exemple d’un enseignant-chercheur, afin de la joindre à la requête et de faire bénéficier celle-ci du poids du nom du sachant consulté.
Les mécanismes procéduraux en jeu dans le procès européen lato sensu sont également autant de moyens à la disposition des parties pour faire triompher leurs objectifs. Par exemple, alors que les parties ont longtemps disposé du droit de s’opposer au dessaisissement de la Chambre en faveur de la Grande Chambre, il semble que certains États aient pu faire le choix d’opposer systématiquement un refus en la matière, soit pour bénéficier de deux occasions différentes de l’emporter, soit pour retarder au maximum la résolution définitive de l’affaire. De manière plus originale, une partie peut solliciter la tenue d’une audience, dont on sait qu’elles sont généralement associées aux affaires de Grande Chambre, dans le but de souligner son intérêt prononcé pour une question et de s’assurer d’être bien entendue par la Cour à ce sujet. L’affaire A.M. c/ France 17 s’inscrit par exemple dans cette lignée : mécontente et inquiète d’une série d’arrêts s’opposant au renvoi de terroristes vers l’Algérie du fait de risques de traitements inhumains et dégradants de personnes liées à l’islamisme radical, la France a souhaité l’organisation d’une audience afin de faire valoir les éléments démontrant une évolution de la situation dans cet État et, partant, l’absence de maintien des risques dénoncés dans les arrêts précédents.
Sont donc essentiellement en jeu ici des qualités de créativité, de recherche, d’argumentation qui sont l’apanage du bon juriste. Par contraste, les moyens déployés en dehors du prétoire, qui sont pour la plupart contestables ou illégaux, font appel à des capacités heureusement bien moins mises en valeur dans les facultés de droit.
B- Les moyens déployés en dehors du prétoire
Des parties déterminées à l’emporter ne se limitent pas nécessairement à l’utilisation des moyens que leur offre le droit. Sans aller jusqu’à violer celui-ci, elles peuvent chercher à prévenir l’émergence du conflit devant le juge ou à influencer ce dernier dans leur sens. Là encore, les moyens auxquels il est loisible de penser sont nombreux, et les lignes ci-après n’épuisent probablement pas le sujet.
Premièrement, il apparaît à la lecture de la jurisprudence qu’un État peut chercher à empêcher l’introduction d’une requête devant la Cour. L’affaire M.A. c/ France 18 constitue en la matière un véritable archétype. Elle concerne un ressortissant algérien ayant rejoint, au début des années 1990, des mouvements islamistes combattant les autorités algériennes. Entre 2010 et 2014, le requérant bénéficia d’une mesure provisoire adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme et s’opposant à son renvoi vers son États d’origine. Cette mesure fut levée lorsque la requête à laquelle elle était associée fut déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le 20 février 2015, le requérant fut arrêté à 9h20 et, moins de sept heures plus tard, décolla pour l’Algérie dans le cadre d’une mesure d’éloignement. Saisie à 15h16 par l’avocate du requérant, la Cour notifia dans les minutes qui suivirent une nouvelle mesure provisoire aux autorités, en vain. Se prononçant trois ans plus tard sur le fond, la Cour conclut non seulement à la violation de l’article 3 de la Convention, du fait de l’expulsion, mais également à la violation de son article 34, qui garantit le droit de saisir le juge strasbourgeois, du fait d’une volonté délibérée de l’État d’empêcher le requérant de pouvoir la saisir utilement d’une mesure provisoire 19. Autrement dit, l’État français a ici sciemment organisé l’expulsion du requérant de manière à ce que sa probable défaite dans le prétoire européen, à supposer la Cour saisie, ne l’empêche en rien d’expulser celui-ci.
Deuxièmement, un État peut chercher à forcer un requérant à renoncer contre son gré à une requête qu’il a introduite. Là encore, des exemples en sont fournis du fait de constats de violation de l’article 34 de la Convention par la Cour. Pour ne citer qu’une illustration, cette dernière a pu conclure, dans un arrêt Boškoćević c/ Serbie 20, à la violation de l’article 34 de la Convention après que le requérant, employé d’une société d’État, ait reçu un courrier lui indiquant qu’il avait manqué à ses obligations et risquait le licenciement du simple fait qu’il avait saisi la juridiction strasbourgeoise d’une requête. Des comportements comparables de la part d’États défendeurs émergent malheureusement régulièrement de la lecture de la jurisprudence, et les violations du droit de recours individuel, sans être monnaie courante, ne sont pas aussi rares que l’on pourrait le souhaiter.
Troisièmement, des procédés tout aussi condamnables peuvent être utilisés en direction des juges de la Cour, pour chercher à s’attirer leur vote. Du simple lobbying lors d’évènements divers aux menaces ou à la corruption, toute une palette d’actions s’offre à la merci des parties dénuées de scrupules. Si, à la connaissance de l’auteur, aucun scandale de corruption n’a jamais entaché la Cour européenne des droits de l’homme – les juges bénéficiant au passage d’un salaire pour le moins confortable, sensé les prémunir de la tentation –, l’éthique judiciaire de la juridiction a parfois pu être discutée. La présidence de l’islandais Robert Spano a par exemple été éclaboussée par son acceptation d’un doctorat honoris causa d’une université stambouliote, eu égard aux relations troublées entre la Turquie et le système de la Convention. Une conséquence directe de cet épisode fâcheux semble avoir été l’adoption par la Cour d’une résolution sur l’éthique judiciaire, entrée en vigueur moins d’une année plus tard, et qui affirme notamment que « les juges ne peuvent accepter aucune décoration ou distinction pendant l’exercice de leurs fonctions de juge de la Cour ». La présidence de la juridiction s’est récemment associée un comité d’éthique, composé de juges capés de la Cour, pour l’appuyer dans ses fonctions en la matière. Dans la même ligne, il est possible de penser à l’exercice de menaces sur les juges de la Cour et sur leurs proches. Le contexte actuel invite à ne pas négliger cette question, au regard notamment des pressions que les États-Unis infligent aux juges de la Cour pénale internationale. À ce titre, il convient d’observer que l’article 51 de la Convention accorde aux juges de la Cour, à leurs conjoints et à leurs enfants mineurs des privilèges et immunités « en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions » 21, bien que cela n’épuise en rien le sujet. À deux reprises, la Cour a pu constater la violation de cet article du fait d’actes d’enquête menés par des États à l’encontre de conjoints de juges, sans toutefois qu’il soit établi que ces actes constituaient une forme d’intimidation de ces derniers.
Quatrièmement, une partie peut chercher à influencer l’environnement dans lequel évolue la Cour. Il peut par exemple s’agir d’appliquer une pression politique ou médiatique envers celle-ci, dans l’espoir d’influer une décision précise ou une ligne jurisprudentielle donnée – les discours particulièrement véhéments de plusieurs Premiers ministres britanniques au sujet du droit de vote des prisonniers ont longtemps fait figure de parfait exemple en la matière, mais ont récemment été détrônés par une lettre ouverte adressée par neuf chefs d’États et de gouvernements européens à la Cour, et l’invitant à durcir sa jurisprudence en matière de renvois d’étrangers et de contrôle des frontières 22. Il peut également s’agir de stimuler, parfois contre rémunération (hautement condamnable), la doctrine afin qu’elle s’empare d’un sujet donné, ou des tiers intervenants afin qu’ils s’immiscent dans un litige. Enfin, il apparaît que les requérants n’hésitent pas à contourner la règle de la litispendance pour exercer une forme de pression sur la Cour : pour ne citer qu’une illustration, la requête H.F. c/ France 23, relative au refus de la France de rapatrier les enfants français des djihadistes de l’État islamique prisonniers en Syrie, a vu certains de ceux-ci saisir, apparemment à dessein, le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits de l’enfant ou le Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies.
Cinquièmement, et dernièrement, c’est la Cour et le mécanisme qu’elle applique eux-mêmes qui peuvent faire l’objet de manœuvres étatiques, dans le but de complexifier sa saisine ou de durcir sa jurisprudence. Le durcissement de certaines conditions de recevabilité des requêtes ou l’inscription dans le préambule de la Convention du principe de subsidiarité, dans le sillage de la conférence de Brighton, au cours de laquelle le Royaume-Uni souhaitait affaiblir la Cour européenne des droits de l’homme, peuvent être interprétés comme des tentatives d’emporter plus de batailles juridiques en modifiant les règles qui président à leur destinée. De façon plus insidieuse, certaines États paraissent avoir compris que ces opérations sont coûteuses diplomatiquement et hasardeuses juridiquement, et semblent préférer porter leur attention sur la sélection de candidats plus conservateurs au titre de l’élection des juges de la Cour. Quoique le phénomène paraisse encore limité, il y a là peut-être un motif d’inquiétude au sujet de la stratégie que certains États peuvent déployer vis-à-vis de la justice internationale.
* *
*
En définitive, tenter d’approcher la stratégie des parties devant la Cour européenne des droits de l’homme est de nature à donner le vertige, la variété des objectifs comme des moyens utilisés dessinant un champ des possibles n’ayant pas grand-chose à envier à la profondeur stratégique des échecs – à ceci près que les spectateurs, nombreux, ont parfois leur propre agenda, peuvent influer sur le cours de la partie, voire sur l’échiquier lui-même ; et que l’arbitre du conflit, la Cour, n’est pas entièrement à l’abri des manœuvres qui se jouent sous ses yeux ou à son insu. Les observateurs du système de la Convention peuvent avoir intérêt à garder un œil attentif sur cet aspect des choses, sous peine de passer à côté de certaines des dynamiques et évolutions constatées ou nécessaires de la jurisprudence européenne. La maîtrise du jeu doit être à la hauteur des enjeux.
Notes:
- Voir, parmi bien d’autres exemples : CEDH, décision Greeenpeace‑Luxembourg c/ Luxembourg, 29 juin 1999, no 29197/95. Le contentieux climatique introduit une entorse à ce principe : CEDH, GC, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c/ Suisse, 9 avril 2024, no 53600/20. ↩
- Comparer par exemple : CEDH, arrêt Cannavacciuolo c/ Italie, 30 janvier 2025, nos 51567/14 et autres ; CEDH, arrêt L.F. et autres c/ Italie, 6 mai 2025, no 52854/18. ↩
- Voir, pour cette pratique : CEDH, GC, arrêt Burmych et autres c/ Ukraine, 12 octobre 2017, nos 46852/13 et autres. ↩
- CEDH, arrêt J.M.B. et autres c/ France, 30 janvier 2020, nos 9671/15 et autres. L’OIP était tiers intervenant dans cette affaire. ↩
- CC, décision M. Geoffrey F. et autre [Conditions d’incarcération des détenus], 2 octobre 2020, no 2020-858/859 QPC. L’OIP était tiers intervenant dans cette affaire, et était représenté par le même avocat que l’une des personnes à l’origine de la QPC dont était saisi le Conseil constitutionnel. ↩
- CEDH, arrêt C8 (Canal 8) c/ France, 9 février 2023, nos 58951/18 et 1308/19. ↩
- CEDH, GC, décision Duarte Agostinho et autres c/ Portugal et 32 autres, no 39371/20. ↩
- CEDH, décision François Fillon et autres c/ France, 25 septembre 2025, no 24326/24. ↩
- CEDH, décision Guillaume Zambrano c/ France, 21 septembre 2021, no 41994/21. ↩
- CEDH, arrêt Fernandez-Rodriguez c/ France, 25 octobre 2005, no 69507/01. ↩
- Pour la première d’entre elles, voir : CEDH, GC, arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France, 31 mars 1998, nos 23043/93 22921/93. ↩
- Voir, sur ce point, le document de présentation des déclarations unilatérales établi par la Cour : https://www.echr.coe.int/fr/d/unilateral_declarations_fra. ↩
- Pour une illustration, voir le témoignage de l’agent du Gouvernement français Diégo Colas in Thibaut Larrouturou (dir.), Contentieux européen des droits de l’homme : repenser les conditions de recevabilité, à paraître aux Éditions Pedone. ↩
- Voir, par exemple : CEDH, GC, arrêt Sabeh El Leil c/ France, 29 juin 2011, no 34869/05. Dans cette affaire, « s’agissant de l’applicabilité de l’article 6 § 1, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour ». ↩
- Voir, par exemple : CEDH, arrêt Kozák c/ République tchèque, 18 avril 2006, no 30940/02 ↩
- CEDH, GC, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c/ Suisse, 9 avril 2024, no 53600/20. ↩
- CEDH, arrêt A.M. c/ France, 29 avril 2019, no 12148/18. ↩
- CEDH, arrêt M.A. c/ France, 1er février 2018, no 9373/15. ↩
- Dans cette affaire, la Cour affirme être « pleinement consciente qu’il peut être nécessaire pour les autorités compétentes de mettre en œuvre une mesure d’expulsion avec célérité et efficacité. Toutefois, les conditions d’une telle exécution ne doivent pas avoir pour objet de priver la personne reconduite du droit de solliciter de la Cour l’indication d’une mesure provisoire ». Or, en l’espèce, « les autorités françaises ont créé des conditions dans lesquelles le requérant ne pouvait que très difficilement saisir la Cour d’une seconde demande de mesure provisoire. Ce faisant, elles ont donc délibérément et de manière irréversible, amoindri le niveau de protection des droits énoncés dans l’article 3 de la Convention ». ↩
- CEDH, arrêt Boškoćević c/ Serbie, 5 mars 2024, no 37364/10. ↩
- Voir le sixième Protocole à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, en date du 2 septembre 1949. ↩
- Cet édifiant courrier peut être consulté ici : https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Lettera_aperta_22052025.pdf. ↩
- CEDH, GC, arrêt H.F. c. France, 14 septembre 2022, nos 24384/19 et 44234/20. ↩



