Garanties juridictionnelles et non juridictionnelles au défi de l’effectivité des droits
Si le droit au recours juridictionnel est aujourd’hui largement considéré comme un droit matriciel, comme le « bouclier des autres droits fondamentaux », son effectivité est cependant remise en cause. L’accès au juge, la connaissance et l’utilisation des voies de recours juridictionnelles, tout comme l’exécution des décisions de justice, sont en effet souvent compromis. Par leur position institutionnelle particulière et leur mode d’action original, certaines autorités indépendantes comme le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constituent tout à la fois des auxiliaires et des alternatives à la garantie juridictionnelle des droits.
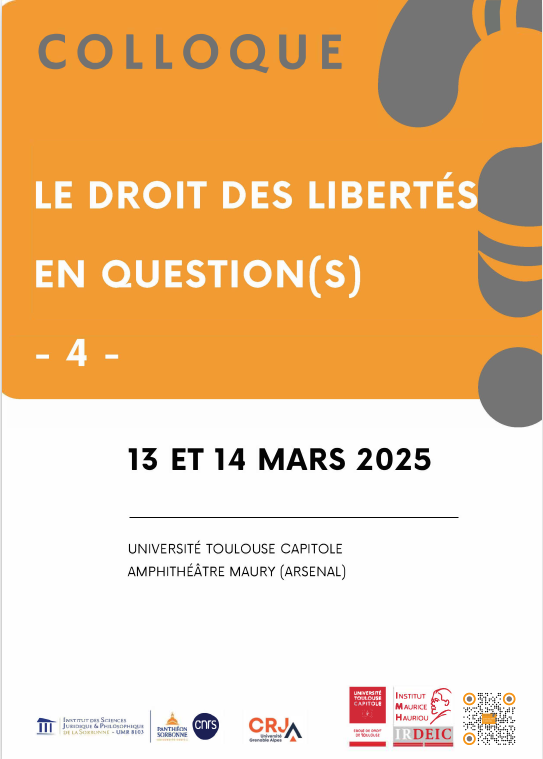 Julia Schmitz, Maître de conférences en droit public, UT Capitole, École de droit de Toulouse
Julia Schmitz, Maître de conférences en droit public, UT Capitole, École de droit de Toulouse
Pour reprendre la formule d’Antoine Jeammaud, l’effectivité des droits est « un objet d’indispensable inquiétude pour les juristes soucieux de convaincre qu’ils ne s’enferment pas dans “l’univers abstrait des règles” et sont attentifs à l’inscription de celles-ci dans les pratiques sociales »1. Cette question permet justement de remettre en cause des certitudes établies. Il en est ainsi de l’effectivité du droit au recours effectif.
Comme le relevait la doctrine il y a près de vingt ans, « la lecture des manuels contemporains de libertés publiques, de droit des libertés fondamentales ou de droits de l’homme conduit à une conclusion sans équivoque. Les institutions de type juridictionnel sont aujourd’hui conçues comme les gardiennes par excellence des droits et libertés »2. Malgré une diversification des mécanismes de garantie des droits fondamentaux, qu’ils soient juridictionnels, administratifs, politiques ou citoyens3, leur effectivité semble toujours pensée quasi exclusivement à travers la sanction juridictionnelle.
La garantie des droits renvoie en effet traditionnellement à l’idée d’une sanction4 de la violation de la norme consacrant les droits, qui émane en principe de l’autorité juridictionnelle, indépendante des pouvoirs publics. L’action en justice est ainsi devenue le « vecteur de réalisation des droits »5. Et le droit au recours juridictionnel, fondé sur l’article 16 DDHC6, entendu comme le droit pour toute personne « d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits »7, est considéré comme le « droit des droits »8, le « bouclier des autres droits fondamentaux »9, celui qui garantit leur effectivité.
Ce modèle dominant se traduit d’ailleurs par l’attention portée dans la jurisprudence au droit au recours. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d’accéder à un juge »10. La priorité est d’ailleurs souvent donnée au volet “procédural” plutôt que substantiel des droits. Le juge sanctionne ainsi plus volontiers le défaut de contrôle juridictionnel que les atteintes substantielles qui sont portées à un droit, et les condamnations européennes pour violation de l’article 13 semblent souvent prendre le pas11. Cela est particulièrement visible en ce qui concerne le contentieux des conditions de détention où les exigences relatives à l’article 3 sont combinées à celle de l’article 13 impliquant l’existence complémentaire de différents recours juridictionnels qui puissent constituer des « remèdes préventifs et compensatoires »12. De même, lorsque le Conseil de l’Europe adopte une recommandation sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situation d’extrême précarité, l’accent est mis non seulement sur la reconnaissance d’un tel droit mais également sur le fait que celui-ci « devrait être justiciable, toute personne en situation d’extrême précarité devant pouvoir l’invoquer directement devant les autorités et le cas échéant devant les tribunaux »13. L’effectivité des droits fondamentaux est donc médiatisée par l’existence d’un recours juridictionnel effectif.
Cette conception semble cependant reposer sur une « vision enchantée »14 du recours au juge dont l’effectivité peut être questionnée15. Une telle interrogation a d’ailleurs déjà été au cœur de travaux consacrés aux mécanismes de protection non juridictionnels, dont celui de l’institution du Défenseur des droits (DDD)16. La création de ce dernier procédait en effet du constat des insuffisances du système de garantie juridictionnelle des droits fondamentaux et de la volonté d’ouvrir « des voies nouvelles pour les faire valoir »17. Mais alors que cette voie alternative s’ouvrait, la garantie juridictionnelle des droits était dans le même temps renforcée, le DDD se voyant alors éclipsé par la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité18. Il faut également rappeler que lors des débats parlementaires relatifs à la création du Médiateur de la République en 1973, ancêtre du DDD, la proposition de l’appellation de « Médiateur, défenseur des droits et libertés » a été rejetée par le Garde des sceaux au motif que la défense des droits et libertés devait rester « l’apanage du Conseil d’État et de la Cour de cassation »19.
Pourtant le DDD n’est pas la seule autorité compétente en matière de protection des droits fondamentaux. Elle s’insère au contraire dans un mouvement continu de multiplication des autorités administratives indépendantes (AAI) qui a fait de la protection des droits fondamentaux un champ que l’on peut désormais qualifier de « concurrentiel »20. Le premier numéro de la chronique consacrée à l’activité des AAI en matière de protection des libertés – désormais accueillie dans la Revue des droits et libertés fondamentaux – faisait en effet état « du caractère vivant et évolutif de ce continent encore nouveau de la régulation des libertés par les AAI »21.
Nous pouvons dès lors aujourd’hui tenter de croiser ces différents constats et questionner leur actualité. Plutôt que de parler de concurrence ou de « contournement du juge »22 par les AAI, ne faut-il pas interroger leur complémentarité ? Lors du colloque organisé en février 2025 par la Cour de cassation, le Conseil d’État et le DDD portant sur le « Défenseur des droits et le juge », le premier président de la Cour de Cassation convenait ainsi que « le Défenseur des droits est sans conteste un pilier de notre État de droit, au même titre que l’autorité judiciaire, gardienne de l’autorité individuelle », tandis que le vice-président du Conseil d’État soulignait que « le travail conjoint du Défenseur des droits et du juge administratif pour défendre les libertés [était] une évidence »23. Ces affirmations démontrent que les AAI se sont insérées dans le schéma de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux pour en être des « collaborateurs »24 et contribuer à renforcer la garantie juridictionnelle des droits par ce que Michel Foucault appelait une « démultiplication du rôle du magistrat »25.
Il convient cependant au préalable de préciser quelles sont les autorités indépendantes en question. Si le législateur a déterminé une liste de vingt-quatre AAI, il convient ici de s’en départir pour y inclure une autorité exclue mais dont l’indépendance a été dans le même temps renforcée. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) continue en effet d’être rattachée au programme budgétaire 308 relevant de la mission « Direction de l’action du gouvernement » qui regroupe les crédits de dix autorités indépendantes « exerçant leurs missions dans le champ de la protection des droits de l’homme et des libertés publiques et individuelles ». Parmi celles-ci, il convient de ne retenir pour cette étude que celles qui se voient confier une mission spéciale et exclusive de protection des libertés et qui agissent par voie recommandatoire.
Plus précisément encore, comme notre objet est d’interroger le rôle les autorités qui agissent dans un rapport de complémentarité alternative avec le juge26, nous excluons celles qui disposent d’un pouvoir de sanction27 ou qui peuvent se substituer au juge par un pouvoir de réparation ou de médiation28. Nous excluons également de l’étude les autorités qui constituent en elles-mêmes un rouage juridictionnel soit parce que leur saisine est obligatoire avant tout recours au juge, soit parce qu’elle interrompt les délais de recours ou qu’elle ne puisse s’effectuer que par le juge lui-même29.
L’analyse se concentre ainsi sur trois AAI qui relèvent de la catégorie déjà travaillée par Dimitri Lörher des human rights ombudsmen : le DDD, chargé, aux termes de l’article 71-1 de la Constitution, de veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public » ; la CNCDH qui « assure un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit international humanitaire et de l’action humanitaire »30, et le CGLPL, chargé du contrôle des « conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux »31. La mobilisation croisée de ces trois autorités pour présenter des observations en qualité de tiers intervenants devant la CEDH et dénoncer l’ineffectivité des recours existants contre les conditions indignes de détention32 illustre ainsi leur action en matière de droit au recours effectif.
Plus précisément, ces autorités contribuent à l’architecture contentieuse dans son ensemble, permettant aux recours de se déployer à travers un rôle para-contentieux qui est peut-être le plus évident (I). Mais nous voudrions également montrer que ces trois institutions jouent un rôle que l’on pourrait qualifier de méta-contentieux touchant à l’infrastructure même de la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux (II).
I. Un rôle para-contentieux : rendre effectif le droit au recours effectif
L’effectivité du droit au recours juridictionnel dépend de plusieurs paramètres : un accès facilité au juge, le respect des standards d’indépendance et d’impartialité, la célérité, le respect du principe de l’égalité des armes ou encore l’exécution des décisions de justice. Or, malgré le perfectionnement continu des mécanismes de protection juridictionnelle des droits fondamentaux, des insuffisances sont encore largement dénoncées. Les AAI peuvent alors exercer un rôle de « catalyseur de la garantie juridictionnelle »33 qui se situe en amont (A) et en aval (B) de l’action en justice.
A. Accompagner l’accès au juge
Les AAI peuvent tout d’abord fournir un accompagnement nécessaire aux individus pour impulser le recours au juge. Le DDD peut ainsi assister la personne qui s’estime victime de discrimination ou réclamant la protection des droits de l’enfant dans la constitution de son dossier et l’aider à identifier les procédures adaptées à son cas. Ces autorités peuvent même intercéder et déclencher l’action juridictionnelle au nom des individus, cette action renvoyant à la définition traditionnelle du Justitie Ombudsman, c’est-à-dire « celui qui plaide pour autrui »34. Le DDD et le CGLPL sont tous deux habilités à saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont ils ont connaissance (art. 29 de la loi organique et art. 9 de la loi de 2007) et doivent informer le Procureur de la République si les faits leur apparaissent être constitutifs d’un crime ou d’un délit (art. 33-3 de la loi organique et art. 9 de la loi de 2007)35. Quant à la CNCDH, si elle ne peut expressément saisir l’autorité judiciaire, elle peut, en tant que rapporteur national sur la lutte contre le racisme, effectuer des signalements an cas de contenu haineux sur internet auprès de la Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse et de Recoupement et d’Orientation des Signalements (PHAROS).
De manière plus indirecte, ces autorités peuvent également intervenir pour initier des stratégies contentieuses. Dans son rapport thématique de 2024 consacré à l’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention, le CGLPL propose ainsi l’introduction systématique d’un référé-liberté en parallèle d’un recours devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale ; l’introduction de requêtes collectives impliquant plusieurs personnes détenues au sein d’un même établissement ; l’utilisation du « REP – injonction » ou du recours indemnitaire assorti de demandes d’injonctions.
Sans être une partie à l’instance, les AAI contribuent par ailleurs à garantir le principe de l’égalité des armes devant le juge en allégeant la charge de la preuve pour les requérants. Elles jouent en effet un rôle d’expertise auprès des juridictions en présentant leurs observations soit sur sollicitation du juge, dans un rôle d’amicus curiae, soit à leur demande. L’article 33-2 de la loi organique relative au DDD précise ainsi que les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Il peut également demander à en présenter lui-même, cette audition étant alors de droit. L’Autorité use aussi de cette prérogative devant le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori36 ainsi que devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État au soutien de la transmission d’une QPC37.
Le statut de ces observations pose cependant la question de leur nature et du respect du principe du contradictoire en ce qu’elles font des AAI des « forces de proposition en direction des juges »38. Mais contrairement aux critiques qui ont pu être émises à l’égard de ces interventions en justice39, on peut considérer qu’elles permettent aux AAI d’éclairer le juge sur la réalité de certaines pratiques qui peuvent être en cause. On pense ainsi à la demande d’intervention faite par le Conseil d’État dans le cadre du contentieux relatif aux contrôles d’identité discriminatoires40. On peut également considérer que ces autorités sont bien dans leur rôle de promotion des droits, en défendant de manière objective une cause d’intérêt général, à savoir le respect des droits fondamentaux.
Il en est de même pour la CNCDH que toute juridiction peut solliciter et qui a déjà eu l’occasion en 2019 de présenter ses observations au Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. En tant qu’institution nationale des droits de l’homme, elle a également tissé des liens étroits avec le Conseil de l’Europe, en usant largement de la faculté de présenter des observations sur les questions de droit soulevées par un litige pour lequel la CEDH est saisie, sous la forme de tierces interventions41.
Sans intervenir directement auprès des juridictions, les AAI deviennent également des institutions « ressources », dont les analyses et constats sont régulièrement mobilisés par les juges, ce qui pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une plus grande systématisation. Le juge européen se fonde ainsi largement sur les avis de la CNCDH, du CGLPL ou du DDD qui figurent dans la partie des arrêts consacrée au « cadre juridique interne pertinent »42. De même, dans le cadre de la QPC par laquelle le juge constitutionnel a consacré le principe de fraternité, un avis de 2017 de la CNCDH allant en ce sens figure dans le dossier documentaire de la décision43.
L’Autorité de contrôle des lieux de privation de liberté a quant à elle initié une circulation de la « norme CGLPL »44 dans le contentieux relatif aux conditions de détention en apportant son expertise par la publication rapide de ses constats afin qu’ils puissent être utilisés par les avocats et les juges. L’institution élabore en ce sens des « fiches prison » axées sur les conditions matérielles de détention des établissements pénitentiaires, qui sont « à disposition des magistrats, des avocats, pour constituer, une banque de données fiables et impartiales des prisons »45. Cependant, si le juge administratif se fonde largement sur les éléments factuels ou la qualification juridique des faits retenus par cette Autorité, la force probatoire des observations du CGLPL doit être relativisée dans le cadre du nouveau recours créé par la loi du 8 avril 2021 permettant de dénoncer des conditions indignes de détention devant le juge judiciaire46.
Cette capacité d’expertise auprès du juge est par ailleurs soutenue par des pouvoirs d’enquête renforcés. Le DDD comme le CGLPL peuvent en effet mener des investigations approfondies dans une temporalité différente de celle du juge, en procédant à des auditions de personnes ou à des vérifications sur place et en bénéficiant d’un accès étendu aux documents administratifs, tout en ayant la capacité de mettre en demeure les personnes sollicitées. Si la communication de certains documents ou informations peuvent leur être refusée comme ceux couverts par la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut être opposé au DDD, ainsi que le secret médical ou le secret professionnel applicables aux relations entre un avocat et son client si la personne concernée en fait la demande expresse, tandis que le secret médical n’est est plus opposable au CGLPL, si l’information est transmise aux contrôleurs ayant la qualité de médecin.
Un exemple concernant le DDD témoigne de cet important pouvoir d’enquête dont peuvent disposer les AAI. Dans le cadre du contentieux relatif au décès du militant écologiste Rémi Fraisse lors d’une manifestation contre le barrage de Sivens, les requérants ont invoqué devant la CEDH une violation par l’État de son obligation de protéger le droit à la vie fondée sur l’article 2 en soutenant un manque d’effectivité de l’enquête menée par les autorités de police et judiciaires. Si la Cour juge qu’il n’y a eu aucun manquement, elle souligne au passage « la qualité des investigations réalisées par le Défenseur des droits, qu’il a menées d’office et qui ont donné lieu à une décision particulièrement circonstanciée […] »47.
B. Dénoncer l’inexécution des décisions de justice
Pour le juge européen, le droit à l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du droit au procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif48. Or les AAI dénoncent de manière récurrente la tendance actuelle de la résistance à l’exécution de certaines décisions de justice par les pouvoirs publics. Par leur rôle pédagogique de rappel et d’explication du doit, elles peuvent ainsi « conférer à l’autorité de la chose jugée ce qui lui fait parfois défaut : la qualité de la chose acceptée »49.
La CNCDH, dans sa Déclaration sur l’exécution des décisions de la CEDH du 5 octobre 2024 a rappelé au gouvernement l’importance pour la France de l’exécution des décisions de justice. Concernant les expulsions d’étrangers que le ministre de l’Intérieur a voulu poursuivre en violation des mesures provisoires ordonnées par la Cour européenne, elle dénonce les réactions de celui-ci remettant en cause l’autorité de la Cour et « le principe même de la prééminence du droit ». C’est ce même principe qui est rappelé dans le rapport annuel pour 2023 du DDD qui souligne qu’« en méconnaissant ainsi le droit au juge et en particulier le droit à l’exécution des décisions de justice, la puissance publique s’affranchit de la règle de droit et remet en cause l’autorité des institutions juridictionnelles ». Il en conclut qu’une telle pratique participe sur le long terme d’une atteinte à « la stabilité du système juridictionnel et [à la] confiance du public dans la justice ».
Les AAI agissent ainsi par la dénonciation publique en invitant les autorités à prendre les réformes nécessaires pour se conformer aux condamnations juridictionnelles. Par leur « pouvoir juridique de savoir » et leur « pouvoir de faire savoir »50, elles déploient en effet ce que l’on pourrait appeler des forces de dissuasion et de persuasion. Ce pouvoir de dénonciation prend une forme diversifiée et de plus en plus d’ampleur à travers les avis et rapports, les tribunes croisées, les alertes et mises en garde, mais aussi de manière plus efficace, par le dispositif des recommandations en urgence qui peuvent être adoptées par le CGLPL, permettant de rendre visible de manière immédiate par sa publication au Journal Officiel une atteinte grave aux droits fondamentaux51, ou encore par la possibilité pour le DDD d’établir un rapport spécial rendu public si ses mises en demeure ne sont pas suivies d’effet.
De manière plus précise encore, les AAI peuvent intervenir une seconde fois, après le juge, pour amplifier les décisions passées en force de chose jugée, par la mise en œuvre d’un suivi de la jurisprudence. Ce rôle de surveillance de la bonne exécution des décisions de justice a été institutionnalisé pour la CNCDH, qui en tant qu’institution nationale des droits de l’homme accréditée selon les principes de Paris peut intervenir dans le cadre de la procédure de contrôle réalisée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Elle est ainsi intégrée depuis 2016 dans le service de l’exécution des arrêts de la CEDH (Sevex) et reçoit systématiquement les plans et bilans d’action émis par la direction juridique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Elle a ainsi plus particulièrement invité les autorités à prendre les réformes nécessaires pour se conformer aux condamnations européennes concernant les expulsions de terrain (CEDH, 28 avril 2016, Winterstein et autres c. France, n° 27013/07), la situation des mineurs isolés étrangers (CEDH, 18 février 2019, Khan c. France, n° 12267/16 ; 25 juin 2020, Moustahi c. France, n° 9347/14) ou les conditions de détention dans les prisons (CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France).
De son côté, et alors qu’il n’a pas hérité expressément du Médiateur de la République se son pouvoir d’injonction à un organisme mis en cause de se conformer à l’exécution d’une décision de justice, le DDD s’est néanmoins doté de cette compétence d’office, y compris au moyen de vérifications sur place. Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’arrêt Moustahi c. France concernant la situation des mineurs isolés, il est ainsi intervenu auprès du service de l’exécution des arrêts de la Cour du Conseil de l’Europe52. De même, à la suite de la jurisprudence Popov c/ France53, il a exhorté, conjointement avec la CNCDH, le ministre de l’Intérieur à donner des instructions aux préfets afin de ne plus placer des enfants en rétention.
Se posant de manière plus particulière pour le CGLPL, cette compétence a été récemment affirmée par l’institution au titre de sa mission de contrôle du respect des droits fondamentaux dans le cadre du contentieux des conditions indignes de détention, dans lequel les voies de recours se multiplient sans effets concrets. En témoigne son rapport thématique de 2024 consacré à L’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention, dans lequel il a scruté la jurisprudence des juges administratif et judiciaire et en particulier celle du nouveau recours créé par la loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, pour en faire un bilan plutôt négatif. Il recommande des améliorations procédurales pour renforcer le suivi de l’exécution des injonctions prononcées par le juge administratif, comme l’instauration d’un mécanisme d’astreinte automatiquement liquidée sur le modèle de ce que prévoient les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitat relatives au droit au logement opposable ou l’organisation d’une audience de suivi après le prononcé d’injonctions.
Par ce rôle de surveillance, les AAI se font ainsi les auxiliaires du juge en donnant plus de résonnance aux décisions de justice. Mais leur rôle de protection du droit au recours effectif ne se situe pas uniquement dans le cadre des recours contentieux et de leur exécution. Elles interviennent également en dehors des instances juridictionnelles en contribuant à redessiner l’infrastructure contentieuse du droit au recours effectif.
II. Un rôle méta-contentieux : rendre compte de l’ineffectivité du droit au recours effectif
Le droit au recours n’est effectif, même s’il est consacré et garanti par les normes, même s’il est mis à la disposition des individus à travers l’existence de voies de recours, qu’à la condition que les intéressés décident de le mettre en œuvre, de le mobiliser. Par leur expertise, les Human rights ombudsmen objets de cette étude, questionnent la réalisation sociale du droit au recours effectif (A). Tout en identifiant les situations d’empêchement à sa mobilisation, ces autorités déploient en parallèle une action de compensation et de prévention de son ineffectivité (B).
A. Une analyse situationnelle du droit au recours effectif
L’ancien Défenseur des droits Jacques Toubon a lui-même qualifié l’activité de cette institution de « sismographe » des droits fondamentaux54, traduisant ainsi la capacité de cette Autorité à anticiper les contentieux émergents, qui ne sont pas forcément toujours visibles aux yeux des juges et des pouvoirs publics. Pour exercer ce rôle, les AAI dont nous discutons dans cette étude vont à rebours de la lecture classique des droits fondamentaux pour renouveler l’appréhension de leur effectivité, en particulier celle du droit au recours effectif.
Un droit est en effet classiquement considéré comme protégé dès lors qu’il peut être invoqué devant un juge pour obtenir la sanction de sa violation ou la contrainte de son respect. Cette conception repose sur une lecture défensive et volontariste du droit, à travers laquelle l’action en justice est intégrée à la notion même de droit subjectif55. Ce prisme repose sur une vision offensive et procéduraliste des droits, qui suppose la volonté, et surtout la capacité de l’individu de mobiliser ses droits devant le juge pour les opposer à autrui56. « La machine jugeante [étant] inerte de sa nature »57, pour reprendre la formule de Walline, il faut que l’individu ait la volonté et la capacité d’actionner son droit au recours. Celui-ci apparaît dès lors comme un droit « d’affirmation, d’emprise et d’action sur le monde », revoyant à la notion d’« empowerment » et non comme un droit de protection, selon la distinction établie par Stéphanie Hennette Vauchez58.
Cette conception est cependant aujourd’hui remise en cause car la capacité juridique de la personne à revendiquer en justice, qui est postulée, suppose une « force sociale » pour agir en justice, laquelle peut faire défaut dans des situations de vulnérabilité comme l’enseigne la sociologie du procès59. Plusieurs paramètres sont en effet nécessaires pour mobiliser son droit au recours : percevoir l’injustice ; la qualifier en des termes juridiques ; envisager sa réparation auprès de l’entité supposée responsable ; et en cas d’échec envisager un recours au juge. Cette dernière étape peut encore rencontrer des obstacles : méconnaissance des voies de recours, coût de la justice, complexité la procédure juridictionnelle, lenteur des procédures, ou encore la charge émotionnelle et psychologique des contentieux60. La simple titularité du droit au recours effectif ne suffit donc pas, elle nécessite la capacité sociale de l’exercer, de le mobiliser, de le revendiquer, de s’en prévaloir, pour que le titulaire en soit également le bénéficiaire.
En prenant la mesure des non-recours, les AAI ici étudiées vont à rebours de cette conception volontariste et universaliste du droit au recours effectif pour identifier les situations d’entrave à sa mobilisation par les individus. La plongée dans l’analyse situationnelle des droits par les AAI se réalise à travers la détection des situations de non-recours lesquelles sont invisibles par le juge qui ne reçoit quant à lui que les réclamations d’individus qui exercent justement leur pouvoir juridique d’ester en justice. En s’extrayant de la logique contentieuse pour analyser le droit en (con)texte par un travail de terrain, à travers leurs visites et contrôles, les saisines qu’elles reçoivent, ou les études pluridisciplinaires qu’elles soutiennent ou qu’elles réalisent elles-mêmes, les Human rights ombudsmen ont ainsi développé la capacité d’analyser les usages et non-usages sociaux du droit au recours.
Dans son Enquête sur l’accès aux droits, publiée en 2017, le DDD mettait ainsi en évidence le risque du non-recours, et soulignait que « l’abandon des démarches administratives, qui touche 12 % des usagers des services publics, en tête desquels les usagers du service public de la justice, est ainsi plus fréquent au sein des populations confrontées à des difficultés socio-économiques marquées ». Deux études soutenues par la même Autorité et publiées en 2023 visent à comprendre les facteurs du non recours aux droits par les plus démunis, qu’il s’agisse de la faible mobilisation du critère de discrimination fondé sur la particulière vulnérabilité économique61 introduit par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, ou en matière d’accès des ménages les plus pauvres au parc social. De son côté, dans son Avis sur l’accès aux droits et les non-recours de 2022, la CNCDH a rendu compte de la difficulté pour les citoyens de voir respecter leurs droits en raison de la complexité des démarches administratives pour accéder aux prestations sociales, au logement, à la santé, à l’éducation, ou encore à la formation professionnelle. Elle annonce d’ailleurs travailler sur un avis ultérieur dédié aux non-recours contentieux62. Dans son rapport thématique consacré à L’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention le CGLPL s’est également appuyé sur une série d’entretiens réalisés auprès de personnes détenues, d’avocats, de magistrats et d’associations afin de mesurer sur le terrain, et non pas seulement dans les textes le point de vue des acteurs – tant magistrats que requérants – de la mise en œuvre et de la mobilisation de ces voies de recours.
Ces enquêtes de terrain ont ainsi permis aux AAI d’identifier des situations de vulnérabilité qui constituent autant de situations d’empêchement d’exercer le droit au recours effectif : la situation de privation de liberté, la situation de précarité économique ou administrative, la situation d’éloignement social, territorial63 ou numérique, sachant que ces situations peuvent se superposer.
Fortes de ces analyses de terrain, les Human rights ombudsmen ont la capacité de déployer un rôle compensatoire et préventif visant à renforcer voire à restaurer l’effectivité du droit au recours effectif.
B. Un rôle compensatoire et préventif
Si le droit au recours effectif est la condition d’effectivité des autres droits, son effectivité est elle-même conditionnée par plusieurs dispositifs comme l’aide juridictionnelle et, de manière encore plus conditionnante, par l’accès à l’information sur les droits et les recours existants. Pour y contribuer, les AAI ici étudiées exercent tout d’abord un rôle de pédagogie et d’information. Le DDD offre en ce sens un accompagnement en « informant toute personne qui s’adresse à lui sur la nature et l’étendue de ses droits (accès à la connaissance des droits) et sur les moyens de les faire valoir (accès à l’exercice de ses droits) »64. Le même travail de pédagogie et d’adaptation au public concerné a été réalisé avec la réalisation d’un guide pour les personnes détenues mis à disposition dans les bibliothèques des établissements pénitentiaires et qui utilise un langage clair, pour leur permettre de s’en saisir et de connaître leurs droits et voies de recours. Dans son rapport consacré à L’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention, le CGLPL préconise de son côté une meilleure information des personnes détenues par la mise à disposition « d’un crédit d’heures annuel leur permettant de bénéficier de conseils et de l’appui juridique d’un avocat commis d’office en dehors de toute procédure juridictionnelle ou non juridictionnelle » et de « kits de saisine » clé en main portant sur les recours juridictionnels.
Il se peut cependant que l’accès à ces autorités non juridictionnelles soit lui-même difficile pour les justiciables65. Aussi, dans une démarche « d’aller vers » les individus, les AAI cherchent à se rendre plus accessibles. Prenant le contrepied de l’éloignement du juge, elles affichent leur proximité comme en témoigne la présence de délégués territoriaux du DDD dans différents points d’accueil, la plateforme numérique antidiscriminations, ou encore le numéro téléphonique gratuit mis à disposition des personnes détenues.
Leur saisine est également facilitée, directe, gratuite et dispensée du ministère d’avocat, ce qui en fait des autorités plus accessibles que le juge, au point qu’elles soient parfois « préférées aux prétoires »66. Le DDD en est l’exemple type puisqu’il peut être saisi directement, sans avoir à exercer un recours juridictionnel en parallèle67, sans intermédiaire, par courrier ou même par voie électronique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme, pour des faits même anciens.
En dehors du cadre des visites qu’il peut mener, le CGLPL s’est également rendu accessible par sa propre organisation interne. La loi de 2007 prévoyait seulement la possibilité pour toute personne de porter à sa connaissance des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence, sans obliger l’Autorité à y répondre. L’institution a elle-même formalisé une procédure de réponse aux courriers par la création d’un « pôle saisines » chargé de les traiter et de les orienter. Il en est de même pour la CNCDH dont le site internet précise que la commission « ne peut agir directement sur saisine d’un particulier ou d’une association » mais qu’elle a cependant « développé des modes d’action pour agir en soutien des citoyens et pour porter la question de l’effectivité des droits de l’homme devant les juridictions nationales ». Les réclamations individuelles sont ainsi « analysées très sérieusement, puis orientées vers les services compétents » et « la CNCDH s’emploie à répondre à chacune d’elles ». Par la création spontanée de cette toile protectrice pour les individus, les Human rights ombudsmen peuvent ainsi apparaitre comme des leviers immédiats de la protection des droits et libertés fondamentaux.
Enfin, – et c’est peut-être le trait commun caractéristique de la protection des droits garantie par ces autorités – par leur pouvoir d’autosaisine, les AAI ont la capacité de s’extraire des requêtes individuelles pour passer de l’individuel au collectif, de la logique corrective à la logique préventive.
Quel que soit en effet le raffinement temporel du droit au recours effectué notamment par le juge européen68 ou le mécanisme du référé-liberté69, et même si l’on peut identifier une fonction préventive dans ce que la doctrine appelle la fonction disciplinaire du recours indemnitaire70, le juge intervient forcément après l’atteinte à une liberté fondamentale. Il ne fait que courir après l’effectivité des droits. Agissant dans une temporalité différente de celle du juge, les AAI s’extraient alors du prisme contentieux pour porter leur action sur un terrain plus systémique, dans le but « d’agir à la source des obstacles à l’accès aux prétoires dans l’intérêt non plus d’un seul justiciable mais du plus grand nombre »71. Selon le DDD, il s’agit de passer d’une approche « centrée sur le cas » à une approche en termes de « politiques publiques », non plus seulement par « en bas » mais « par en haut »72. C’est tout l’enjeu du contrôle préventif exercé par le CGLPL sur les lieux d’enfermement, qui vise non pas à répondre à un dysfonctionnement ou une réclamation en particulier, mais à soulever des problématiques structurelles au sein des lieux d’enfermement. C’est ce qui transparaît également de la doctrine de la CNCDH et de son « approche fondée sur les droits de l’Homme », qui vise à intégrer l’évaluation des atteintes aux droits fondamentaux dans les études d’impacts des politiques publiques et leur mise en œuvre. Également, en matière de lutte contre les discriminations, le DDD a défendu la création du recours de l’action de groupe qui « par sa dimension collective », doit permettre « la mise en lumière de mécanismes de discriminations et reproduction des inégalités résultant à la fois de pratiques professionnelles, de règles non écrites des organisations et de biais conscients ou inconscients à l’œuvre dans bien des décisions » et « conduire les juges à traiter les discriminations dans leur manifestation systémique »73. Mais il invite également à dépasser l’action contentieuse pour « engager l’ensemble des corps sociaux dans une démarche visant à interroger puis transformer les comportements et pratiques afin de promouvoir durablement l’égalité »74.
Ce rôle de promotion des droits fondamentaux constitue la part la plus originale du contrôle des Ombudsmen, celle qui est la moins réductible aux contrôles de type juridictionnel. Les AAI ont ainsi la capacité de se détacher des contraintes qui pèsent sur le juge, qu’elles soient temporelles et procédurales, ou institutionnelles et politiques. Si le juge ne peut pas tout75, les AAI peuvent quant à elles, tout se permettre. A la différence du repli du juge derrière l’argument de la séparation des pouvoirs, qui refuse de se faire juge-administrateur, les AAI n’hésitent pas à endosser un rôle d’« entrepreneur politique »76. L’absence d’autorité de la chose jugée de leurs prises de position fait ainsi la « force de ses institutions faibles »77.
Ceci n’est pas sans susciter des critiques, de la part des autorités publiques comme de la doctrine. Le rapport de la mission d’information sur le DDD remis en 2020 en est une illustration. Le professeur Bertrand Mathieu y souligne que « l’intervention du DDD devant les juges est souvent à la fois trop partisane et utilisée comme un outil visant à la transformation du droit, ce qui n’est pas le rôle du juge, mais celui du législateur ». Tandis que pour l’ancien président du tribunal administratif de Strasbourg, les observations en justice du DDD constituent des « prises de position para-juridiques fondées sur une approche du juste et de l’injuste plutôt désincarnée, et en tout cas sans lien avec les exigences du traitement d’un dossier contentieux par un juge ». La critique la plus forte réside peut-être dans les observations de la Cour des Comptes concernant la CNCDH publiées en décembre 2023 qui dénoncent la sévérité de sa contribution sur l’état des droits fondamentaux en France dans le cadre de l’examen périodique universel de l’ONU. La juridiction financière dénonce la partialité de l’évaluation scientifique des politiques publiques réalisée par la CNCDH, en raison de l’absence de cadre quant au choix des personnes à auditionner ou des chercheurs et laboratoires de recherche chargés de réaliser des études et de contribuer à ses rapports, remettant ainsi en cause leur indépendance. Aussi, loin d’être réservée aux juges, on pourrait alors parler de l’« insupportable indépendance »78 des AAI en matière de protection de l’effectivité des droits, domaine qui suscite encore et toujours, l’inquiétude.
1 A. Jeammaud, « Le concept d’effectivité du droit », in Ph. Auvergnon (dir.), L’effectivité du droit du travail : à quelles conditions ?, Presses universitaires de Bordeaux, 2e éd., 2008, p. 36.
2 V. Champeil-Desplats, « Effectivité et droits de l’homme : approche théorique », in V. Champeil-Desplats et D. Lochak (dir.), À la recherche de l’effectivité des droits de l’Homme, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008, p. 11-26.
3 X. Dupré de Boulois, « La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité administrative » RDLF 2024 chron. n°82 (www.revuedlf.com).
4 V. J.-F. Perrin, « Qu’est-ce que l’effectivité d’une norme juridique ? », in Pour une théorie de la connaissance juridique, Genève, Droz, 1979, p. 93 .
5 É. Severin, « Introduction. Une enquête juridique sur la place du collectif dans la justice contemporaine », in I. Omarjee et L. Sinopoli (dirs.), Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, coll. « Thèmes & commentaires. Actes », Paris, Dalloz, 2014, p. 4.
6 Cons. const. Déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France.
7 L. Favoreu et T.-S. Renoux, « Le contentieux constitutionnel des actes administratifs », Répertoire Dalloz du contentieux administratif, Sirey, 1992, p. 90 et s.
8 N. Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, L.G.D.J., Paris, 1997, p. 238.
9 T.-S. Renoux, « Le droit au recours juridictionnel », J.C.P. G., 1993, I, 3675.
10 CEDH, 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, Req. n° 4451/70.
11 A. Tamion, « Le process-based review dans la jurisprudence la Cour européenne des droits de l’homme, ou le problème de la rationalité procédurale dans les démocraties libérales », RDLF 2025 chron. n°26. V. M. Sinkondo, « Le fabuleux destin de l’article 13 de la C.E.D.H. et ses suites heureuses pour les garanties individuelles », R.R.J., 2005, n° 1, p. 251.
12 CEDH, 19 nov. 2020, Barbotin c. France, n°25338/16.
13 Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Recommandation n° R (2000) 3, 19 janv. 2000.
14 J. Commaille, L. Dumoulin, « Heurts et malheurs de la légalité dans les sociétés contemporaines. Une sociologie politique de la ‘‘judiciarisation’’ », L’Année sociologique, 2009, 59, n° 1, p. 87.
15 G. Schmitter, « Etendue et limites du droit au recours juridictionnel », RFDC 2015, p. 935.
16 D. Lörher, La protection non juridictionnelle des droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé, Institut Universitaire Varennes, 2014.
17 E. Balladur, Une Ve République plus démocratique – Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, 2007, p. 85.
18 D. Lörher, op. cit., p. 48.
19 R. Pleven, Assemblée nationale, JORF 14 déc. 1972, p. 6211.
20 O. Renaudie, « La genèse complexe du Défenseur des droits », RFDA, 2011, n° 139 (3), p. 397.
21 X. Bioy (dir.), « Actualité des autorités administratives indépendantes dans le domaine des libertés fondamentales (chronique n° 2) », LPA, 1er avr. 2014, n° 65, p. 6.
22 D. Löhrer, « La fonction d’aide à l’accès au juge du Défenseur des droits », RFDC, 2020, n° 121(1), pp. 189-221.
23 Ch. Soulard et D.-R. Tabuteau, Propos introductifs du colloque « Le Défenseur des droits et le juge », 7 février 2025, https://www.defenseurdesdroits.fr/retour-sur-le-colloque-le-defenseur-des-droits-et-le-juge-812.
24 Ibid.
25 M. Foucault, « La redéfinition du judiciable », intervention au séminaire du Syndicat de la Magistrature (1977), Vacarme, 2004, 29(4), pp. 54-57.
26 Le Comité consultatif National d’Éthique, qualifié d’institution indépendante par l’art. L. 1412-2 du code de la santé publique, et relevant également du programme budgétaire 308, est écarté de cette étude car son action peut difficilement s’insérer dans un rôle de complémentarité avec la voie juridictionnelle. La question mériterait cependant une étude plus approfondie au regard de l’influence de ses avis sur les juridictions en matière de bioéthique. V. notamment sur la problématique des « mères porteuses » et le principe d’indisponibilité du corps humain, Cour de cass., Ass plén., 31 mai 1991, JCP G, 1991, II, 21752, p. 381, obs. F. Terré
27 Il en est ainsi de la Commission de l’informatique et des libertés ou de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui semblent concurrencer le juge et dont « dont la légitimité et les modalités d’action questionnent », M. Grandjean, « Lutte contre les contenus illicites en ligne : plaidoyer en faveur d’un retour au juge », Légipresse, 2024, n° 421, p. 22 et n° 422, p. 89.
28 Il en est ainsi par exemple du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ainsi que du Médiateur de l’énergie.
29 Sont ainsi exclues du champ de l’étude, la Commission d’accès aux documents administratifs dont la saisine est obligatoire avant tout recours contentieux (Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration), la Commission nationale consultative des techniques de renseignements qui doit être saisie pour vérifier la mise en œuvre d’une technique de renseignement avant de déclencher un recours devant la formation de jugement spécialisée du Conseil d’État (art. L. 833-4 et 841-1 du code de la sécurité intérieure), la Commission du secret de la Défense Nationale qui peut être saisie par les juridictions pour rendre un avis en matière de déclassification des documents classés secret-défense (art. L. 2312-4 du Code de la défense), ou encore l’action de médiation du Défenseur des droits, dont la saisine portant sur une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, interrompt le délai de recours contentieux (art. L. 213-14 du code de justice administrative).
30 Art. 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
31 Art. 1 de la loi n° 2007-1545 du 30 oct. 2007.
32 CEDH, 31 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, Req. n° 9671/15 et 31 autres.
33 D. Lörher, La protection non juridictionnelle des droits, op. cit., p. 396.
34 R. Bousta, « Contribution à une définition de l’Ombudsman », Revue française d’administration publique, 2007, n° 123 (3), pp. 387-397.
35 Les pouvoirs d’action en justice du DDD s’arrêtent cependant ici. Il n’a pas par exemple la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, alors même que des propositions en ce sens ont été faites. V. Rapport n° 3203, du 15 juil. 2020, de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le Défenseur des droits. Il ne peut non plus – comme cela avait un temps été envisagé – déposer une requête en vue de la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi (A. Dezallai, « Une action collective en matière de droits fondamentaux devant le juge administratif ou devant le Défenseur des droits ? », RFDA, 2011, p. 925).
36 V. par ex. Déc. 2018-090 du 8 mars 2018 portant observations devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’examen de la loi permettant une bonne application du régime d’asile européen ; Déc. 2019-086 du 28 mars 2019 relative à la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations ; Déc. 2023-253 du 4 décembre 2023 portant observations devant le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de la loi pour le plein emploi ; Déc. 2023-157 du 13 juillet 2023 portant observations devant le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de la de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ; Déc. 2024-001 du 12 janvier 2024 portant observations devant le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ; Déc. 2025-100 du 28 mai 2025 portant observations devant le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de la loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants.
37 Le DDD n’a pas présenté d’observations en intervention directement dans le cadre d’une QPC. Le règlement intérieur du Conseil constitutionnel semble réserver cette faculté aux organismes qui présentent un « intérêt spécial » et disposent de la personnalité morale. V. sur ce point A.-M., Lecis Cocco Ortu, « QPC et interventions des tiers : le débat contradictoire entre garantie des droits de la défense et utilité des amici curiae », RFDC, 2015, 104(4), 863-886.
38 J. Mouchette, La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, LGDJ, 2019, p. 466.
39 Le rapport parlementaire d’information de 2020 sur le DDD recommande une clarification de l’usage de cette prérogative, « qui doit être adaptée aux conditions du procès et respectueuse de l’équilibre entre les parties », https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3203_rapport-information#_ftnref277.
40 DDD, Déc. n° 2021-195 du 29 octobre 2021 portant observations devant le Conseil d’État dans le cadre de l’action de groupe portant sur les contrôles d’identité discriminatoires ; CE, Ass. 11 oct. 2023, Amnesty International France et autres, n° 454836.
41 M. Lafourcade, « Les tierces interventions de la commission nationale consultative des droits de l’homme devant la cour européenne des droits de l’homme », RDLF 2023, chron. n°35.
42 CEDH, 21 août 2015, Yengo c. France, Req. n° 50494/12 ; 22 oct. 2021 ; J.M.B. c. France du 30 janvier 2020, Req. n° 9671/15.
43 Cons. const. Déc. n° 2018-717/718 QPC du 6 juil. 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger].
44 V. Lamy, « La circulation de la norme du CGLPL dans la jurisprudence administrative », in E. Gallardo, M. Giacopelli (dir.), L’élaboration d’un droit de la privation de liberté. Étude autour des recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Lexis Nexis, 2020, p. 88 et s.
45 CGLPL, Rapport d’activité 2021, Dalloz, 2022, Avant-propos, p. 8.
46 Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 21-84.498.
47 CEDH, 27 février 2025, Fraisse et autres c. France, Req. n° 22525/21 et 47626/21.
48 CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, Req. n° 18357/91.
49 D. Löhrer, « Le soutien du Défenseur des droits à l’exécution des décisions de justice », RFDA 2016 p.727.
50 P. Gélard, Rapport de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation sur les Autorités administratives indépendantes, T. I, 2006, p. 52.
51 Les conditions de détention dans certains établissements pénitentiaires ont ainsi été dénoncées avec efficacité par le biais de cet outil, comme en attestent les recommandations en urgence du 12 novembre 2012 relatives au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, CE, ord., 22 déc. 2012, OIP-SF, n° 364585 et s., Rec. p. 496 ; CGLPL, Recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 12 novembre 2012, JORF, 6 décembre 2012. V. A. Morineau, L’affaire des Baumettes, acte fondateur d’une communication au service de l’amélioration des conditions de détention pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Mémoire de l’Université Paris II, 2014.
52 DDD, Déc. n° 2025-068 du 14 avril 2025 relative à une tierce-intervention sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Moustahi c. France.
53 CEDH, 19 janv. 2012, Req. n° 39472/07 ; Observations relatives au suivi de l’exécution de l’arrêt de la CEDH : Popov et Yekatenko c. France, 26 avril 2013.
54 DDD, Rapport annuel d’activité 2019, p. 3.
55 H. Motulsky, « Le droit subjectif et l’action en justice », in Écrits, tome 1, Études et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, pp. 85-100. Cette lecture est très bien formulée par Jean Carbonnier, pour qui le sujet de droit n’est pas seulement le réceptacle de droits mais de manière plus dynamique « un sujet, un titulaire d’action en justice », J. Carbonnier, « Être ou ne pas être, sur les traces du non-sujet de droit », repris in Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ième éd., LGDJ, 2001, extraits, p. 233.
56 C. Roulhac, L’opposabilité des droits et libertés, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2018, p. 368.
57 M. Waline, La notion judiciaire de l’excès de pouvoir, Dalloz, Paris, 1926, p. 160.
58 S. Hennette-Vauchez, « Le principe de dignité de la personne humaine, socle des droits fondamentaux de la personne détenue ? », in S. Boussard (dir.), Les droits fondamentaux de la personne détenue, Dalloz, 2013, p. 51.
59 E. Blankenburg, « La mobilisation du droit. Les conditions du recours et du non-recours à la justice », Droit et Société, 1994, 28, p. 691.
60 V. D. Löhrer, « La fonction d’aide à l’accès au juge du Défenseur des droits », RFDC, 2020, n° 121(1), pp. 189-221.
61 L’étude que le DDD a soutenue et financée dans le cadre d’un appel à projet, consacrée à « La particulière vulnérabilité résultant de la situation économique : éclairages sociologiques en vue d’une meilleure appréhension par le droit de la non-discrimination », a été réalisée par une équipe de recherche de l’Université de Grenoble Alpes.
62 V. sur ce point, V. Donier et B. Laperou-Scheneider (dir.), L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, Éditions l’Épitoge – Lextenso, 2015.
63 CNCDH, Avis sur les violences urbaines, périphéries et accès aux droits, 19 déc. 2024, JORF n°0006 du 8 janv. 2025, texte n° 43 2014 ; Avis sur l’accès au droit et à la justice dans les Outre-mer, 22 juin 2017, JORF n°0157 du 6 juil. 2017, texte n°89.
64 D. Löhrer, « La fonction d’aide à l’accès au juge du Défenseur des droits », op. cit.
65 Il est à souligner que dans son enquête sur l’accès aux droits, le DDD a pu constater que seulement un peu plus de 40 % de personnes avaient connaissance de son existence et de son rôle.
66 D. Löhrer, « La fonction d’aide à l’accès au juge du Défenseur des droits », Ibid.
67 La saisine du DDD suppose cependant que la personne ait accompli « les démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause », si la réclamation concerne un dysfonctionnement dans un service public. Une autre limite mérite d’être questionnée, à savoir l’effet non suspensif de la saisine du DDD sur les délais de recours contentieux. V. L. Cluzel-Métayer, « Réflexions à propos de la saisine du Défenseur des droits », Revue française d’administration publique, 2011, n° 139(3), pp. 447-460.
68 Il estime par exemple qu’en matière de conditions indignes de détention, un recours indemnitaire est insuffisant pour être effectif et qu’il doit être accompagné de ce qu’il appelle un recours préventif, pour empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention ou de permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. V. par ex. CEDH, 19 nov. 2020, Barbotin c. France, n°25338/16.
69 La notion de « sauvegarde » d’une liberté fondamentale induit en effet une temporalité plus immédiate pour l’intervention du juge, qui est en l’occurrence de 48 heures.
70 V. sur ce point, S. Brimo, « Pour la valorisation de la fonction préventive du juge de la responsabilité administrative. L’exemple des contentieux sanitaires et sociaux », in A. Jacquemet-Gauché (dir.), Dépasser la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité administrative, IFJD, coll. colloques & essais, 2023, p. 67 et B. Delaunay, La faute de l’administration, LGDJ, Biblio. Dr. public, 2007, n°264 et s. V. également pour l’identification d’une « fonction « jurislative » du recours indemnitaire, X. Dupré de Boulois, « La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité administrative », RDLF 2024 chron. n°82 (www.revuedlf.com)
71 D. Löhrer, « La fonction d’aide à l’accès au juge du Défenseur des droits », op. cit.
72 DDD, Droits des usagers des services publics : de la médiation aux propositions de réforme, 2024, p. 14.
73 DDD, Avis n°24-01 sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, 25 janvier 2025.
74 DDD, Recommandations transversales en matière de lutte contre les discriminations, février 2024, p. 3.
75 A. Goin, L. Cadin, « Le juge ne peut pas tout », AJDA 2023 p. 2105
76 Pour reprendre la formule de l’ancien adjoint du Defensor del Pueblo péruvien utilisée par le DDD pour présenter son l’originalité de son rôle, DDD, Droits des usagers des services publics : de la médiation aux propositions de réforme publié en juin 2024, p. 16.
77 N. Pedriana et R. Stryker, « The Strength of a Weak Agency : Enforcement of Title VII of the 1964 Civil Rights Act and the Expansion of State Capacity, 1965-1971 », American Journal of Sociology, 110 (3), 2004, p. 709-760. Cité in J. Mouchette, « Le Défenseur des droits et la fabrique d’un problème public : le cas des violences policières », in E. Debaets, V. Palma et J. Schmitz, La doctrine des autorités administratives indépendantes, Mare et Martin, à paraître.
78 J.-D. Bredin, Le Monde, 26 novembre 1987. V. J. Douvreleur et O ; Douvreleur : « Le principe d’indépendance : de l’autorité judiciaire aux autorités administratives indépendantes », in Libertés. Mélanges J. Robert, Montchréstien, 1998, p. 323-343.



