Les femmes, un certain groupe social ?
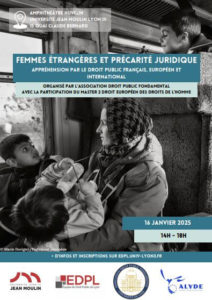
Par Marie-Laure Basilien-Gainche, Professeure de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, EDIEC, Membre senior de l’Institut Universitaire de France, Membre de l’Institut Convergences Migrations
Introduction
Le droit international de la protection des réfugiés, tel qu’institué par la Convention de Genève de 1951, peine encore à saisir pleinement la réalité spécifique des persécutions fondées sur le genre. Alors même que les atteintes aux droits fondamentaux des femmes, notamment en contexte de conflit ou d’autoritarisme, sont massives et systémiques, leur reconnaissance comme motifs autonomes d’octroi de l’asile demeure marginale et, trop souvent, inadaptée. En effet, le réfugié est défini à l’article 1 A (2) de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié comme une personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, n’ayant pas de nationalité et se trouvant hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner ». Aucune place n’est apparemment laissée au genre et au sexe dans les motifs de persécutions, manifestant une certaine inadéquation du texte de la Convention aux réalités contemporaines[1]. Cependant, des inflexions induites par l’exploitation du motif de l’appartenance à un certain groupe social se sont opérées, qui ont notamment marqué la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2024.
Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2024 dans l’affaire WS (C-621/21), la Cour de Luxembourg s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Opuz c. Turquie du 9 juin 2009 (n° 33401/02), selon lequel le défaut pour un Etat partie de protéger une femme de la violence domestique peut constituer une violation de son obligation de garantir le droit à la vie[2]. La Grande chambre de la CJUE, dans l’affaire WS de janvier 2024 relative précisément à des femmes victimes de violence domestique, affirme que les femmes en général peuvent constituer un certain groupe social au titre de l’article 10 § 1 sous d) de la directive 2011/95/UE. Elle insiste à cet effet que ce texte doit être lu à la lumière de la Convention de Genève, de la Convention sur l’élimination de la discrimination contre les femmes (si tous les Etats membres en sont parties, l’UE ne n’est pas), de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (l’UE et quelques Etats membres sont parties), et de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui interdit toute discrimination, notamment fondée sur le sexe. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’arrêt de la CJUE rendu le 4 octobre 2024 dans l’affaire AH & FN (C-608/22 & C-609/22).
Et la Cour de développer sa jurisprudence, en posant que l’ensemble des femmes afghanes a la possibilité d’obtenir le statut de réfugié dans l’Union, en insistant sur le fait que la prise en compte du fait d’être femme et du fait d’être originaire d’Afghanistan suffit à les faire bénéficier de la protection internationale. Cette position marque une avancée majeure dans l’appréhension juridique de la persécution fondée sur le genre. La Cour de Luxembourg valide ainsi les positions adoptées de manière isolée et fragmentaire par certains des Etats membres de l’Union. Fin 2022 et début 2023, les autorités suédoises, danoises, finlandaises, norvégiennes, suisses, ont estimé que toutes les femmes afghanes devraient se voir accordé le statut de réfugié, et ce uniquement sur la base de leur sexe[3]. Ces autorités nationales s’insèrent dans la lignée des positions prises par des agences internationales. Le 25 mai 2023, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) conclut qu’il existe une présomption de reconnaissance du statut de réfugié pour les femmes et filles afghanes dans sa tierce intervention dans l’affaire AH & FN. Dans son rapport publié en mai 2024, l’Agence de l’UE pour l’asile (EUAA) se réfère au Rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Afghanistan et du Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles en Afghanistan de mai 2024, pour affirmer que les Taliban ont imposé une persécution fondée sur le sexe et un cadre institutionnalisé d’apartheid de genre[4].
Il est à relever ici que la problématique n’est pas nouvelle. Les femmes afghanes ont déjà pu bénéficier de la protection conventionnelle et ont pu obtenir le statut de réfugié lors du premier régime des Taliban (1996-2001). La Cour administrative suprême d’Autriche, par un arrêt du 16 avril 2002, a reconnu le droit de toutes les femmes afghanes au statut de réfugié en tant que groupe, concluant qu’« il était suffisant, aux fins de l’octroi de l’asile, que la personne concernée soit affectée par les mesures en question uniquement sur la base de son statut de femme »[5] . Par ailleurs, des femmes d’autres nationalités ont pu ensuite être admises comme composant un certain groupe social : la Chambre des Lords du Royaume-Uni en a décidé ainsi pour les femmes de Sierra Leone[6], pour les femmes du Pakistan[7], pour les femmes du Bangladesh[8] ; le Conseil belge du contentieux du droit des étrangers a décidé de même pour les femmes de Tchétchénie[9], du Burkina-Faso[10], de Guinée[11], du Sénégal[12] ; la Cour nationale du droit d’asile en France a admis beaucoup plus tardivement par exemple que les femmes et les filles composaient un certain groupe social quand elles étaient exposées au risque d’excision au Soudan[13] et au Burkina-Faso pour les seules femmes de l’ethnie mossi[14]. En revanche, d’autres groupes nationaux de femmes se sont vu refuser la reconnaissance comme certain groupe social et partant l’existence d’un motif de persécution à leur encontre : ainsi des femmes mexicaines[15], albanaises[16], sahraouies[17], pakistanaises[18].
Or, pour reconnaître la protection internationale au motif de persécutions subies au titre de l’appartenance à un certain groupe social, les juges ont à répondre à deux questions : les femmes considérées font elle l’objet de persécutions ? les femmes de la nationalité concernée constituent-elles un certain groupe social ? Autrement dit, sont à examiner la notion et le motif de persécution. C’est bien ces deux points que la CJUE envisage dans son arrêt du 4 octobre 2024, alors que la population des femmes afghanes possiblement concernée par un besoin de protection est de quelque 28 millions. Pourtant, peu nombreuses seront celles qui pourront bénéficier du statut de réfugié reconnu par les autorités d’un Etat membre de l’UE. En effet, leur possibilité de parvenir sur le territoire d’un Etat européen sont très limitées. La limitation drastique de leur liberté de mouvement réduit leur capacité à sortir du territoire afghan : il est nécessaire aux femmes afghanes de disposer d’un mahram pour un déplacement de plus de 70 km. En outre, pour celles qui sont parvenues en territoire iranien ou pakistanais, les conditions de délivrance des visas imposées par l’Union et ses Etats membres rendent leur obtention très rare, si bien que les exilés afghans y demeurent dans des conditions très dégradées et dans une hostilité très perceptible, qu’il s’agisse des quatre millions d’entre eux – essentiellement Pashtouns – qui se trouvent au Pakistan[19] ou des cinq millions – essentiellement Tadjiks – qui sont en Iran[20].
Revenons à l’affaire AH & FN du 4 octobre 2024. Car la lecture de l’arrêt de la CJUE invite à examiner la compréhension qui est donnée de la notion de persécution (I) et l’appréhension qui est offerte du motif de persécution résidant dans l’appartenance à un certain groupe social (II). La Cour propose une lecture des discriminations subies par les femmes en Afghanistan qui compose un système d’oppression et qui institue un régime de persécutions ; elle expose les conditions de constitution d’un certain groupe social au sens de l’article 10 § 1 sous d) de la directive 2011/95/UE en précisant leur articulation.
I. La notion de persécution : la structuration des discriminations subies
La CJUE offre, dans son arrêt AH & FN du 4 octobre 2024, une position claire qui est reprise de son arrêt KL du 11 juin 2024 : « l’article 60 § 1 de la convention d’Istanbul dispose que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, devant être comprise comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, doit être reconnue comme une forme de persécution, au sens de l’article 1er, section A, point 2, de la Convention de Genève »[21]. Et la Cour de constater qu’il existe dans l’Afghanistan des Taliban « un système institutionnalisé de ségrégation et de discrimination qui nie délibérément les droits des femmes, ciblant leur dignité uniquement sur la base du sexe »[22]. Ce faisant, la CJUE emploie un vocabulaire qui s’inspire des conclusions rendues par Richard Bennett, Rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Afghanistan : les Taliban ont instauré et renforcé un « système institutionnalisé d’oppression fondé sur le genreet d’exclusion des femmes et des filles »[23] qui vise à exclure les femmes et les filles de tous les aspects de la vie au moyen d’une discrimination systématique. Et de soutenir qu’il convient de considérer la situation comme constitutive d’un « apartheid fondé sur le genre » et d’un « crime contre l’humanité »[24]. Richard Bennet ne fait que répéter ce qu’il a déjà avancé dans son rapport intitulé Le phénomène du système institutionnalisé de discrimination, de ségrégation, de non-respect de la dignité humaine et d’exclusion visant les femmes et les filles du 13 mai 2024[25], et dans le rapport réalisé avec le Groupe de travail sur la discrimination des femmes et des filles sur La situation des femmes et des filles en Afghanistan du 15 juin 2023[26]. En effet, un système d’oppression des femmes et des filles est institutionnalisé (A) qui résulte d’une accumulation de discriminations constitutive de persécutions (B).
A. La situation des femmes en Afghanistan : un système d’oppression
Depuis leur retour au pouvoir le 15 août 2021, les Taliban ont pris plus d’une cinquantaine de décrets visant à réglementer le comportement des femmes et des jeunes filles. Ils ont porté atteinte à leurs droits et libertés, notamment en les excluant du gouvernement provisoire, en supprimant les institutions et mécanismes de promotion de l’égalité de genre et de protection contre les violences basées sur le genre, ainsi qu’en remettant en cause leur droit à la santé, à l’éducation, au travail et leur liberté d’aller et venir. Cette prolifique réglementation discriminatoire s’est traduite par l’effacement progressif, mais systématique, des femmes de la sphère publique, en régissant tous les aspects de leur vie et en leur retirant leurs droits les plus élémentaires : aller à l’école, étudier à l’université, pratiquer un emploi, bénéficier de soins, accéder à la justice, faire du sport, s’habiller comme elles le souhaitent, fréquenter les bains et les parcs publics, se retrouver dans des salons de beauté, exprimer sa pensée y compris dans la sphère individuelle. À la fin du mois d’août 2024, le régime taliban a encore renforcé son contrôle en promulguant une nouvelle loi obligeant les femmes à se couvrir entièrement le visage d’un masque en public, et leur interdisant de faire entendre leur voix en public : elles ne peuvent plus chanter, réciter un texte, lire à haute voix en public, ni élever la voix en privé.
Or, les droits ainsi déniés aux femmes afghanes par les Taliban sont les droits garantis par les déclarations et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international des droits économiques sociaux et culturels (PIDESC), la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le système de contrôle imposé par les Taliban sur les femmes et les jeunes manifeste leur domination, engendre leur oppression, organise leur effacement, prescrit leur désubjectivation : elles sont en effet privées de leur droit à être reconnues comme des personnes dotées de droits devant la loi. Or, une telle situation d’asservissement s’avère propice à l’accroissement des violences à l’encontre des femmes tant dans l’espace public que dans la sphère privée (meurtres, disparitions forcées, torture, viols, agressions sexuelles, esclavage, mariage forcé), violences qui sont condamnées par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT). En outre, il résulte de ce régime d’oppression une intensification de la paupérisation des femmes qui se trouvent dépourvues de tout moyen de subvenir de manière indépendante à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, aggravant leurs vulnérabilités aux violences et à l’exploitation. Or, il ne saurait être négliger que la situation des femmes est encore plus préoccupante quand elles présentent un handicap, ont une orientation sexuelle différente, appartiennent à des minorités ethniques, religieuses, ou linguistiques.
B – La persécution des femmes : l’accumulation des discriminations
Selon James C. Hathaway et Michelle Foster[27] (2014, p. 195), le déni d’un droit de l’homme reconnu à l’échelle internationale, s’il est continu ou systémique, implique une persécution. Or, les femmes et filles afghanes se voient dénier leurs droits par le régime taliban qui instaure une architecture d’oppression et qui impose un système de ségrégation, dont la conséquence est une exclusion fondée sur le genre, comme le martèle le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en Afghanistan. Il s’agit de savoir si les juges admettent que de telles discriminations à caractère généralisé et systémique sont constitutives de persécutions au sens de l’article 1 A 2) de la Convention de Genève de 1951. L’article 9 §2 sous f) de la directive 2011/95 reprend cette disposition dans l’ordre juridique de l’Union. Or, le texte apporte des précisions : un acte de persécution doit « être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ; ou bien doit « être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable ». Autrement dit, deux cas de figure se présentent.
Soit les discriminations subies sont en elles-mêmes constitutives de persécutions : tel est le cas du mariage forcé assimilé à l’esclavage, ou de l’absence de protection contre les violences de genre constitutives de traitements inhumains et dégradants. Soit les discriminations du fait de leur accumulation sont à appréhender comme des persécutions : il résulte alors de l’addition des discriminations subies qu’elles atteignent le seuil de gravité requis, ce qui est le cas pour les femmes et fille afghanes qui voient limiter voire denier leur droit à l’éducation, leur droit à la santé, leur droit au travail, leur droit d’accès à la justice, leur liberté de manifestation, leur liberté d’expression, leur liberté d’aller et venir. Le droit de l’UE s’inscrit bien ainsi dans la perspective développée par le HCR en 2008 dans son principe [28] et reprise en 2023 dans son application à l’Afghanistan[29]. Et c’est bien cette logique qui est déployée par la CJUE dans son arrêt AH & FN. La Cour pose clairement que « les mesures discriminatoires visées par la juridiction de renvoi atteignent le niveau de gravité requis, tant par leur intensité et leur effet cumulé que par les conséquences qu’elles engendrent pour la femme affectée »[30] ; « l’effet cumulé et l’application délibérée et systématique, ces mesures aboutissent à dénier, de manière flagrante et avec acharnement, aux femmes afghanes, en raison de leur sexe, les droits fondamentaux liés à la dignité humaine » et « témoignent de l’établissement d’une organisation sociale fondée sur un régime de ségrégation et d’oppression dans lequel les femmes sont exclues de la société civile et privées du droit de mener une vie quotidienne digne dans leur pays d’origine »[31]. Et la CJUE d’en conclure que « les autorités compétentes des États membres peuvent considérer qu’il n’est pas nécessaire d’établir que la demandeuse risque effectivement et spécifiquement de faire l’objet d’actes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine » car « la seule prise en considération de sa nationalité et de son sexe est suffisante »[32]. Il s’agit d’une reconnaissance implicite de la constitution par les femmes afghanes d’un certain groupe social.
II. Le motif de persécution : la constitution d’un certain groupe social
Certes, en vertu de l’article 4 de la directive 2011/95, « toute demande de protection internationale doit, en principe, faire l’objet d’une évaluation individuelle » rappelle la CJUE dans l’affaire C-608/22. « Il appartient cependant aux autorités compétentes d’adapter les modalités d’appréciation des déclarations et des éléments de preuve documentaires […] en fonction des caractéristiques propres à chaque catégorie de demande de protection internationale », précise la Cour[33]. Par ailleurs, les Etats membres ont la possibilité – qu’ils n’auront bientôt plus en raison de l’entrée en vigueur en juin 2026 du règlement sur la procédure d’asile du 14 mai 2024 – de maintenir ou d’adopter des normes plus favorables[34]. Et la Cour de soutenir que « les autorités nationales compétentes peuvent considérer qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’établir, lors de l’examen individuel de la situation d’une demanderesse de protection internationale, que celle-ci risque effectivement et spécifiquement de faire l’objet d’actes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que les éléments relatifs à son statut individuel, tels que sa nationalité ou son sexe, sont établis »[35]. Autrement dit, l’évaluation de la situation individuelle est réduite à la détermination du sexe et de la nationalité[36]. Or, il s’agit là des deux éléments pour appréhender les femmes afghanes comme composant un certain groupe social, au sens de l’article 1 A 2) de la Convention de Genève. La CJUE dépasse ainsi la réticence à reconnaitre le genre comme motif de persécution et donc à reconnaître les femmes d’une certaine nationalité comme constituant un groupe social particulier, alors que le HCR et la doctrine le posaient depuis longtemps[37]. Or, des conditions sont à remplir qui sont entendues de manière alternative par le HCR (A), mais appliquées de façon cumulative par le droit de l’UE notamment (B). Si la notion est largement entendue à l’échelle internationale, elle est mise en œuvre de manière bien plus restrictive.
A. Les conditions de constitution : une énumération alternative
Dans les principes directeurs sur la protection internationale n°1 de 2008 consacrés à la persécution liée au genre de 2008, le HCR est clair : « un groupe social particulier est un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d’être persécutées ou qui sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique sera souvent innée, immuable ou fondamentale pour l’identité, la conscience ou l’exercice des droits de l’homme »[38]. Dans les principes directeurs sur la protection internationale n°2 de 2008 consacrés à l’appartenance à un certain groupe social (HCR/GIP/02/02 Rev.1), le HCR distingue bien deux approches distinctes de la reconnaissance de l’existence d’un certain groupe social : soit il s’agit de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer ; soit il s’agit de personnes perçues comme étant différentes par la société environnante ou par les institutions[39]. Alternative il y a. D’une part, l’approche fondée sur l’immuabilité ou sur les caractéristiques protégées considère l’existence d’un certain groupe social en se basant sur le fait qu’un groupe est uni par un trait d’identité qui est si fondamental que les personnes en cause ne peuvent ou ne devraient pas être obligée de le modifier. Sont à prendre en compte des caractéristiques innées ou historiquement acquises (notamment sexe, genre, orientation sexuelle, appartenance ethnique). D’autre part, l’approche fondée sur la perception sociale met l’accent sur le fait que la société d’origine distingue des personnes, même en l’absence d’une caractéristique immuable, pour des raisons légales, sociales, morales. Sont ainsi considérés des groupes constitués socialement ou institutionnellement, qui subissent une différenciation et une marginalisation.
Appréhender les femmes comme composant un certain groupe social s’avère pertinent au regard des pratiques développées dans certaines sociétés : leur situation répond à l’une ou l’autre de ces conditions alternatives. Outre que les principes directeurs sur la protection internationale n°2 de 2008 consacrés à l’appartenance à un certain groupe social font clairement référence au sexe et au genre[40], les principes directeurs sur la protection internationale n° 1 consacrés à la persécution liée au genre de 2008 posent que le HCR constate que les femmes fournissent « un exemple manifeste d’ensemble social défini par des caractéristiques innées et immuables, et étant fréquemment traitées différemment des hommes » et que « leurs caractéristiques les identifient également en tant que groupe dans la société, les exposant à des formes de traitement et des normes différentes selon certains pays »[41]. La directive 2011/95 en son article 10 section 1 sous d) précise d’ailleurs que « les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, doivent être dûment pris en considération aux fins de déterminer l’appartenance à un certain groupe social ». L’analyse exposée par le HCR, consolidée par les textes européens, établit ainsi clairement la légitimité d’une reconnaissance des femmes comme composant à un certain groupe social dès lors que l’un ou l’autre des deux critères est satisfait. Or, dans le contexte afghan, les deux critères sont réunis de façon dramatique.
B. L’articulation des conditions : une application cumulative ?
Cependant, les conditions de constitution d’un certain groupe social sont souvent comprises par les textes et par les juges de façon cumulative. Ainsi de l’article 10 §1 sous d) de la directive 2011/95 selon lequel un « groupe est considéré comme formant un groupe social particulier lorsque, notamment : les membres de ce groupe partagent une caractéristique innée, ou un passé commun qui ne peut être modifié, ou partagent une caractéristique ou une croyance qui est si fondamentale pour l’identité ou la conscience qu’une personne ne devrait pas être forcée d’y renoncer, et ce groupe a une identité distincte dans le pays concerné, parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante »[42]. Lorsqu’elle a reconnu l’existence d’un certain groupe social pour les femmes de Sierra Leone, du Pakistan, et du Bangladesh, la Chambre des Lords britannique a rejeté une telle exigence cumulative de montrer l’immuabilité des caractéristiques propres et la perception différenciée de la société environnante, en estimant qu’elle était si stricte qu’elle n’était pas conforme au droit international des réfugiés et aux lignes directrices du HCR. Toutefois, la CJUE, dans sa décision KL du 11 juin 2024[43], confirme que les deux conditions ne sont pas alternatives mais cumulatives. Quand bien la Cour interprète de manière souple chacune des deux conditions dans cette affaire traitant de l’occidentalisation de deux jeunes femmes irakiennes vivant aux Pays Bas et partant de leur adhésion à la valeur de l’égalité des sexes, la Cour de Luxembourg vérifie la satisfaction de chacune d’elles dans l’affaire : la caractéristique à laquelle le demandeur de protection ne saurait renoncer et la perception différente de la société environnante en cas de retour. Telle est l’approche développée par la CNDA, dans sa décision du 11 juillet 2024, selon laquelle les femmes et filles afghanes constituent un certain groupe social susceptible de bénéficier de la protection internationale[44].
Si certains juges de Etats membres de l’UE ont admis l’existence d’un certain groupe social des femmes afghanes lors du premier régime taliban (1996-2001) en se fondant sur leur nationalité et leur sexe, en considérant la condition d’immuabilité et la condition de perception, d’autres ont exigé que soit démontrée la satisfaction d’une condition additionnelle : un risque de mariage forcé, des violences sexistes, une preuve d’occidentalisation. Ainsi en a-t-il été en Grande Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Et de relever que la Cour administrative suprême d’Autriche avait en 2002 reconnu que, sous le premier régime taliban, les femmes afghanes remplissaient les conditions pour obtenir le statut de réfugié au motif de l’appartenance à un certain groupe social, mais a en 2022 adopté une position moins affirmative en préférant poser une question préjudicielle à la CJUE (dans l’affaire AH & FN). Le doute pouvait en effet exister. En effet, dans son arrêt WS du 16 janvier 2024[45], la CJUE ne fait pas seulement référence à la condition d’immuabilité et à la condition de perception, mais envisage le risque d’un mariage forcé, l’exposition à la violence physique ou mentale, y compris la violence sexuelle et domestique. Il est possible de penser qu’une condition supplémentaire est imposée, à l’instar de ce qu’exigent les juges aux Etats-Unis[46]. Néanmoins, dans sa décision AH & FN du 4 octobre 2024, ne retient pas le fait avancé par les deux requérantes selon lequel elles ont adhéré aux valeurs et mode de vie occidentaux : elle rejette ainsi l’exigence d’un troisième élément pour la reconnaissance de la constitution d’un certain groupe social.
Conclusion – A propos de l’apartheid de genre
Certes, les discriminations à l’encontre des femmes et des jeunes filles en Afghanistan sont documentées, qui, soit prises isolément, soit regardées en cumulé, constituent des persécutions pour demander une protection. Certes, les conditions de reconnaissance que ces femmes et jeunes filles afghanes composent un certain groupe social sont remplies qui rattachent les faits au motif d’octroi de la protection internationale. Reste que la façon d’appréhender en droit le régime d’oppression et de ségrégation, le dispositif de domination et de désubjectivation des femmes et des jeunes filles qui existe dans ce pays, fait défaut. Richard Bennett, Rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Afghanistan, soutient qu’il s’agit d’un apartheid de genre, comme l’admettent au demeurant le HCR et l’EUAA. Il estime l’élaboration du projet de convention sur les crimes contre l’humanité pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance officielle de l’apartheid de genre, par le biais d’un amendement à la définition de l’apartheid figurant à l’article 7 (2) (h) du Statut de Rome. L’apartheid de genre serait entendu comme « des actes inhumains commis dans le contexte d’un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques d’un groupe de sexe / genre sur tout autre groupe de sexe / genre et commis dans l’intention de maintenir ce régime ». Les deux éléments du crime d’apartheid seraient à réunir : 1) un contexte d’un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques ; 2) une commission des crimes dans l’intention spécifique et unique de maintenir ce régime. La Troisième Commission chargée des affaires sociales, humanitaires et culturelles en octobre 2024 a débattu de l’institutionnalisation de la reconnaissance de l’apartheid fondé sur le genre en se référant à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles visée dans le Pacte pour l’avenir adopté en septembre 2024. L’intérêt ne serait pas seulement de pouvoir poursuivre pénalement les responsables ayant instauré et maintenu un tel régime ; il serait également de pouvoir prendre en considération plus largement les victimes d’un tel crime qui ne sont pas uniquement les femmes, les jeunes filles, les personnes LGBTQIA+, mais aussi les hommes et les garçons condamnés en raison de leur résistance active aux exigences des Taliban ou sanctionnés du fait de leur incapacité à contrôler la conduite de ces femmes et jeunes filles.
[1] Efrat Arbel, Catherine Dauvergne & Jenni Millbank (dir.), Gender in Refugee Law: From the Margins to the Centre, Routledge, 2014, 308 p. ; Catherine Dauvergne, « Women in Refugee Jurisprudence », in. Cathryn Costello, Michelle Foster & Jane McAdam (dir.), The Oxford Handbook of International Refugee Law, 2020, pp. 728-745.
[2] Sam Chollet, « From margins to… the group ? La reconnaissance de la qualité de réfugiées aux femmes en tant que telles », RDLF, 2024, chronique n° 32.
[3] La CNDA a admis le 11 juillet 2024 que femmes et jeunes filles afghanes constituent un certain groupe social susceptible de bénéficier de la protection internationale (CNDA, GF, n°24014128). Elle a conclu de même récemment pour les femmes et jeunes filles iraniennes (CNDA, GF, 3 avril 2025, n° 24024165).
[4] EUAA, Country Guidance: Afghanistan. Common analysis and guidance note, mai 2024, 152 p, p. 71.
[5] Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 99/20/0483.
[6] Secretary of State for the Home Department v. K [2006] UKHL 46.
[7] Fornah v. Secretary of State for the Home Department, [2006] UKHL 46, 1 AC 412.
[8] SA v. Secretary of State the Home Department, CG [2011] UKUT 00254(IAC).
[9] Affaire, n° 47 053, 5 août 2010.
[10] Affaire n° 65 905, 31 août 2011.
[11] Affaire n° 62 922, 9 juin 2011.
[12] Affaire, n° 133 850, 26 novembre 2014.
[13] CNDA, 20 juin 2023, Les enfants E., n° 22043418 & n° 22043419.
[14] CNDA, 22 juin 2023, Mme S., n° 22053238 C.
[15] CNDA, GF, 11 juillet 2024, Mme F., n° 24011731 R.
[16] CNDA, GF, 11 juillet 2024, Mme B., n° 24006620 R.
[17] CNDA, 13 décembre 2024, Mme LABAT, n° 24019923.
[18] CNDA, GF, 3 avril 2025, n° 24008857.
[19] Le Pakistan développe des politiques de renvoi des Afghans se trouvant sur son territoire vers l’Afghanistan. Ainsi en a-t-il été des 640 000 éloignements opérés en 2023.
[20] Certes, les Afghans sont au deuxième rang des demandes d’asile dans l’UE en 2023 après les Syriens, avec 100 935 demandes (9,6 % du total) ; ils sont au premier rang des demandeurs d’asile en France depuis 2017 avec 16 948 demandes en 2023. Toutefois, les femmes représentent moins de 30% de ces demandes de protection de ressortissants afghans.
[21][21] CJUE, 11 juin 2024, Femmes s’identifiant à la valeur de l’égalité entre les sexes, C‑646/21, point 55 ; CJUE, 4 octobre 2024, AH & FN, C-608/22, point 5.
[22] CJUE, 4 octobre 2024, AH & FN, C-608/22, point 44.
[23] Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, Richard Bennett, A/79/330, 30 août 2024, points 2.
[24] Ibidem, points 19 et 93 respectivement.
[25] A/HRC/56/25, 13 mai 2024.
[26] A/HRC/53/21, 15 juin 2023.
[27] James C. Hathaway & Michelle Foster, The Law of Refugee Status, Cambridge University Press, 2014, p. 195.
[28] HCR, Principes directeurs sur la protection internationale nº 1. La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, point 14.
[29] A/HRC/53/21, 15 juin 2023, partie III, points 15 à 91.
[30] CJUE, 4 octobre 2024, AH & FN, C-608/22, point 42 [nous soulignons].
[31] Ibidem, point 44 [nous soulignons].
[32] Ibidem, point 57.
[33] Ibidem, point 51.
[34] Ibidem, point 55.
[35] Ibidem, point 58.
[36] Ibidem, point 59.
[37] Comité exécutif du HCR, Conclusions n° 39 (XXXVI), Refugee Women and International Protection, 1985, point k) ; James C. Hathaway & Michelle Foster, The Law of Refugee Status, opus cit., 1991, pp. 436-442.
[38] HCR, Principes directeurs sur la protection internationale nº 1. La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/GIP/02/01, 8 juillet 2008, point 29 [nous soulignons].
[39] HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n° 2. Appartenance à un certain groupe social dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, HCR/GIP/02/02 Rev.1, 8 juillet 2008, en particulier point 11.
[40] HCR/GIP/02/02 Rev.1, opus cit.
[41] HCR/GIP/02/01, opus cit., point 30.
[42] [Nous soulignons].
[43] C-646/11.
[44] CNDA, GF, n° 24014128.
[45] C-621/21.
[46] Ainsi, les juges américains ont fait évolué leur jurisprudence. D’abord, ils ont appliqué la seule exigence d’immuabilité (Matter of Acosta, 19 I&N Dec. 211 (BIA 1985)). Ensuite, ils ont exigé d’une part la condition d’immuabilité et d’autre part la condition de visibilité sociale qui est une appréhension spécifique et modifiée de la condition de perception sociale (Matter of C-A-, 23 I&N Dec. 951, 960 (BIA 2006)) pour évoluer vers une condition de distinction sociale (Matter of W-G-R-, 26 I&N Dec. 208 (BIA 2014). Enfin, ils ont exigé la réunion de trois éléments pour que soit admise l’existence d’un certain groupe social : la caractéristique immuable ; la distinction sociale ; et la particularité permettant de décrire avec précision le groupe afin de le distinguer clairement de l’ensemble de la société et afin de délimiter les contours du groupe (Matter of S-E-G-, 24 I&N Dec. 579 (BIA 2008) & Matter of M-E-V-G-, 26 I&N Dec. 227 (BIA 2014)). Depuis lors, il a été affirmé que les trois conditions étaient remplies dans le cas des femmes ou des femmes d’une certaine nationalité (De Pena-Paniagua v. Barr, 957 F.3d 88, 95 (1st Cir. 2020). Deborah Anker, « Women Refugees and the Development of US Asylum Law: 1980-Present », Refugee Survey Quarterly, Vol. 41, n° 3, septembre 2022, pp. 420-443 ; Mackenzie Heinrichs, « Closing the Asylum Gender Gap: Why ‘Afghan Women’ is a Compelling Particular Social Group », Minnesota Legal Studies Research Paper No. 24-43, octobre 2024.



